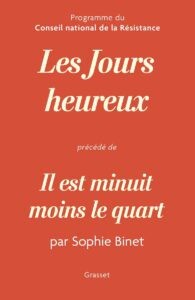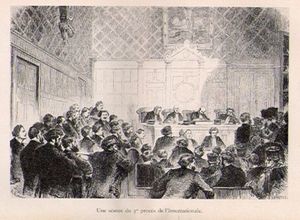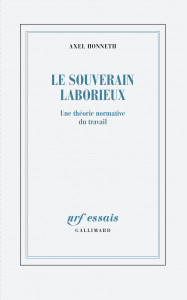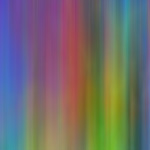Jean-Marie Pernot, auteur de « Le syndicalisme d’après » (Editions Le Détour-Lire : http://syndicollectif.fr/?p=1972) prend au mot la parole de Sophie Binet en 2024 (« Il est minuit moins le quart« ). Il pose la question de la responsabilité politique propre au syndicalisme, « à distance raisonnable de la gauche politique« . A ces yeux, c’est la question du « travail » qui peut servir de lien pour construire « la Cité« , et retrouver du sens politique, si le syndicalisme prend cette question à bras-le-corps.
EmanciPassion : cet article inaugure une nouvelle rubrique de Syndicollectif : débattre de l’avenir, de la « besogne d’avenir » (Amiens 1906), de l’alternative, et de susciter le désir et le récit d’une visée très politique. Avec les outils, souvent aussi les contraintes, du syndicalisme comme mouvement collectif. Réveiller les imaginaires.
- Télécharger l’article : JM Pernot-Propositions pour le dernier quart d’heure
Propositions pour le dernier quart d’heure
Jean-Marie Pernot
« Il est minuit moins le quart » Sophie Binet
Le vent mauvais qui souffle aujourd’hui sur la société française et bien au-delà interdit de penser le présent et l’avenir du mouvement syndical en dehors d’un certain sentiment d’urgence. Le fascisme qui vient a repris ses habits pas toujours neufs (haine de l’étranger, appel à l’ordre) et surfe désormais sur les souffrances et les frustrations d’une population livrée en pâture à un capitalisme débridé ; la représentation politique est en pleine dérive avec une droite cynique et un grand patronat qui, comme dans le passé, a déjà trouvé les accommodements avec l’extrême droite qui n’envisage d’ailleurs nullement de lui disputer ni son pouvoir ni son insolente appropriation de la richesse. La raison, la culture, la science, le simple respect des faits, font l’objet de remises en cause qui nous déportent parfois en un temps d’avant la philosophie des Lumières.
Les idées de l’extrême droite sont plus dangereuses encore que le poids électoral du Rassemblement national : elles empoisonnent littéralement la vie quotidienne avec cette obsession sécuritaire, cette haine de l’autre assumée de plus en plus ouvertement, auquel on peut rajouter cette réaction masculiniste offensée par l’exigence féministe survenue avec le mouvement « Me Too », ce dernier étant par ailleurs une des rares bonnes nouvelles des années récentes. Des départements semi ruraux qui ne connaissent ni le chômage, ni l’insécurité, ni la présence d’immigrés et qui votent massivement RN, des villages dont le maire ne reconnaît plus le visage, la société tout entière semble emportée dans un maelström qui engloutit toute raison et toute espérance émancipatrice.
A ce contexte pleinement politique, au sens premier du terme, c’est-à-dire concernant la possibilité d’une vie ordonnée de la Cité, quelle(s) réponse(s) peut apporter un mouvement syndical en proie de son côté à un affaiblissement bien antérieur à cette conjoncture ? C’est à quoi s’attacheront ces quelques réflexions versées au débat sans autre ambition que de le nourrir.
On commencera par interroger la part que le syndicalisme doit (ou non) prendre dans les tensions qui traversent aujourd’hui la gauche politique ; on évoquera ensuite les dégâts opérés dans les consciences non seulement par les difficultés matérielles d’existence mais aussi par le ressentiment qu’elles produisent ; on insistera sur la part des dérèglements du travail dans ce recul des aspirations émancipatrices avant de formuler quelques propositions sur la nécessité d’une campagne syndicale durable, unitaire et de masse autour de la question du « travailler autrement ». Cette perspective nous semble aujourd’hui la porte d’entrée la plus sûre pour reconstituer un désir d’émancipation propre à endiguer les passions tristes de l’extrême droite et permettre la reconstruction d’une puissance d’agir syndicale.
Pour une distance raisonnable entre les syndicats et la gauche politique
Il est courant d’entendre appeler partis, syndicats et associations progressistes à mettre au point ensemble un programme de gouvernement qui donnerait une meilleure chance électorale aux partis de gauche en attirant à elle des soutiens populaires qui lui font aujourd’hui défaut dans les scrutins nationaux. Pourquoi pas ! Ce ne serait d’ailleurs pas très nouveau car le programme social des partis s’est toujours nourri des propositions syndicales, que ce soit en 1936, à la Libération (le programme social du CNR), pour le programme commun de 1972 et même les réalisations sociales des gouvernements après 1981 (Lois Auroux) ; on peut rappeler que les nationalisations de 1945 ne figuraient dans aucun programme des partis politiques, seule la partie réformiste de la CGT avait porté cette demande depuis l’entre-deux-guerres. Les propositions « sociales » du PC lui ont toujours été fournies par la CGT (la courroie de transmission fonctionnait parfois dans les deux sens) ; et le Parti socialiste, qui ne tire son rapport à la société civile que du tissu de ses élus locaux, a toujours puisé, faute d’élaboration propre, dans un mixe Force ouvrière, CFDT et FEN, selon les circonstances.
Mais le programme est-il la bonne façon d’entrer dans le sujet politique ? L’acte de vote n’est pas celui de l’électeur rationnel seul dans l’isoloir et au jugement éclairé par la lecture des programmes, conception du suffrage universel propre à l’individualisme libéral ; l’exercice du vote, qui commence par la détermination à aller voter, s’inscrit dans un mouvement qui est porté par un imaginaire collectif. La « formation démocratique de la volonté » se construit dans une expérience socialement partagée. Le problème n’est donc pas dans le programme mais dans l’absence d’un imaginaire mobilisateur de la gauche : les catégories populaires qui constituent à la fois le cœur de la représentation sociale des syndicats et, a priori, la base politique de la gauche sont aujourd’hui loin d’attendre beaucoup du syndicalisme et, moins encore, des forces politiques de gauche. Il faudrait bien sûr nuancer cette affirmation un peu lapidaire. Mais la masse des abstentionnistes, l’important vote pour l’extrême droite dans les catégories populaires, attestent d’une coupure profonde. Le programme du Nouveau Front populaire (NFP), très inspiré de l’élaboration de la France insoumise, n’a recueilli que 28 % des suffrages exprimés lors des élections législatives de juin 2024, soit un étiage historiquement bas pour la gauche sans compter que l’électorat populaire en était singulièrement absent.
De même, il est suggéré parfois que les syndicats ne parviendront pas seuls à sortir de la crise de langueur qui les affecte tandis que la gauche et les écologistes ne pourront pas non plus regagner seuls une influence majoritaire. L’idée suggérée ici que séparés on ne peut rien mais que réunis, tout est possible, est selon nous une image trompeuse : outre le fait que l’alliance de l’aveugle et du paralytique n’a jamais fait un individu en bonne santé, ce raisonnement fait l’économie de questions propres à chacun des champs. Cette symétrie en trompe l’œil fait l’impasse, d’un côté, sur les causes profondes de la perte de puissance syndicale qui n’est pas tout entière incluse, loin de là, dans l’affaiblissement de la gauche et fait l’impasse également sur l’ampleur d’un recul, voire d’un rejet, qu’un programme de gauche même étayée par des apports syndicaux et associatifs ne parviendra pas à inverser par sa seule force.
Il y a, bien sûr, des recoupements entre représentation politique et représentation syndicale, ce sont deux champs qui communiquent mais qui ne se confondent pas. Il y a des problèmes du champ partisan qui ne peuvent être résolu que dans et par celui-ci ; il y a des problèmes dans le champ syndical dont les réponses doivent être produites dans le champ syndical lui-même. Les domaines ne sont pas étanches, ils communiquent déjà par le fait des multi appartenances d’un grand nombre de militant(e)s. Ils communiquent aussi parce que le recouvrement de la puissance syndicale passe par des déplacements dans les représentations sociales présentes à la conscience des individus et que ceci relève bien de constructions idéologiques et donc politiques.
Il ne s’agit donc pas ici d’apologie d’un syndicalisme qui ignorerait l’importance de la politique ; une telle négligence serait au demeurant bien vite rattrapée par la menace de l’extrême droite. Loin de s’écarter du politique, cette recommandation d’une distance raisonnable répond au contraire aux urgences politiques de la période sous un double commandement :
- D’une part, maintenir et renforcer une unité syndicale toujours fragile qu’un engagement partisan trop manifeste pourrait contrarier1 ; on aura remarqué (le résultat des élections sociales le rappelle, ainsi que les sondages « sorties des urnes ») qu’une majorité syndicale dans le pays ne se reconnaît pas dans les choix politiques de la gauche. La communauté de destin traduite par une hostilité partagée à l’extrême droite ne vaut pas soutien à une alliance de gauche, en tous cas, pas à ce stade.
- D’autre part, c’est dans les pratiques et les discours du syndicalisme que l’on peut s’attaquer en profondeur aux causes de l’affaissement du désir d’émancipation qui affecte les pensées et les gestes de celles et ceux dont le syndicalisme et la gauche se veulent les représentants. L’action collective est un levier puissant, parce qu’elle est « action », c’est-à-dire l’opposé de la soumission aux affects négatifs, parce qu’elle est « collective », c’est-à-dire qu’elle permet de sortir de l’intériorisation individuelle de la domination.
La dimension politique du syndicalisme consiste aujourd’hui à appréhender dans leur globalité et à agir en pratique sur les causes qui ont relégué loin des consciences individuelles et collectives l’espérance et le désir d’émancipation.
Le poison du ressentiment
On postule en général et le plus souvent inconsciemment que le désir d’émancipation est une donnée de la conscience des individus opprimés. On sait bien pourtant que cela ne marche pas comme ça : dans nombre de situations, on a vu au contraire la dégradation des conditions matérielles d’existence plonger les couches populaires dans le ressentiment et inspirer des colères qui ne sont nullement porteuses de visées émancipatrices. Les victoires de l’extrême droite dans nombre de pays au cours des dernières années n’auraient pas été possibles sans le ralliement d’une partie des couches populaires, lequel réactive la question récurrente : qu’est ce qui fait que les dominés épousent un point de vue politique qui ne fera que renforcer leur domination ? Ou, pour reprendre le vieux paradoxe d’Aneurin Bevan : « Comment les riches peuvent-ils persuader les pauvres d’utiliser leur liberté politique pour maintenir la richesse au pouvoir ? »
Nous sommes aujourd’hui devant une interrogation de ce type : elle n’est pas nouvelle, elle a inspiré des réflexions dans l’entre-deux-guerres alors qu’une bonne partie des couches populaires en Allemagne ou en Italie ont accompagné le fascisme, ou même au Royaume uni où celui-ci a été puissant : il est patent que Bolsonaro, Milei, Trump et chez nous le RN disposent d’appuis significatifs dans les couches populaires. Le désaveu de la gauche de gouvernement est naturellement une raison majeure de cette évolution mais cet argument ne donne pas la clé de la reconstitution d’une espérance émancipatrice. La séparation est profonde et elle n’est pas réductible à la question du programme.
Dans « La misère du monde » (1993), Pierre Bourdieu distinguait deux éléments constitutifs de la situation des dominés : la misère de condition, celle qui est directement liée aux conditions matérielles d’existence, et la misère de position « dans laquelle les aspirations légitimes de tout individu au bonheur et à l’épanouissement personnel, se heurtent sans cesse à des contraintes et des lois qui lui échappent »2. Une exposition prolongée à de telles frustrations engendre un sentiment d’exaspération, d’impuissance, une rumination intérieure dépourvue de possibilité d’agir sur sa situation. Le ressentiment, écrivait Max Sheler, est « un empoisonnement psychologique »3,
Il y a une dissonance croissante entre les conditions de vie réelles d’une grande partie de la population et ce discours public, relayé à l’envi, qui ne cesse de célébrer la supériorité morale de notre modèle démocratique, de « nos valeurs », auquel on peut rajouter ces discours sur la dépense publique, ce coût exorbitant de la protection sociale qu’il importerait de réduire. Cet écart rend la situation difficile à comprendre et fait le lit du discours de l’extrême droite qui détourne comme à l’habitude le sujet vers des causes secondaires, avec ses obsessions anti-immigrés, anti-étrangers, la haine des élites, le tout assimilé aux idéaux universalistes de la gauche. Ce ressentiment se combine de plus en plus fréquemment avec le complotisme qui offre une réponse à bon marché aux dérèglements que l’on ne comprend pas et dont les déterminants sont occultés. Et tout cela enfle comme un écho à travers les réseaux sociaux qui sont de puissants agrégateurs de ressentiment ou par l’effet amplificateur de ces médias vecteurs d’une pensée d’extrême droite de plus en plus assumée.
Dans un tel dérèglement de la conscience publique, les débats qui traversent la gauche politique ne sont en rien anormaux : ils reflètent les différentes façons de faire face à la situation, ils traduisent aussi la difficulté de ses composantes à tirer les enseignements des expériences antérieures. Les processus de recompositions politiques sont des processus longs, hachés de crises nécessaires et d’autres qui seraient sans doute évitables ; le surgissement du NFP, produit de l’urgence, n’a pu constituer (jusqu’à aujourd’hui) une réponse de long terme, comment le pourrait-il ? Des comités locaux peuvent lui donner chair, sans doute, des militants syndicalistes (et aussi beaucoup « d’anciens » syndicalistes) participent à l’initiative et à sa survie ; c’est légitime, peut-être nécessaire, mais cela ne saurait constituer aujourd’hui la composante principale de la responsabilité du syndicalisme.
Le syndicalisme, une digue fragile
Le mouvement syndical reste un des principaux môles sinon de résistance du moins d’endiguement de la dérive fascisante. Le syndicalisme est la forme sociale la plus étendue au contact de la population. Il y a certes beaucoup de trous mais deux millions de travailleur.ses organisées, c’est peut-être très insuffisant face à un capitalisme échevelé mais c’est un potentiel d’autant plus grand que les principaux syndicats ont tissé un réseau d’alliances avec un monde associatif assez dense et militant.
Cependant, malgré un engagement ferme au niveau des confédérations, de certaines d’entre elles au moins, de nombreux militants témoignent des difficultés et des limites de la dénonciation idéologique du Rassemblement national : les rejets proclamés au niveau national peinent à être déclinés à la base, ce qui est logique compte tenu de ce qui a été évoqué plus haut.
La difficulté tient aussi à un affaissement de l’implantation dans le secteur concurrentiel qui a fini par émousser les capacités de mobilisation, même dans le secteur public et la fonction publique. Il y a certes de nombreux conflits qui témoignent du maintien d’une certaine vitalité sociale. Mais elles n’invalident pas le constat général d’un rapport de force dégradé.
L’affaiblissement n’est pas que quantitatif, il a transformé qualitativement la relation entre les organisations dites représentatives et le monde du travail : d’une manière générale le rapport de représentation (« les syndicats représentent les travailleurs », est-il écrit au fronton du droit du travail) a été remplacé, là où les syndicats sont présents, par un rapport de service : les syndicats ne sont pas tant reconnus comme des représentants que jaugés à l’aune de « l’utilité » ; l’influence mesurée par le vote mis au service de la représentativité par la loi de 2008 a permis de se décharger de l’implication personnelle : le syndicat doit être utile pour mériter le suffrage, sans autre horizon d’attente. L’enjeu est de réduire cette extériorité entre les travailleur.ses et ceux et celles qui, en fait et pas seulement en droit, les « représentent ». Ce rapport de représentation se reconstitue au moment des mobilisations car l’action collective crée un besoin de représentation ; c’est pourquoi elle se traduit en général par un regain relatif d’attention voire d’adhésion. Il n’en reste pas moins fragile et n’invalide pas l’appréciation globale du recul.
Mais si le discours anti-RN peine à s’imposer sur les lieux de travail, c’est aussi parce qu’il ne peut pas, dans les circonstances actuelles, s’adosser à un contre récit propre à endiguer la force des idées propagées par l’extrême droite.
Nous soutiendrons ici l’idée que la question du travail est aujourd’hui le point nodal de compréhension des dérèglements de la conscience sociale : elle est le support fédérateur de pratiques sociales potentiellement émancipatrices qui offre en même temps la possibilité d’un contre-récit global de compréhension du monde et la possibilité de reconstitution d’un lien représentatif au fondement de la puissance d’agir syndicale.
« Ras’l bol de travailler comme ça »
En une trentaine d’années, les conditions d’existence matérielles se sont considérablement dégradées pour une grande partie de la population. Le mouvement des Gilets Jaunes avait mis en lumière les difficultés d’accès aux soins, le coût des déplacements pour ceux qui sont éloignés des métropoles, d’autant plus mal ressentis qu’ils sont accompagnés d’un discrédit moral de l’usage quotidien de la voiture ; on peut y ajouter les agriculteurs, les marins pêcheurs, un grand nombre de catégories, parfois aux franges du salariat mais qui sont laminées par la mondialisation des marchés. Les mêmes sont exposés, avec d’autres, à un très haut niveau d’accidents du travail. Ceux-ci sont caractéristiques de secteurs professionnels bien connus : la construction, le nettoyage, mais aussi la restauration, le transport et l’activité manufacturière. S’y ajoute depuis quelques années tout le secteur du soin ou du Care4. La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de travail reconnaît en 2021 que les conditions de travail en France se sont davantage dégradées que dans la plupart des autres pays européens5. L’extension du travail de plateforme porte en lui une surexploitation indécente qui met en péril la santé de manière inacceptable comme l’ont montré les mises en cause de Deliveroo et Uber Eats au début de l’année 20256.
La grande distribution licencie en masse, met ses magasins en franchise ou en gérance afin de baisser les droits acquis des travailleur.ses. Le succès de nouvelles marques (Action, par exemple) est attribué en grande partie aux conditions de travail et de rémunération extrêmement précaires de leurs salariés.
Mais la crise du travail se donne à voir de bien d’autres manières : le grand rejet de la réforme des retraites de 2023 portait en lui ce caractère insupportable du travail contemporain : dans une étude publiée la même année, la DARES relevait que 37 % des salariés (et 41 % des femmes) de tous secteurs professionnels, cadres comme non cadres, ne se sentaient pas capables de tenir jusqu’à la retraite ; l’intensité du travail, le manque d’autonomie et l’absence de participation aux décisions étant les principales causes qui rendent leur travail insoutenables7.
Et ces indicateurs se dégradent d’année en année. Les études consacrées à l’état de la santé mentale au travail révèlent un niveau de détresse croissant et massif des salariés français : selon un baromètre suivi chaque année, 45 % des travailleur.ses sont, en 2025, dans un état de détresse psychologique, 31 % en burn out, 13 % se trouvant dans un état de détresse aigue. Sont en cause : « Une charge de travail excessive, des changements incessants dans l’organisation, l’introduction de nouveaux outils, mais aussi un manque de reconnaissance et une insatisfaction quant à la qualité du travail effectué »8 Il y a eu des signes précurseurs : en 1995, trois chercheurs (sociologue, économiste et psychologue) relevaient déjà, dans un ouvrage commun, une France « malade du travail » dans lequel les auteurs mettaient déjà les évolutions du travail en regard de l’affirmation selon laquelle : « le travail exprime la potentialité de se réaliser soi-même, développer ses capacités, se confronter au réel, construire ses projets, entrer en relation avec les autres »9. Il y a dix ans maintenant, le juriste Alain Supiot dénonçait les effets négatifs de la « gouvernance par les nombres » qui se déployait dans l’activité de travail, la dictature des indicateurs, les reporting incessants, la gestion par le stress, qui entrainaient une perte de sens du travail et la dégradation de la santé mentale des individus10. Depuis, enquêtes et témoignages se relaient pour montrer le caractère croissant de cette dégradation11.
Aujourd’hui tous les indicateurs passent au rouge : les pressions croissantes sur le monde enseignant qui exercent un métier devenu « à risques », les suicides de soignant-es en milieu hospitalier qui révèlent l’état de ce service public soumis depuis 30 ans au lean management et à la réduction des coûts ; même l’explosion de la consommation de cocaïne est en partie mise au compte de la dégradation des conditions d’accomplissement du travail12. C’est donc un fait objectivé dans l’espace public : le travail est devenu une machine à broyer les individus, leur santé physique et psychique ; pas un jour ne passe sans nouvelle preuve de l’effet social destructeur du travail, non pas le travail « en soi » qui reste entouré d’attentes de la part de ceux qui l’exercent, mais le travail dans le capitalisme contemporain. Ce cauchemar est une partie significative du dérèglement des consciences évoqué plus haut car il pénètre en profondeur la psyché des individus comme l’ont montré, en particulier, les travaux de psychodynamique du travail13 .
Travail, syndicat et démocratie
Les conséquences de la vertigineuse dégradation des conditions d’accomplissement du travail portent atteinte à l’exercice des droits démocratiques, à commencer par le suffrage universel. Thomas Coutrot a montré l’incidence sur les comportements électoraux des situations de dépendance professionnelle : il a montré que les manques d’autonomie dans le travail étaient associés à une plus forte abstention électorale et que les évolutions du travail contribuent largement à ce qu’il est convenu d’appeler la « crise de la représentation politique »14.
Dans un ouvrage récent, Axel Honneth attire l’attention sur « le lien très étroit qui existe incontestablement entre l’organisation du travail social et les conditions de participation démocratique »15. Il définit cinq conditions permettant à tout individu de participer à ce qu’il appelle la « formation démocratique de la volonté » : (1) la sortie de l’insécurité économique est une condition sine qua non ; (2) elle doit s’accompagner d’une certaine quantité de temps disponible. Cette condition est liée à la précédente pour les catégories à faible revenu mais elle vaut pour d’autres groupes affranchis de la contrainte matérielle mais soumis à une sollicitation en temps exagérée ; (3) « la participation à l’espace public démocratique requiert aussi un certain degré d’estime de soi, un certain sentiment de sa propre valeur ». (4) Elle suppose une pratique de la coopération dans le travail, c’est-à- dire un rapport positif à l’interaction avec les autres ; (5) elle nécessite enfin un travail qui stimule les capacités créatrices propres à tout cerveau humain, en lieu et place des tâches répétitives et monotones qui finissent par déteindre sur l’habitus intellectuel et les rapports à l’environnement social.
Ces cinq conditions peuvent à peu près toutes être considérées également comme des prérequis à un engagement dans l’activité syndicale. Aller vers la satisfaction de ces conditions est une tâche qui permet tout à la fois de reconstituer un tissu social de solidarités à la base de toute action syndicale de masse et de redonner du crédit à un désir d’émancipation nécessaire à l’émergence d’un nouvel imaginaire politique de gauche.
C’est en cela que le syndical et le politique sont liés mais il faut poser le problème dans le bon ordre et aujourd’hui, l’entrée par la question du travail est le moyen de faire ce lien. Plutôt que de partir du « programme » d’une gauche politique en état d’apesanteur, la tache politique du syndicalisme consiste à reconstruire ces liens qui resocialisent au détriment des politiques du travail qui détruisent la société et les individus.
Des possibilités existent : les syndicats font souvent ce qu’ils peuvent, mais ils sont souvent absents là où les conditions d’exercice du travail sont les plus dégradées ; là où ils sont présents, on les trouve parfois démunis comme l’ont montré quelques cas comme France Telecom ou encore la sécurité sur les sites nucléaires où la forte présence syndicale n’a en rien protégé l’exposition aux risques des opérateurs de la sous-traitance.
Quelques occasions ont été ratées : la CFDT avait lancé en 2016 une grande enquête « Parlons travail » destinée à recueillir des paroles « et faire émerger les véritables préoccupations de travailleurs ». Plus de 200 000 questionnaires étaient remontés démontrant la résonnance de cette thématique dans le monde du travail. Mais la CFDT n’en a pas fait grand-chose, elle n’a réussi ni à impressionner les décideurs publics ni à traduire les enseignements de l’étude en perspective d’action syndicale.
La CGT avait entamé à la fin des années 2000 une démarche dite « Travail et émancipation » qui a permis en une dizaine d’années de faire progresser la prise en charge de ces questions par des équipes conscientes de la nécessité d’élargir le périmètre des prises en charges syndicales. Ce chantier a été interrompu par la direction confédérale après le 52° congrès en 2019, sans aucune explication.
La prise de conscience existe souvent mais l’action concrète reste au cas par cas alors que c’est aujourd’hui un problème social, c’est-à-dire qu’il se pose à la société tout entière et aussi à tout le monde. Par son extension, le phénomène concerne directement le travailleur ou la travailleuse mais aussi son environnement immédiat : enfant, parent, frères ou sœurs, ami-es ou conjoint-es, bref tout le monde directement ou indirectement. Et face à quelque chose qui touche tout le monde, il faut un discours qui s’adresse à tout le monde. C’est pourquoi nous proposons une grande campagne nationale durable et intersyndicale sur le thème : « Ras’l bol de travailler comme ça ! ».
C’est un thème fédérateur qui permet d’ouvrir les portes du syndicalisme à tous ceux et celles qui ont quelque chose à dire de l’insatisfaction qu’ils et elles ont à travailler comme ils le font : c’est redonner au travail syndical de base la responsabilité de produire les revendications adaptées, c’est créer une communauté de points de vue préalable à la constitution de communautés d’action collective pour changer le travail : c’est un mouvement unitaire entre différentes catégories, cadres, techniciens, employé(e)s, ouvrier(e)s, toutes sont concernées et toutes peuvent en parler : au niveau professionnel, interprofessionnel, au niveau local, entre les générations, des ponts peuvent être dressés, des portes peuvent être ouvertes, toutes et tous peuvent se retrouver dans l’idée que « le travailleur doit être chez lui dans son travail »16.
Il faut libérer des espaces particuliers pour l’expression des femmes qui sont les premières concernées par le travail sous payé (les salaires féminins sont en moyenne inférieurs de 15 % aux salaires masculins à qualification égale), par le temps contraint, que ce soit le temps partiel imposé ou les nouvelles structures familiales : un enfant sur quatre vit dans une famille monoparentale, c’est-à-dire dans 85 % des cas avec leur mère, de quel temps « libre » disposent-elles ? Elles sont les premières dans les métiers pénibles qui se développent dans le soin et l’accompagnement ; et souvent les premières aussi à rencontrer le mépris de la hiérarchie et du masculinisme ambiant.
« Ras’l bol de travailler comme ça » est un appel à libérer la parole, c’est le premier pas vers l’établissement de nouveaux carrefours, à l’image de ceux occupés par les Gilets jaunes dont tous ceux et celles qui les ont observés témoignent qu’ils y ont créé des solidarités préalables à l’action collective. Dans sa contribution à un ouvrage récent, la politiste Sophie Béroud invitait les syndicats à observer les sociabilités créées par les Gilets jaunes sur les ronds-points et à réinscrire leur manière de faire dans les sociabilités populaires17.
Le quart d’heure est une durée trop brève pour contenir un tel programme. En s’y mettant sans attendre, il est possible cependant de faire mieux que gagner du temps : le thème du travail est adéquat à recréer du lien, les syndicats peuvent reconquérir une place dans l’espace public, donner l’envie d’agir ensemble, redonner le goût de l’émancipation qui s’atrophie dans l’attente, souhaitée ou redoutée, de l’extrême droite.
C’est une tâche pleinement politique puisqu’elle concerne un ordre acceptable pour la Cité, inséparable de la capacité des individus à participer à « la formation démocratique de la volonté ».
Le 25 avril 2025
Notes :
1 Choix d’autant plus dommageable que les efforts pour réorienter les trajectoires partisanes risquent de s’avérer totalement vains.
2 P. Bourdieu, 1993, La misère du monde, Paris, Le Seuil.
3 M. Sheler, 1912, L’homme du ressentiment, Paris, Gallimard, 1970.
4 La notion de Care est plus large, elle englobe aussi l’accompagnement des personnes âgées, handicapées, scolaires en difficulté, etc.
5 Eurofound, « Working conditions and sustainable work. Working conditions in the time of COVID-19: Implications for the future », 2022, figure 35 p. 52. Cité dans « Pour une politique du travail : contribution aux débats du mouvement social », Ateliers Travail et Démocratie, avril 2023.
6 « Uber Eats, Deliveroo… Les revenus des livreurs indépendants ont baissé d’un cinquième voire d’un tiers en quatre ans » Le Monde – AFP, 4 avril 2025.
7 M. Beatriz, « Quels facteurs influencent la capacité des salariés à faire le même travail jusqu’à la retraite ? » Dares Analyses n°17, mars 2023.
8 14e édition du baromètre « État de santé psychologique des salariés français » – OpinionWay pour Empreinte Humaine.
9 J De Brandt, Ch Dejours, C Dubar, 1995, La France malade du travail, Paris, Bayard.
10 A. Supiot, 2015, La gouvernance par les nombres,
11 A. Alphon-Laire, 2023, Et si on écoutait les experts du travail : ceux qui le font, Paris, L’Harmattan.
12 « Des millions de travailleurs en France se tournent vers la drogue pour tenir face à des conditions de travail insoutenables. Cocaïne, cannabis, alcool : un refuge devenu quotidien. Ce phénomène s’étend à tous les secteurs, des start-ups aux chantiers » .France Soir – AFP, 25 mars 2025.
13 Entre autres, Ch Dejours, 1980, Travail, usure mentale – De la psychopathologie à la psychodynamique du travail, Paris, Bayard.
14 T. Coutrot, 2024, Le bras long du travail, Document de travail IRES.
15 A. Honneth, 2024, Le Souverain laborieux, Paris, Gallimard Coll. Essais, p 63.
16 La formule se trouve sous la plume du philosophe Hegel.
17 S. Béroud, 2023, « Une giletjaunisation des syndicats ? Entre rejets, rencontres et influences », dans K. Yon (dir), Le syndicalisme est politique, Paris, La Dispute.