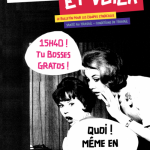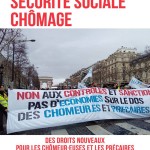A la Société générale (SG) la fin du télétravail imposé en un simple clic du PDG a déclenché une grève appelée par la CFDT, la CGT et la CFTC. On s’en souvient : pendant et après la période COVID, le monde patronal et les directions des ressources humaines (DRH) semblaient faire du télétravail le paradis du management « moderne », où soit-disant tout le monde y gagnait. On assiste maintenant à un revirement. Les analyses syndicales ci-dessous montrent la complexité du sujet à propos de la brutalité patronale décrétant la fin du télétravail, pouvant aussi provoquer la fin de l’emploi (comme l’analyse la CFDT), mais à l’initiative…des salarié-es démissionnaires obligé-es de se réorganiser du jour au lendemain. L’auto-licenciement : le rêve patronal. La CGT de la banque est aussi vent debout contre l’oukaze patronal. Mais une analyse sur les dangers du télétravail a été publiée dans Options, journal de l’UGICT CGT (cadres), au printemps 2025. Bref : un sac de contradictions.
« Fin du télétravail… ou fin du travail ? »
Extrait de l’hebdo n°3973

Caroline Guillaumin, DRH du groupe Société Générale, expliquait ainsi en janvier 2021 : « Le télétravail va être généralisé et devenir la norme pour tous nos collaborateurs, apportant les bénéfices attendus en termes de qualité de vie. Il va également nous amener à repenser différemment le management des équipes et l’utilisation des espaces de travail. » L’accord de 2021 rendait donc le télétravail hebdomadaire possible jusqu’à 50 % du temps, selon les équipes, et applicable aux 45 000 salariés de la Société Générale en France (contre 12 000 auparavant), « répondant aux attentes des collaborateurs et faisant suite à une vaste consultation interne ».
Sans préavis ni concertation préalable
Pourtant, le 19 juin dernier, par un simple courriel envoyé aux 119 000 salariés du groupe dans le monde, le directeur général, Slawomir Krupa, a balayé les termes de cet accord sans préavis ni concertation préalable avec les organisations syndicales, limitant à un jour au maximum par semaine le nombre de jours télétravaillables. Il justifie sa décision par la volonté, notamment, de « développer une culture de la performance » et de « stimuler l’innovation ».
La consternation provoquée par cette dénonciation unilatérale se révèle d’autant plus forte parmi les salariés et les organisations syndicales qu’aucun signe avant-coureur n’avait filtré en interne jusque-là. « Plusieurs comités de suivi en lien avec l’accord ont confirmé, ces trois dernières années, que cette pratique ne posait aucun problème au sein du groupe, précise Khalid Bel-Hadaoui, délégué syndical national CFDT. Nous demandons l’ouverture d’une négociation sur la base de réels indicateurs, pas sur de simples croyances ou convictions. »
Avec la fin de la période Covid…
La Société Générale rejoint donc la liste des entreprises françaises ayant commencé à rétropédaler, dans le sillage des sociétés américaines de la tech qui avaient mis leurs salariés au 100 % télétravail mais ont ensuite exigé qu’ils reviennent au bureau. En mars 2025, Sergey Brin, cofondateur de Google, appelait ainsi ses équipes à « devenir leader dans la course à l’IA » en déclarant que 60 heures de travail par semaine et tous les jours au bureau constituaient « le point idéal de productivité ».
En France, début avril 2025, la direction de Stellantis a fait savoir aux élus du CSEC1 qu’elle voulait réduire le nombre de jours télétravaillés de ses salariés de l’activité tertiaire en réintroduisant trois jours de présentiel par semaine au minimum. « Renforcer la collaboration », « accélérer le processus décisionnel » ou « stimuler l’innovation » sont également les objectifs affichés. Mais, là encore, cette décision n’est pas compatible avec l’aménagement des bureaux, désormais calibrés pour des salariés en télétravail à 70 % du temps…
« Pour une meilleure interaction des salariés » : c’est l’argument avancé par JCDecaux (gestion des concessions publicitaires dans les transports), qui a informé ses troupes qu’elles passeraient de deux jours à un seul de télétravail au mois de septembre 2025. « Les salariés ne posaient plus de RTT, ne prenaient plus de journées enfant malade. La direction n’avait plus confiance », analyse le délégué syndical CFDT Foued Maazouza.
De fait, cinq ans après la généralisation du télétravail, les réticences sont encore très présentes de la part de certains employeurs, notamment dans la fonction publique, où seul un agent sur six déclarait pouvoir télétravailler en 2023 – contre deux cadres sur trois dans le secteur privé. « Nos managers ne sont pas prêts, ils n’ont reçu aucune formation au travail à distance ; une majorité d’entre eux continuent de gérer le télétravail comme du présentiel », souligne Patrice Lorthiois, secrétaire de la section CFDT de Montpellier Métropole Méditerranée, où la règle de deux jours de télétravail pour tous est loin d’être mise en œuvre.
Tout et son contraire concernant le télétravail
Le management à la française, fondé sur le présentéisme, s’adapte assez mal au télétravail, soulignait l’Apec2 en 2022 : « Le développement du travail hybride a mis les managers en difficulté en brouillant leurs repères et la visibilité dont ils disposent sur l’activité de leur équipe. » Entre la difficulté de maintenir un collectif de travail soudé à distance et les obligations de jongler avec la présence intermittente de certains collaborateurs et de veiller à l’isolement des autres, le télétravail n’a pas fini d’interroger les pratiques managériales. Mais aucune étude n’a permis, à ce jour, de mesurer l’impact réel du télétravail sur la productivité. Les recherches à ce sujet disent tout et son contraire. Est-ce que l’on perd, est-ce que l’on gagne ?
Après avoir recensé plusieurs évaluations antagoniques, l’Insee a conclu que les effets du télétravail sur la productivité sont positifs « dès lors que cette forme de travail suscite à la fois l’adhésion des travailleurs concernés et celle du management, que l’ensemble des acteurs sont préparés et formés à ce mode d’organisation, et que le matériel et l’environnement de travail à domicile sont appropriés »3. En outre, toutes les études mettent en avant que l’autonomie laissée au télétravailleur quant au choix du lieu de travail et de l’organisation entre vie professionnelle et vie personnelle est source d’une plus grande motivation, à laquelle s’ajoute une moindre fatigue liée à l’économie du temps de transport.
Comme le préconisait, dès novembre 2020, l’accord national interprofessionnel relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail, les renégociations actuelles doivent donc nécessairement considérer l’impact du télétravail sur la qualité du travail et la qualité de vie au travail.
Licencier à (très) peu de frais
Selon les organisations syndicales, les véritables raisons des restrictions en matière de télétravail sont bien souvent autres qu’un besoin d’améliorer la performance de l’entreprise, un souci d’égalité entre les salariés éligibles et ceux qui ne le sont pas ou encore la défense de l’intérêt collectif. Alors que le télétravail est devenu la norme dans les domaines de l’informatique, de l’ingénierie, du conseil, des banques et assurances et de la communication (secteurs dans lesquels 79 % des cadres télétravaillent régulièrement), sa remise en cause peut parfois tout simplement servir à pousser les salariés dehors… sans que l’entreprise ait à débourser le moindre euro pour les licencier. Près d’un cadre sur deux affirmait qu’il serait prêt à quitter l’entreprise en cas de suppression du télétravail, relevait l’Apec en mars 2025 : une aubaine dont se servirait la direction de JCDecaux, d’après Foued Maazouza, qui évoque un climat social délétère, beaucoup de licenciements et de démissions.
Ce point de vue s’avère partagé par Khalid Bel-Hadaoui : la Société Générale ayant économisé environ 23 millions d’euros sur son parc de bureaux grâce à la mise en place du télétravail, ce retour en arrière ne peut se faire que dans des conditions dégradées. « Plus personne ne possède un bureau à soi, et la vraie raison réside dans une politique d’économies de la masse salariale qui ne se cache plus. Les salariés sont contents de télétravailler ; beaucoup se sont d’ailleurs organisés pour cela. C’est tout un écosystème qui va être mis à mal. La négociation d’un accord GEPP4, en cours, vise déjà à réduire le nombre d’emplois support, et nous craignons un PSE sur ces métiers-là. »
Surtout, le délégué national CFDT est inquiet pour le dialogue social. Le télétravail doit rester un sujet de négociation, comme l’ont acté les partenaires sociaux au sortir de la crise sanitaire. Le cadre juridique rappelé par l’ANI du 26 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail précise que ce dernier est mis en place par un accord collectif ou, à défaut, une charte élaborée par l’employeur « après avis du comité social et économique ». Reste que cet ANI, les employeurs n’en voulaient pas… et ils ont réussi à imposer un texte peu contraignant.
Notes :
1. Comité social et économique central.
2. « Télétravail des cadres : entreprises et managers à la recherche de nouveaux équilibres, janvier 2022 ».
3. « Télétravail et productivité avant, pendant et après la pandémie de Covid-19 », revue de l’Insee.
4. Gestion des emplois et des parcours professionnels.
« La Société Générale dénonce l’accord sur le télétravail et provoque la colère des syndicats »
https://www.agefi.fr/news/banque-assurance/les-syndicats-de-la-societe-generale-revendiquent-une-greve-inedite-et-suivie » cmp-ltrk= »Agefi- Lien Article » cmp-ltrk-idx= »1″>Des mouvements plutôt suivis qui n’auront pas poussé la direction de la Société Générale à infléchir sa position. Lors d’une réunion avec les représentants des salariés français vendredi, elle «a informé les organisations syndicales qu’elle dénonçait unilatéralement l’accord de janvier 2021», rapportent la CFDT, la CFTC et la CGT dans un communiqué commun.
Dans ce contexte, les syndicats ont annoncé qu’ils refusaient de reprendre les négociations alors que la direction n’envisagerait de discuter «que sur l’aménagement de l’oukase de Slawomir Krupa», soit un jour maximum de télétravail par semaine «alors que 70% des salariés ont au moins 2 jours de télétravail, y compris 30% à SGRF (https://www.agefi.fr/news/banque-assurance/la-societe-generale-deploie-sa-nouvelle-marque-sg-dans-son-reseau » cmp-ltrk= »Agefi- Lien Article » cmp-ltrk-idx= »2″>le réseau SG en France, ndlr)».
Poursuite de la mobilisation
Ils exigent à l’inverse «l’application stricte de l’accord qui permet (Art 10) de réunir une commission d’accompagnement et d’application pour examiner, sur la base de réels indicateurs, les éventuels dysfonctionnements que la DG aurait recensés pour motiver sa décision». L’intersyndicale indique avoir claqué la porte de la réunion avec la direction et prévient «qu’elle appelait les salariés à amplifier le mouvement de contestation». Elle se réunira prochainement pour définir les suites qui lui seront données.
A moins d’une mobilisation forte capable de faire plier les dirigeants, les syndicats ne disposent pas d’autres leviers pour empêcher cette révision de la politique concernant le télétravail qui pourrait légalement être mise en place dans un délai de 15 mois.
Contactée par L’Agefi, la Société Générale confirme la dénonciation de l’accord sur le télétravail mais ne fait pas d’autres commentaires. Dans une communication interne, le groupe s’est par ailleurs engagé auprès des salariés à ce que la nouvelle politique de télétravail ne soit pas mise en oeuvre avant septembre 2026 quelle que soit l’issue des négociations.
« Les infos du 4 Juillet 2025 : Télétravail, la dénonciation … basée sur une simple croyance »
LA DÉNONCIATION
Il aura donc fallu attendre 15 jours après le mail explosif de Slawomir Krupa pour que les représentants de la direction daignent enfin recevoir les organisations syndicales françaises sur le sujet du télétravail. Le temps de laisser les managers et les RH se débrouiller face à la colère de leurs collègues et au casse-tête de cette injonction inopinée, mais peut-être aussi de préparer le numéro de duettistes avec le SNB au sujet de l’application de l’accord actuel jusqu’à l’expiration du délai légal de 15 mois imposé après sa dénonciation. Car le SNB, pourtant présent uniquement en distanciel à cette réunion, a montré qu’il était disposé à négocier les modalités de mise en œuvre d’un retour sur site d’au moins 4 jours par semaine à compter de la rentrée 2026. C’est exactement la ligne proposée par la direction, pour une pseudo « négociation » qui se déroulerait après l’officialisation de la dénonciation de l’accord d’entreprise (prévue aujourd’hui). Cela a été refusé en bloc par l’intersyndicale CGT-CFDT-CFTC, qui a condamné le mépris affiché envers les salariés par la direction générale, sa destruction méthodique de tout dialogue social et la faiblesse insigne des arguments avancés pour justifier l’oukase énoncé par Slawomir Krupa.
SUR LA BASE DE LA CROYANCE
Au-delà même de la forme prise par cette décision, c’est le fond qui pose problème. D’après nos interlocuteurs, la direction générale a l’intime conviction, « à l’échelle mondiale« , que le télétravail au rythme de 2 ou 3 jours par semaine n’est pas une forme d’organisation « pérenne et durable en termes d’efficacité collective ». Pourquoi ? Le directeur des relations sociales a d’abord avancé un point nébuleux sur le nécessaire alignement des rythmes de travail du front-office et des autres fonctions, sans jamais en expliquer la raison. Un autre point serait que la «sociabilisation professionnelle» serait insuffisante, engendrant une attitude «plus réactive que proactive» des salariés. Sur quelles bases s’appuie-t-il pour avancer cela ? Mystère… d’autant qu’un article des consultants préférés de la direction prend le contre-pied de ces affirmations et conclut que c’est le travail hybride (2-3 jours de télétravail hebdomadaires) qui offre le meilleur équilibre en termes d’engagement et d’efficacité (cf. Mc Kinsey and RTO (Return to The Office). C’est pour cela que l’intersyndicale a demandé l’application de l’accord actuel, dont l’article 10 prévoit expressément que ce genre d’évaluation doit être menée dans le cadre de la Commission d’accompagnement et d’application ad hoc. Ce sera aussi l’occasion de rappeler une nouvelle fois à la direction que l’accord de janvier 2021 avait été le fruit de longues discussions sur la meilleure façon d’organiser le travail sur le long terme afin de conjuguer efficacité pour l’entreprise et épanouissement personnel des salariés. Pour ce faire, une grande latitude avait été laissée aux BU/SU pour s’organiser en fonction de la nature des tâches relevant de leur périmètre. Nous maintenons que c’est la bonne approche que de faire confiance en l’intelligence collective de chaque entité plutôt que de revenir à une uniformisation sous contrainte. En attendant, l’intersyndicale CGT-CFDT-CFTC refuse toute discussion sur le sujet du télétravail avec la direction si cette dernière persiste à n’envisager que des «aménagements» au cas par cas ou provisoires au diktat du 1 jour maximum à compter de l’automne 2026. Nous avons rappelé avec force qu’un accord devait concerner tous les salariés et ne pas constituer une régression par rapport à la situation actuelle. Nous rappelons également que la règle définie par l’accord de 2021 doit s’appliquer à minima jusqu’en octobre 2026. C’est la loi, et pas une «victoire» du SNB. Tout manager zélé qui l’oublierait s’exposerait à de graves ennuis, ce dont la direction a bien été obligée de convenir. Cela nous laisse donc 15 mois pour faire fléchir la direction avec votre soutien, la mobilisation continue !
(Options est la revue de l’UGICT CGT-ingé-cadres-technicien-nes)
« Télétravail : gare aux risques psychosociaux »
Perte du lien avec les collègues, malentendus avec la hiérarchie, reporting envahissant, hyperconnectivité épuisante… C’est le revers de la médaille du distanciel.
Loin des yeux, loin du « cœur »
Le chercheur nous éclaire, dans un premier temps, sur les effets du distanciel, qui « entrave la communication entre les salariés et leur hiérarchie, réduit les échanges et limite le partage d’informations essentielles au bon déroulement des tâches. Les équipes risquent de ne pas avoir une vision complète des attentes ». On peut en éprouver du doute et de l’incertitude.
S’ajoutent à cela les malentendus et l’allongement des échanges, induits par une communication essentiellement écrite et privée des nuances et émotions qui « lubrifient » les relations humaines de visu.
Le travail à distance, c’est aussi le risque d’une pression accrue liée au reporting, ou encore aux procédés de « rationalisation de l’activité » – définition de tâches précises, suivi de l’activité, vérification, surveillance… Enfin, à plus long terme, souligne l’auteur de la note, le télétravail « n’est pas sans risque pour la carrière. Les opportunités de formation, d’avancement et même l’accès à des primes peuvent être limités en raison de cette séparation » physique.
Collectif éclaté et isolement
Le « travail hybride » – c’est-à-dire l’alternance présentiel-distanciel – complique la planification individuelle et collective des tâches et requiert une anticipation accrue, pas toujours compatible avec les imprévus. Il peut également complexifier, voire rigidifier les interactions et les réunions, accroître les tensions et problèmes de communication entre celles et ceux qui travaillent à distance et sur site.
Les interactions informelles dans l’entreprise, rappelle Louis-Alexandre Erb, « jouent un rôle important dans la cohésion d’équipe, favorisant la convivialité, l’échange d’idées ». Leur absence « conduit à un manque de liens sociaux et dégrade le sentiment de bien-être ». Sans compter que la « solitude prolongée entraîne un sentiment de déconnexion sociale, une réduction des occasions de socialisation » et, au final, «une diminution du bien-être émotionnel ».
Enfin, du point de vue syndical, le télétravail n’est pas sans conséquences. Les rares études qui s’y sont intéressées notent qu’il ne réduit pas vraiment l’implication, mais qu’il affaiblit le lien entre les élus et l’ensemble des salariés, la compréhension de leur vécu, le relais de leur expression dans les instances de représentation du personnel.
Un étirement du travail dans la semaine
Dans un deuxième temps, la synthèse de la Dares s’intéresse aux conséquences du distanciel sur l’intensité du travail. Dans les études, la majorité des individus interrogés louent l’opportunité d’une meilleure concentration, sans interruption, couplée à une plus grande autonomie d’organisation. Ils n’évoquent pas précisément l’intensification de leur travail. Mais dans les faits, plusieurs facteurs de risque de surcharge professionnelle existent, à commencer par l’augmentation du temps de travail.
Selon certaines études, les journées débutent plus tôt ou se terminent plus tard grâce à l’économie des temps de trajet ; d’autres jugent que c’est sans effet. Les télétravailleurs ont tendance à rogner sur leurs pauses-déjeuner. La synthèse évoque aussi un phénomène propre au travail à distance, qui consiste à en faire plus pour prouver son engagement professionnel (mécanisme de redevabilité), y compris en travaillant pendant un arrêt maladie.
Cela contribue à l’élargissement de l’amplitude horaire et, en conséquence, à la confusion des sphères privées et professionnelles. Ce risque est renforcé par le recours à des horaires décalés pour s’adapter à l’environnement domestique : attendre les moments calmes et/ou mieux gérer ses contraintes domestiques. « Travailler tôt le matin ou tard le soir devient alors une stratégie organisationnelle », résume l’étude, qui évoque aussi la propension au travail le week-end.
Hyperconnectivité et brouillage des frontières
L’abus des outils numériques de communication peut dériver en une hyperconnectivité qui efface la frontière entre sphères privée et professionnelle, et empêche le nécessaire repos physique et mental. Cette hyperconnectivité confronte les salariés à un flux continu de messages et d’informations diverses qu’il devient ardu de gérer et de hiérarchiser. Les télétravailleurs sont alors en situation de subir de la « télépression », en se sentant obligé de « répondre rapidement aux sollicitations » ce qui engendre « des sentiments négatifs tels que l’insatisfaction et l’irritabilité ».
Entre l’élargissement des amplitudes horaires et l’hyperconnectivité, l’interpénétration des sphères domestique et professionnelle pose un défi majeur aux télétravailleurs. Même si, là encore, il n’est question que de risque et non d’une réalité vécue par tous et toutes, la Dares indique que « la fragmentation des horaires perturbe le rythme naturel de la journée, disperse l’attention et rend difficile la planification des activités personnelles en dehors du travail », ce qui peut attiser tensions et conflits dans les foyers.
Réassignation des femmes aux tâches ménagères
Inversement, les tâches ménagères et familiales peuvent empiéter sur la sphère professionnelle. Et de ce point de vue, insiste Louis-Alexandre Erb, les hommes et les femmes – notamment les mères – ne sont pas égaux. Ces dernières se retrouvent « plus souvent confrontées à des conflits entre vie professionnelle et familiale, consacrant plus de temps au travail en dehors des horaires habituels ».
L’auteur note aussi que la flexibilité s’amenuise lorsque les responsabilités familiales sont plus fortes, avec des enfants en bas âge ou des personnes dépendantes à charge. Au final, « cumulant travail rémunéré et travail domestique, les télétravailleuses effectuent plus d’heures de travail que les hommes ». Et de conclure : « la réassignation des femmes aux tâches domestiques constitue un risque majeur dans le cadre du télétravail ». On peut « souhaiter télétravailler pour mieux gérer le travail domestique et, au final, se retrouver dans une situation où il s’impose d’avantage ».
- Louis-Alexandre Erb, « Les risques psychosociaux associés au développement du télétravail », Recherche en bref n°1, 27 mars 2025.