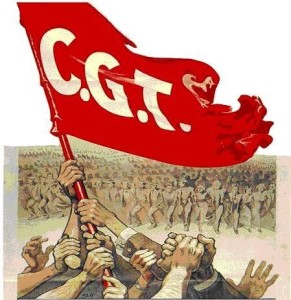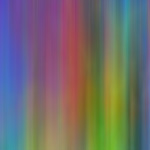La CGT a demandé à Jean-Marie Pernot de rappeler lors des sessions d’été du CCN 2025 la façon dont la CGT a, dans l’histoire, appréhendé les questions de sa propre structuration. Nous reproduisons ici, avec l’accord de la CGT, son intervention dont il nous a semblé qu’elle pouvait intéresser au-delà de son objet initial.
Les problèmes de structuration syndicale de la CGT, un bref retour historique
Jean-Marie Pernot
Depuis ses origines, la CGT a rencontré à plusieurs reprises la nécessité d’adapter ses structures, de modifier ses modes d’organisation. On rappellera quelques-uns de ces moments, de manière naturellement assez schématique en s’attardant sur la période des origines, celle où la CGT a dû gérer sa propre constitution comme confédération et faire face, dans le même temps, à une transformation profonde du monde du travail ; on évoquera rapidement quelques autres séquences jusqu’à la période contemporaine qui a vu, en trois ou quatre décennies, un changement radical des conditions de l’action syndicale.
Deux remarques préalables :
- Ce détour par l’histoire révèle un étrange paradoxe : dans des contextes parfois très difficiles, la CGT a su modifier ses structures et transformer en profondeur ses modes d’organisation. Elle n’y parvient plus au cours de la période la plus récente. Alors que de nombreux débats ont eu lieu depuis une trentaine d’années, à partir de constats difficiles à récuser, que parfois certaines décisions ont été prises, des engagements votés en congrès confédéral, les mises en œuvre ont été sans cesse différées voire enterrées.
- Les questions de structuration sont dépourvues d’attraits : nombre de militants et de responsables ont beaucoup plus d’appétence pour les questions idéologiques, stratégiques, la référence aux grandes valeurs et, bien sûr, tout ceci a de l’importance. Dans l’évocation de « l’identité » de la CGT, ce sont ces rappels qui sont mobilisés : le reste, la façon de s’organiser, relève un peu de l’intendance et, c’est bien connu, l’intendance suivra… Maxime Leroy, juriste et sociologue du début du XX° siècle et ami du syndicalisme, attribue une grande importance à ces questions dans son maitre-ouvrage, La coutume ouvrière (paru en 1913) : il voit dans les dispositions pratiques prises par les syndicats pour « découper le monde social » (les partitions du syndicalisme) un indice et un reflet de leur capacité à se rendre adéquats à leurs objectifs. Pour faire simple, il s’agit de dire que sans les moyens d’organisation adaptés, les grandes ambitions et les grandes affirmations stratégiques ne sont que des discours.
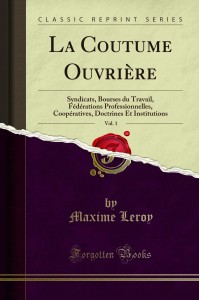 Ci-contre : Maxime Leroy: La coutume ouvrière (1913)
Ci-contre : Maxime Leroy: La coutume ouvrière (1913)
Faut-il préciser le sens de cette adaptation ? Michel Warcholak, secrétaire à l’organisation au sein du Bureau confédéral entre 1975 et 1982, a coordonné en 1980 un important rapport sur l’évolution des structures qu’il justifiait par « La nécessité de nous adapter comme la CGT a su le faire à chaque étape de son histoire »[1]. Naturellement, il ne s’agissait pas, pas plus hier qu’aujourd’hui, de s’adapter aux mutations du capitalisme pour mieux s’y fondre mais au contraire pour mieux le combattre. L’enjeu pour la CGT a toujours été de redéployer ses forces pour s’adapter aux conditions changeantes de la lutte impliquées par les transformations du capitalisme. J’ai parfois évoqué l’idée qu’on ne part pas à l’assaut des puissants avec un sabre de bois : il faut un outil syndical efficace, adapté aux conditions actuelles de la lutte des classes, actuelles, c’est-à-dire pas celles d’hier ou d’avant-hier. La luttes des classes est aussi et peut-être d’abord une guerre de mouvement, sera très vite dépassé celui qui se contente de mener une guerre de positions. La CGT doit réintroduire du mouvement dans la façon dont elle organise ses moyens et ses ressources.
Les premiers pas compliqués de la jeune CGT
La CGT se constitue, comme chacun sait, en 1895 : c’est alors un patchwork d’organisations préexistantes, certaines ayant appartenu à la Fédération nationale des syndicats (FNS), d’autres relevant de Bourses du travail, d’autres encore trouvant pour la première fois un lieu de regroupement ; elle mêle des fédérations de métiers, des syndicats isolés et quelques fédérations d’industrie mais la forme dominante en cette fin de XIXe siècle est le syndicat de métier. Le métier est ce par quoi les travailleurs se reconnaissent socialement : c’est la base de leur identité sociale et de leurs solidarités ; c’est à travers la référence au métier que s’organisent la résistance ouvrière, la négociation du tarif (le salaire), la base du premier mutuellisme. Le métier est donc « naturellement » la première base d’organisation des Chambres syndicales. Le niveau local et le métier sont à l’époque les premières « communautés pertinentes d’action collective »[2].
La mise en forme de la confédération se fait donc dans un contexte de grande dispersion où domine l’organisation par métier. Mais pour ajouter à la complexité de la tâche, cette époque est aussi celle d’une grande transformation de l’organisation du travail qui voit le passage de la manufacture à l’industrie[3]. Disons pour faire très vite que l’entreprise n’est pas une entité anhistorique, elle connaît à cette époque une première mutation due à l’introduction du machinisme. Jusque-là, les ouvriers de métiers travaillent côte à côte dans la manufacture mais accomplissent les mêmes gestes professionnels. La transformation du travail se donne à voir lorsque leurs activités se combinent et se recomposent. Emile Durkheim, le grand sociologue de cette période, saisit cette mutation et, dans un ouvrage célèbre, paru en 1893, il évoque le passage de ce qu’il appelle la solidarité « mécanique » (chacun travaille de son côté) à la solidarité « organique » (chacun travaille avec tous)[4]. Progressivement, après que l’atelier a cédé la place à la manufacture, celle-ci devient l’entreprise moderne au tournant du XXe siècle.
En pleine période de mise en forme de la confédération, la CGT perçoit cette évolution et ses effets sur ses propres modes d’action. Lors du congrès de 1900 (Paris), Victor Griffuelhes (qui devient secrétaire général de la CGT l’année suivante) établit le constat suivant : « Jusqu’à l’avènement du machinisme, le métier a eu une définition particulière ; aujourd’hui, par le progrès du machinisme, le mot métier dans sa définition même s’est transformé. Le machinisme en créant la division du travail, a fait que le produit qui autrefois était créé par un seul ouvrier, est aujourd’hui le résultat du travail de plusieurs. (…) Il est certain que si tout se transforme, les moyens de lutte doivent également se transformer »[5].
Ce constat se traduit en un patient – et parfois tourmenté – processus de re-conformation des fédérations, non plus sur le modèle de la fédération de métier mais sur celui de la fédération d’industrie. Le congrès d’Amiens (1906), connu pour d’autres raisons, adopte une résolution qui indique que la CGT n’acceptera plus d’adhésion de fédérations de métiers, celles-ci étant conviées à se rapprocher (ou à créer) des fédérations industrielles de leur champ d’activité. L’exemple type – et la première à accomplir sa transformation (1907) – est la fédération du bâtiment qui voit la fusion des syndicats de métiers préexistants : syndicats des maçons, des plâtriers, des peintres, charpentiers, couvreurs, etc. Accomplissant des tâches différentes, ils ont le même employeur et concourent à la production d’un même produit. Cela paraît naturel aujourd’hui, ça ne l’est pas du tout à l’époque. La confédération est très impliquée dans ce processus, elle aide et impulse car les fédérations ont du mal parfois à trouver les nouveaux arrangements qui permettent de « faire organisation ». Alors que la CGT compte 68 fédérations, 38 d’entre elles ont accompli leur transformation en 1914. Certaines d’entre elles, à commencer par la fédération de la métallurgie, connaissent des crises qui freinent le processus. Naturellement, une telle transformation ne convient pas à tout le monde : dans la fédération des métaux par exemple, les mécaniciens (l’aristocratie ouvrière, dira-t-on plus tard) entendent mal faire partie de la même fédération que les ajusteurs, tourneurs et autres travailleurs dont la qualification est moindre que la leur. Philippe D’Iribarne évoque la « logique de l’honneur » qui traverse le monde du travail[6], elle rend compliquée la tâche de rassemblement des travailleurs. Car il y a des hiérarchies au sein du monde ouvrier, parfois implicites mais parfois aussi très explicites et le « mélange des genres » n’est pas toujours admis. Dans certains champs professionnels, la tension ira jusqu’au maintien de syndicats de métiers indépendants, l’exemple le plus fameux et le plus durable étant celui des conducteurs de locomotives, qui entrent en gare en chapeau claque aux commandes de leurs machines à vapeur et qui n’entendent pas « faire syndicat » avec ceux qui posent le ballast sur les voies. La situation a perduré assez longtemps avec la FGAAC (Fédération générale autonome des agents de conduite) qui tiendra jusqu’en 2008 un statut autonome par suite de ce refus plusieurs fois renouvelé de « mélanger les torchons et les serviettes »[7].
Le syndicalisme de masse et de classe
Après une période de désaffection (scission, crise économique…), la CGT connaît un nouvel essor dans les années trente, en particulier après 1934 : une période très politique qui voit la montée de l’extrême droite et la constitution du « Rassemblement populaire » avec, dans le champ syndical, un processus d’unification entre les deux CGT séparées depuis 1921. La victoire du Front populaire lors des élections de 1936 s’accompagne d’un grand mouvement de grève et d’un bond en avant de la syndicalisation qui voit la CGT multiplier le nombre de ses bases par 4, atteindre 3,7 millions d’adhérents, la seule fédération de la métallurgie organisant désormais près de 800 000 travailleurs. Les années 20 et 30 sont les moments de croissance très importante de la grande industrie, l’arrivée des méthodes tayloriennes et la production en grande série rassemblant de grandes masses d’ouvriers qualifiés et non qualifiés. Le capitalisme français acquiert une nouvelle dimension. La CGT sait alors réorganiser son syndicalisme pour devenir le creuset de cette alliance entre ouvriers qualifiés (qui disposent vis-à-vis de l’employeur de la capacité à négocier) et les non-qualifiés qui ont avec eux le nombre. Cette alliance, forgé dans le travail et dans les grèves, permet les avancées de 1936 bien connues (40 heures, Congés payés, Conventions collectives, Délégués du personnel, etc.) et permet aussi à la CGT de changer de dimension. Mais elle n’acquiert ce rayonnement qu’au prix d’une politique d’organisation qui s’appuie sur les syndicats locaux et les Unions locales. Il n’existe pas alors de droit syndical à l’entreprise, le développement est affaire des structures de proximité extérieures à celle-ci, ce qui restera d’ailleurs le cas jusqu’à la reconnaissance de la section syndicale d’entreprise (SSE) en 1968 et les droits attribués au délégué syndical.
C’est dans ces années trente et ce contexte exceptionnel que Benoît Frachon, ancien secrétaire général de la CGTU et co-secrétaire général de la CGT, met en avant la notion de « syndicalisme de masse et de classe ». Pour lui, et il y reviendra tout au long de son long magistère, les deux termes sont indissociables, le syndicalisme CGT n’acquiert son caractère de classe que fondu dans le syndicalisme de masse. Il n’est pas d’abord de classe puis de masse (ou l’inverse), il est indissociablement les deux à la fois. On peut ajouter que la classe n’est pas une addition de catégories socio-professionnelles (CSP), à l’époque ouvriers qualifiés et non qualifiés mais aussi d’autres professions que l’on aurait classées aujourd’hui parmi les ICTAM ; c’est un mouvement tiré par une conscience politique ou, à tout le moins, par un désir d’émancipation sociale. C’est en devenant une organisation de masse que la CGT peut valablement conduire une lutte de classes et, ce faisant, constituer la classe qu’elle se propose de représenter. Mais c’est un sujet un peu plus compliqué qui mériterait d’autres développements. Cette période montre en tous cas une capacité manifeste à mettre en accord ses structures avec la dynamique d’un salariat en pleine croissance et en pleine mutation sociologique.
Cette adéquation se poursuit dans l’après-guerre et, en gros, jusqu’à la fin des années 1970. Après une période difficile (guerre froide, guerres coloniales, divisions syndicales, etc.), les années 1960 connaissent une nouvelle dynamique dont l’acmé se révèle, bien sûr, en 1968 dans un mouvement social qui renoue, dans un autre contexte, avec les rapports de force de 1936. Il est d’usage de désigner comme « les années 68 » celles qui commencent un peu avant et courent jusqu’à la fin des années 1970. Au cours de cette période et comme le rappelle le rapport Warcholak, le développement reste une affaire locale, syndicats locaux et unions locales sont le foyer de la politique de présence et de développement, l’institutionnalisation des délégués syndicaux ne porte pas atteinte à la vie syndicale, tout au contraire. Un débat ancien est réactivé autour des catégories d’encadrement, débat qui aura de beaux jours devant lui. Par tâtonnement et au prix de quelques tensions, la CGT cherche à organiser ces catégories en pleine croissance, comme elle le tentera plus tard avec une autre catégorie en croissance, les « privés d’emploi » !
La grande transformation, c’est celle de la décennie suivante, celle des années 1980.
La décennie, le grand cauchemar des années 80
C’est le titre d’un ouvrage du politiste François Cusset, écrit en 2005 ; il n’a pas un mot sur le syndicalisme mais sa grille de lecture peut s’y adapter en tous points. Comme tous les grands changements, ceux qui s’opèrent à cette période empruntent à divers registres qui interagissent les uns avec les autres. La période connaît un contexte politique très particulier avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 et une importante transformation du capitalisme français.
Les lois Auroux de 1982 ouvrent une nouvelle séquence dans la continuité de la reconnaissance de la SSE en 1968. Elle institutionnalise une « négociation annuelle obligatoire » sur les salaires, aussitôt dénoncée par le CNPF comme l’instauration de « soviets partout » (sic). Peu à peu, la négociation annuelle s’étend à d’autres thèmes (égalité professionnelle, épargne salariale, etc.), avec d’autres temporalités (annuelle, tous les deux ans, etc.). La contraction brutale des effectifs syndiqués et militants conduisent à un rétrécissement des pratiques de proximité et l’enfermement progressif des équipes syndicales dans l’institutionnel. Ce processus d’assignation à l’entreprise, bien connu et largement documenté par les chercheurs (et les syndicalistes eux-mêmes) et qui prendra une dimension caricaturale dans les années 2000, est, à cette époque, nourri par les choix des deux grandes confédérations. La CFDT fait de la négociation annuelle obligatoire l’alpha et l’oméga de sa stratégie : seul ce qui est négociable dans l’entreprise permettrait, selon elle, d’établir la légitimité du syndicat. Et la direction de la CGT, qui enregistre la chute catastrophique des effectifs (même si elle ne la rend pas publique), exhorte les syndicats à replonger dans l’entreprise pour retrouver le contact avec les travailleurs.
Il faut ajouter à cela un choix politique opéré dans certaines fédérations, choix qui a trait à l’analyse de la période. L’arrivée de la gauche au pouvoir devait aiguiser l’affrontement de classe et, à l’ère du capitalisme monopoliste d’État (CME) théorisée par la section économique du PCF, l’affrontement le plus aigu devait avoir lieu dans les plus grands monopoles capitalistes. Un choix a donc été fait de concentrer les forces là où l’affrontement serait le plus aigu. Ce choix a conduit de fait à délaisser les petites implantations, en particulier dans la métallurgie, dans l’aire des USTM (Union syndicale des travailleurs de la métallurgie) qui agissaient alors un peu comme des syndicats locaux. Cette clôture sur l’entreprise (la grande) est donc aussi, par certains aspects, un choix des organisations.
Ce processus est évidemment stimulé par un patronat qui a compris les usages profitables qu’il pouvait faire d’une négociation dont il détient tous les leviers. Il s’opère en même temps qu’une double transformation extrêmement rapide du tissu économique dans deux directions complémentaires : d’une part l’éclatement de l’entreprise en tant que « travailleur collectif » ; d’autre part une extension sans équivalent dans les autres pays de la sous-traitance et de l’externalisation.
L’entreprise, travailleur collectif ou nœud de contrats commerciaux
Il y trente ans une question simple appelait une réponse simple : qui le syndicat « représente-t’il » dans l’entreprise ? Réponse : les travailleurs de l’entreprise. La réponse aujourd’hui appelle la nuance. Quand il négocie et même quand il mobilise, le syndicat représente le plus souvent les travailleurs en CDI dont le contrat de travail est lié à l’employeur principal du site. Il conduit sa négociation annuelle obligatoire et parfois il mobilise au nom et pour ceux qui ont accès au restaurant, au parking, aux vestiaires, aux activités sociales et culturelles du CSE, bref, à la partie dite « stable » du salariat, même si elle ne l’est pas toujours (voire les luttes pour la défense des emplois). N’entrent pas dans son aire les CDD (8 millions de travailleurs et travailleuses pour 27 millions d’actifs), les intérimaires (7 à 800 000), les nombreux prestataires et autres apprentis, alternants, travailleurs en régie, en portage salarial, toutes les variantes de l’emploi crées par l’imagination débridée de RH « agiles », prompts à utiliser toutes les formes d’emplois flexibles mises à leur disposition par les gouvernements depuis trente à quarante ans. Le syndicat s’appuie dans son action sur une partie parfois minoritaire au sein du personnel, ce qui pose tout de même un problème à un syndicalisme « de classe », laquelle classe transcende en principe les statuts d’emploi.
Le deuxième vecteur de transformation est le formidable mouvement d’externalisation et de sous-traitance qui a affecté la répartition du travail dans le nouveau capitalisme : en 2017, et ça ne s’est pas arrangé depuis, 86 % des entreprises de plus de 10 salariés se trouvaient dans un rapport de sous-traitance, soit comme donneur d’ordre (DO) soit comme sous-traitant (STT), soit et c’est le cas le plus fréquent, les deux à la fois. Ce constat imposant traduit l’existence d’une sous-traitance en cascade. C’est un mode d’organisation qui n’est pas nouveau, qui connait des formes très différentes (sous-traitance de capacité, de missions, etc.) mais qui a connu une explosion telle qu’elle n’est plus un mode de gestion parmi d’autres mais un principe d’organisation de l’activité, étendu bien au-delà de l’industrie où il a pris naissance. Et la sous-traitance en France a la particularité d’être organisée de sorte de drainer la totalité (ou presque) du profit vers le sommet de la chaine de valeur. Le principe de base est que le DO maltraite son sous-traitant, lequel reproduira ce rapport avec ses propres sous-traitants. Le tout pour alimenter la machine à produire du cash pour les actionnaires de l’entreprise du sommet de la chaine de valeur. Petite question en passant : comment s’assurer qu’une amélioration obtenue là où se trouve le syndicat (plutôt vers le haut de la chaine de valeur) ne se répercute pas en un surcroît d’exploitation de la sous-traitance, c’est-à-dire des travailleurs de la sous-traitance ? Question subsidiaire : le patron maltraité qui explique à ses salariés qu’il ne peut pas les augmenter de peur de perdre le marché, est-il toujours un menteur ? les tensions extrêmement fortes entre PME et grosses boîtes à l’intérieur du syndicalisme patronal est le reflet de cette tension.
 Ci-contre : « La Lutte est belle » : un album de chants pour les 130 ans de la CGT
Ci-contre : « La Lutte est belle » : un album de chants pour les 130 ans de la CGT
Le syndicat a historiquement un rôle inclusif des travailleurs et des travailleuses : il les organise afin de défendre leurs intérêts immédiats et de faire advenir dans les consciences un « désir d’émancipation », moteur de la lutte des classes. La fabrication des revendications, l’action collective et la négociation collective sont autant de moyens de constitution de la « classe ». Externalisation et sous-traitance redessinent le travailleur collectif au-delà des frontières devenues poreuses de l’entreprise. Le capitalisme qui a d’abord concentré les travailleurs sur le même lieu de travail, opère le chemin inverse, il pulvérise les collectifs de travail, détruit les communautés, organise même leur opposition à travers une multiplicité de statuts où domine la précarité.
Le syndicalisme et la CGT en particulier, parce qu’elle se veut de masse et de classe, peut-il se satisfaire, même en luttant, d’accompagner par défaut de structures adéquates la défaisance du salariat et sa propre désagrégation ? Ce serait une variante du syndicalisme d’accompagnement que la CGT dit récuser par ailleurs. C’est tout l’enjeu des questions dites de structuration que la CGT ne peut plus différer sauf à se trahir elle-même.
[1] Rapport Warcholak, « Les structures confédérales, projet soumis à la discussion des organisations confédérées », Le Peuple, n° 1089 du 1er au 15 août 1980.
[2] D. Segestin, 1980, « Les communautés pertinentes d’action collectives », in Revue française de Sociologie, Paris, Vol 21, n°2, p 171-203.
[3] Ce point est développé dans : JM Pernot, 2022, Le syndicalisme d’après – Ce qui ne peut plus durer, Bordeaux, éditions du Détour.
[4] E. Durkheim, 1893, De la division du travail social, Paris, Alcan éditeurs.
[5] CGT, compte rendu du congrès confédéral, cité dans le rapport Warcholak, 1980.
[6] P. D’Iribarne, 1993, La logique de l’honneur, Gestion des entreprise et traditions nationales, Paris, éditions Points, Coll. essai.
[7] La FGAAC a adhéré à la FGTE-CFDT en 2008 pour préserver son statut d’organisation représentative. Elle a négocié un statut de syndicat national totalement dérogatoire aux règles ordinaires de la CFDT.