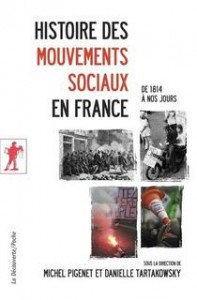Le 19 avril, Théo Roumier, militant syndical, publiait sur Médiapart un article intitulé : « Et le Premier mai? Pour un retour de la question sociale« . Cet article a été publié dans Syndicollectif le 20 avril. L’article ci-dessous (« Autonomie sociale et place du « politique ») engage un débat sur le même sujet.
- Reprise de l’article de Théo Roumier :https://blogs.mediapart.fr/theo-roumier/blog/170417/et-le-premier-mai-pour-un-retour-la-question-sociale
- Autonomie sociale et place du « politique »
L’article de Théo Roumier paru sur le blog de Médiapart le 19 avril relance de manière claire le débat sur « l’autonomie du mouvement social » et la manière de le poser efficacement en période de grande confrontation politique, et notamment en période électorale.
Il explique qu’il y a « deux manières » d’intervenir pour les mouvements sociaux (terminologie générale qui bien sûr renvoie à des formes très diverses : syndicalisme, associations, luttes…) en période électorale, afin de faire entendre leur voix :
- L’interpellation est la méthode assez couramment pratiquée : s’adresser aux candidat-es pour qu’ils-elles se positionnent sur ce qu’expriment les luttes.
- L’autonomie d’action des mouvements dans le but que leur forme d’expression (« ce que construisent nos luttes », dit l’article) acquiert une puissance telle qu’elle soit entendue dans le concert institutionnel.
Or il me semble qu’il n’y a pas deux, mais trois formes d’intervention possible, et je voudrais tenter de l’expliquer.
D’abord, Théo Roumier a raison de rappeler, comme un « ami » le lui disait, qu’on peut certes douter fortement du « bon » résultat d’une élection, mais qu’il peut aussi en sortir « le pire ». Et donc l’hypothèse Le Pen n’est pas exclue, ni celle d’une droite dure (Fillon) ou habile (Macron). Ce n’est pas rien parce qu’une élection est toujours le reflet, certes déformé, de ce qui se passe en profondeur dans une société. Et le conflit politique qu’elle déclenche avant son résultat (et après) détermine la manière dont les enjeux de société, les enjeux sociaux, la manière de parler des droits, etc, déterminent pour longtemps le climat général. Pour le dire autrement, une élection structure le débat idéologique. On se souvient de l’effet terriblement destructeur qu’a produit le quinquennat Sarkozy dans les références populaires (« gagner plus », la notion bourgeoise du « travail », la méritocratie, etc).
En conséquence, même si le mouvement social est à tout moment absolument nécessaire, et qu’il doit bien sûr rester indépendant des pouvoirs, il n’est pas possible de se désintéresser du climat idéologique et politique si on veut susciter des luttes efficaces et gagnantes. Le « politique » est aussi un enjeu de la bataille sociale, parce qu’il réfracte ou exprime des luttes de représentation sur les questions sociales et sur les des droits en général, où les syndicats et mouvements divers peuvent (et devraient) avoir un rôle à jouer.
Le problème n’est donc pas seulement « d’interpeller » et je partage ce que dit l’article sur les limites d’un simple questionnement adressé par exemple aux candidatures. Cela donne trop l’impression d’un partage des tâches : chacun dans son registre, « le social » reste dans son domaine et « le politique » répond aux questions du social.
Mais le problème n’est pas non plus de dire seulement: « autonomie » de nos luttes, même si c’est toujours important. Le problème est bien, comme Théo Roumier le pose à la fin de l’article, de répondre à la question : où faut-il « placer le politique » ? Qui le façonne ? Je suis entièrement d’accord avec l’idée que « le politique » ne peut en aucun cas être par définition placé en « position hiérarchique de supériorité » par rapport au mouvement social. Mais pour que cela ne soit pas le cas, encore faut-il que le mouvement social ne laisse pas la politique aux seuls politiques !
Le mouvement syndical n’est pas uniquement un mouvement de lutte ou de seule résistance. Il a un contenu hautement politique, notamment lorsque les luttes prennent une dimension interprofessionnelle (2016 : loi Travail). Toute la difficulté, j’en conviens, c’est de trouver le moyen pour que cette dimension politique, au sens de projet de société, se confronte aux « politiques », mais cette fois au sens de ceux et celles qui occupent une fonction de représentation générale dans l’espace du pouvoir (le mot « politique a en effet plusieurs sens : projet, pouvoir, représentation).
Si les mouvements sociaux ne se confrontent pas à cette question, alors la séparation mortifère du social et du politique aura de beaux jours devant elle, et avec elle l’idée persistera que le syndicalisme ne représente pas l’intérêt général, mais seulement des intérêts particuliers (certes respectables, etc). Et cette séparation est, d’un côté, un frein pour le succès des luttes sociales les plus emblématiques ou stratégiques (1968, 1995, 2003, 2010, 2016), comme elle est aussi, d’un autre côté, une limite à une pleine expression dans le champ politique, et du pouvoir politique, de projets réellement anticapitalistes et émancipateurs.
On peut formuler ce défi d’une autre manière (voir le chapitre « Amender la Charte d’Amiens », du recueil Nouveau siècle, Nouveau syndicalisme, Syllepse, 2013) en analysant la société bourgeoise capitaliste comme comportant une stabilité historique basée justement sur la séparation de la société civile et de la « société citoyenne », donc le champ de la politique. Cette séparation renvoie à un dédoublement de chaque personne : dédoublement entre citoyen-ne et travailleur-euse. La révolution démocratique (18ème siècle) instaure le droit pour tous et toutes d’avoir un avis sur la politique, et selon les législations elles-mêmes enjeu de luttes (il a fallu un siècle et demi pour que les femmes aient le droit de vote et les étrangers ne l’ont toujours pas…) de peser sur le choix du pouvoir. En même temps, cette citoyenneté égale a longtemps interdit tout droit à l’organisation collective (syndicats).
Tant que cette dichotomie subsistera, le capitalisme échappera au risque de la dislocation. Critiquant les dérives du socialisme gouvernemental, les syndicalistes révolutionnaires (en France) en avaient tiré comme conclusion : le syndicat est lui-même le parti ouvrier, il n’a donc nul besoin de se confronter aux politiques (qui font ce qu’ils veulent !). Mais cette stratégie évacue la puissance du politique comme puissance propre et « autonome », elle aussi. L’intuition géniale et absolument juste de la Charte d’Amiens est bien entendu la « double besogne, quotidienne et d’avenir » (vers l’émancipation « intégrale »). Elle signifie que la lutte produit et contient un « projet » qu’il faut faire advenir. Mais la dynamique sociale, même très forte, ne suffit pas à résoudre la question du pouvoir. Il ne s’agit pas non plus de « s’en remettre » aux partis, qui seraient hiérarchiquement plus « nobles » pour cela, comme le dit très justement Théo Roumier.
La solution réside sans doute dans une co-production stratégique (troisième solution) acceptée et réfléchie, entre les autonomies sociales et les autonomies (ou les spécificités) politiques qui se situent sur le terrain de l’émancipation. Le 20ème siècle a magnifié le pouvoir ultime des partis, notamment à partir de 1917. Notre époque devrait sans doute inventer un espace nouveau où le social et le politique se rencontrent et échangent leurs expériences (y compris des luttes) sur les apports propres dont ils sont porteurs. C’est un moment que nous avons connu partiellement en 2005, lors de la lutte gagnante contre le Traité constitutionnel européen. Ce sont peut-être aussi de telles expériences (non sans conflits) qui se croisent à Barcelone, ou en partie dans les mouvements des places ou encore dans Nuit Debout en France. Vaste chantier.
Jean-Claude Mamet (co-animateur du blog «www.syndicollectif.fr »)