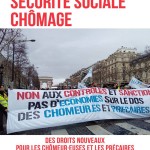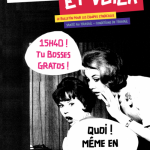La professionnalisation du travail de syndicalisation est répandue dans le monde anglo-saxon. Mais elle est un sujet de controverses en France. Elle peut mettre en question, comme le décrit Karel Yon, l’« ensemble de tâches, généralement négligées dans la définition légitime des rôles syndicaux, que l’on propose d’appeler « travail militant reproductif ». Ce débat est d’autant plus important que le syndicalisme est au pied d’un « mur » : la stagnation.
Karel Yon, sociologue, université Paris Nanterre, directeur adjoint de l’IDHES (Institut et dynamiques historiques de l’économie et la société), pose le débat dans une étude fouillée. Celle-ci commence par mettre en évidence que les ressources du syndicalisme en France ne proviennent que fort peu des cotisations. Sujet brûlant.
Nous donnons accès à l’étude complète et en publions des extraits pour inciter à cliquer.
- Télécharger l’étude : les-resistances-syndicales-au-community-organizing
« Les résistances syndicales au community organizing
Entre rejet de la professionnalisation et déni du travail militant reproductif «
Karel Yon
Intro : « Le community organizing est considéré depuis un quart de siècle comme l’un des principaux vecteurs du renouveau syndical dans le monde anglo-saxon. En France, cependant, cette forme de militantisme professionnel a davantage suscité la défiance que l’adhésion des syndicats. En partant d’une enquête de terrain auprès d’un groupe parasyndical ayant tenté de promouvoir le métier d’organizer, l’article s’interroge sur les raisons de cette défiance. […]… les résistances syndicales au community organizing ne relèvent pas seulement d’une opposition à la professionnalisation du syndicalisme, mais sont aussi révélatrices d’un autre enjeu : celui de la reconnaissance d’un ensemble de tâches, généralement négligées dans la définition légitime des rôles syndicaux, que l’on propose d’appeler « travail militant reproductif ».«
« Le community organizing a, depuis un quart de siècle, pénétré le syndicalisme jusqu’à devenir l’un des principaux vecteurs du renouveau syndical« .
[…]
« Clément Petitjean (2019) définit ainsi les organizers comme des « faiseurs de représentants » qui revendiquent une expertise professionnelle pour mieux se distinguer des simples « activistes ». D’autres ont pointé les paradoxes d’une « professionnalisation de l’auto-organisation » (Talpin, 2016, p. 86) et souligné la contradiction entre l’aspiration égalitaire à l’auto-organisation des dominé·es et le présupposé inégalitaire de la possession d’une expertise spécifique pour rendre cette mobilisation possible (Balazard, 2013).
Une telle lecture consonne aisément avec les travaux français sur le syndicalisme, qui sont depuis longtemps marqués par la problématique, voire la hantise de la professionnalisation du militantisme (Ubbiali, 1997 ; Andolfatto et Labbé, 2006 ; Guillaume et Pochic, 2009 ; Mischi, 2011 ; Thomas, 2017 ; Boulland et Simonpoli 2021). Puisant aux mêmes sources de la critique des oligarchies militantes (Michels, 2015 [1925]) et de la représentation politique (Bourdieu, 1984) et s’inscrivant dans la continuité des analyses menées sur la profession politique (Offerlé, 1999 ; Demazière et Le Lidec, 2014), cette ligne de recherche se concentre sur les effets de clôture sociale et de domination liés à la professionnalisation du travail syndical (Giraud et Gassier, 2020). En partant des acquis de ces travaux, je propose ici d’élargir le regard sur le « travail syndical » (Lhuilier et Meynaud, 2014) en inscrivant l’enjeu de la professionnalisation dans une réflexion plus vaste sur les formes d’organisation et de division du travail militant (Cohen et Dunezat, 2018). Alice Romerio l’a bien montré à partir du cas du Planning familial : les controverses autour de la professionnalisation du travail militant, dans son cas, du travail féministe, donnent l’occasion d’une mise à plat des savoirs, des compétences et des pratiques légitimes qui font exister les collectifs (Romerio, 2022). »
Ainsi : « Les travaux français sur le syndicalisme sont depuis longtemps marqués par la problématique, voire la hantise de la professionnalisation du militantisme« .
[…]
« L’un des ressorts de la professionnalisation, qui participe de la division verticale du travail, consiste notamment dans la délégation du « sale boulot » à des groupes subalternes, plus souvent féminisés (Avril et Ramos Vacca, 2020). Dans quelle mesure l’affirmation du CO correspond-elle à une dynamique de ce type ? En tentant de répondre à cette question, je voudrais montrer que les résistances syndicales au community organizing sont révélatrices d’un autre enjeu : celui de la reconnaissance d’un ensemble de tâches qui sont généralement négligées dans la définition légitime des rôles syndicaux et que je propose d’appeler « travail militant reproductif ». Pour ce faire, je m’appuierai sur une enquête ethnographique menée pendant plusieurs années auprès de collectifs « parasyndicaux »«
(NDLR : Un de ces collectifs « parasyndicaux » est le Réact : Réseau pour l’action collective transnationale, dont Syndicollectif a déjà parlé
« L’expérience la plus aboutie a été menée avec la CNT-SO entre septembre 2016 et octobre 2017, puisqu’elle a pris la forme d’une convention de partenariat entre le syndicat et l’association. Le paradoxe apparent d’organisations qui se revendiquent de l’anarcho-syndicalisme mais acceptent de sous-traiter leur développement à des salarié·es associatif·ves s’explique avant tout par des raisons matérielles : la CNT-SO n’ayant qu’une implantation limitée à quelques secteurs, elle n’atteint pas le seuil électoral lui permettant de prétendre aux financements de la démocratie sociale, à la différence de la plupart des autres organisations syndicales. Ses responsables étaient dès lors beaucoup plus directement intéressés par une méthode que les membres du ReAct présentaient avant tout à l’époque comme un moyen d’accroître le nombre de syndiqué·es, et donc les ressources du syndicat. Quant à la CGT McDonald’s Île- de-France, ces mêmes perspectives en matière de syndicalisation nourrissaient un double espoir : celui de renforcer le poids du syndicat afin de le rendre incontournable au sein de la CGT et de surmonter ainsi les blocages de la fédération, et celui de multiplier les contacts avec les salarié·es afin de nourrir la stratégie du syndicat de faire reconnaître des unités économiques et sociales (UES)« .
[…]
Ainsi : Les cotisations : « entre un quart et un tiers du budget » dans le syndicalisme français…
« Les syndicats français, des employeurs structurellement inachevés:
La pratique du CO (Community organizing) suppose une capacité de salarisation du travail militant qui pose problème aux syndicats français. En cela, ils se distinguent d’autres syndicalismes : aux États-Unis (Milkman et Voss, 2004), en Grande-Bretagne (Heery et al., 2000), en Allemagne (Thomas, 2016) ou en Suisse (Fillieule et al., 2019), des expérimentations s’inspirant du CO ont été accueillies par des orga- nisations syndicales qui leur ont consacré d’importants moyens humains, financiers et organisationnels. Ces différences renvoient à des trajectoires historiques distinctes d’institutionnalisation du syndicalisme et des relations professionnelles. Aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, que l’on a coutume de définir comme des systèmes de relations professionnelles à régulation marchande, la syndicalisation est vitale pour deux raisons : le bénéfice des garanties collectives est souvent subordonné à l’adhésion syndicale ; les syndicats dépendent quasi exclusivement de leurs ressources propres pour fonctionner. Sur ce deuxième point, la situation est identique dans la plupart des autres pays d’Europe, y compris dans les économies politiques qui accordent un plus grand rôle à la régulation étatique. Dans des pays aussi différents que l’Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, l’Italie ou la Suède, « les cotisations occupent une part primordiale dans les ressources des syndicats, soit plus de 80 % de l’ensemble […] Si l’on prend en compte d’autres ressources propres, tirées notamment du placement d’actifs, cette proportion dépasse 90 % ».
A contrario, en France, la part des ressources fournies par les cotisations est faible. Si l’on considère la situation des principales confédérations syndicales (CGT, Confédération française démocratique des travailleurs [CFDT] et Force ouvrière [FO]), elle oscille entre un quart et un tiers de leur budget total. La part des ressources propres est plus faible encore à l’échelle sectorielle. La fédération CGT du commerce, qui couvre notamment la branche de la restauration rapide (parmi une cinquantaine d’autres branches du commerce, de la distribution, des services, des hôtels, cafés et restaurants et des services à la personne), revendique 45 000 syndiqué·es et déclare un revenu total de près de 6,2 millions d’euros au 31 décembre 2022. Dans son budget, la part des cotisations n’est que de 1 million d’euros, soit 16,1 % de ses ressources. Les subventions diverses, liées principalement aux dispositifs de financement de la démocratie sociale et regroupées dans la catégorie des « contributions financières », s’élèvent à 5,04 millions d’euros, soit 81,3 % des ressources. À titre de comparaison, aux mêmes dates, le syndicat britannique USDAW (Union of Shop, Distributive and Allied Workers) dont le champ de syndicalisation recouvre, comme son homologue cégétiste, les secteurs du commerce et de la distribution , dispose d’un revenu total de 43,5 millions de livres, soit 51,3 millions d’euros et la part des cotisations (37,7 millions de livres) y est de 86,6 % « .
[…]
« Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que les syndicats français sont encastrés dans un système de citoyenneté sociale qui repose sur un régime de ressources original, faisant la part belle aux financements publics et surtout mutualisés. Cette spécificité permet de comprendre pourquoi, en France, la pression en faveur de la syndicalisation n’est pas aussi forte que dans d’autres pays : l’activité syndicale peut très bien se contenter des ressources qu’apporte le système des relations professionnelles. Elle éclaire aussi, ce qui est moins souvent noté, l’absence d’une véritable culture de l’emploi salarié à l’intérieur des syndicats. Avec peu d’adhérent·es et donc peu de ressources propres, morcelées dans leurs centres de décision comme dans la gestion de leurs finances, organisant une « force de travail » aux statuts multiples (mandaté·es rémunéré·es sur le temps de travail, salarié·es détaché·es et mis·es à disposition par leur employeur, bénévoles en emploi ou retraité·es, salarié·es du privé faisant valoir des heures de délégation ou salarié·es directement employés par un syndicat), nombre d’organisations syndicales ne veulent ou ne peuvent pas assumer la fonction d’employeur. Les syndicats français entretiennent dès lors un rapport ambivalent au salariat : invoqué positivement comme un ensemble de droits dans le travail de représentation et de défense des salarié·es, il est considéré avec défiance, réduit aux contraintes de la subordination dans l’organisation du travail militant (Briec, 2014 ; Ihaddadene et Yon, 2023).«
Paradoxe : Du refus d’être des « marchandes de soupe » au « sale boulot » de la syndicalisation
« Les syndicats français sont encastrés dans un système de citoyenneté sociale qui repose sur un régime de ressources original, faisant la part belle aux financements publics et surtout mutualisés.«
« Alors que l’engagement syndical était traditionnellement pensé sur un mode sacrificiel, comme une forme de renoncement à toute perspective de carrière professionnelle, ces évolutions, combinées aux mobilisations menées par des syndicalistes contre les discriminations dont ils s’estimaient victimes, ont concouru à diffuser l’idée que l’engagement syndical devait dorénavant être reconnu comme un engagement professionnel parmi d’autres. «
« Bien que le travail syndical recouvre une gamme beaucoup plus large de savoirs et de savoir-faire (Gassier et Giraud, 2020), ces évolutions permettent de comprendre que la professionnalisation du syndicalisme soit spontanément associée, dans le champ syndical français, à la pratique du dialogue social. Ces dynamiques institutionnelles sont diversement reçues au sein du champ syndical. Celui-ci est en effet communément décrit selon une topo- logie qui distingue, autour de la CFDT, un pôle « réformiste » censé accompagner cette redéfinition du syndicalisme vers le métier de professionnel du dialogue social, et un pôle « contestataire », autour de la CGT et de Solidaires, qui résiste à cette évolution. «
« « On n’est pas des marchands de soupe ! », répondaient des militants de la CGT à la sociologue Françoise Piotet pour justifier leur rejet de toute démarche volontariste de syndicalisation, laquelle précisait : « Dans les enquêtes conduites auprès des syndicats, les allusions faites en particulier à la CFDT évoquent la très bonne capacité d’organisation de ce syndicat et ses dérives réformistes, les deux étant indissociablement liées aux yeux des militants de la CGT » (Piotet, 2009, p. 21).
« Du sale boulot syndical au travail militant reproductif
Le paradoxe est ainsi que la pratique des organizers tend à valoriser des tâches qui ne retiennent généralement pas l’attention. Peut-on dès lors parler de « sale boulot » (Hughes, 1996), au sens de ces tâches ingrates que les professions prestigieuses délèguent à des subordonnés ? La notion fait sens dans le contexte étatsunien où le CO s’institutionnalise dans une écologie professionnelle subordonnant le métier d’organizer à des positions plus prestigieuses. Dans le cadre d’un rapport de sous-traitance avec diverses institutions donneuses d’ordre, dont les syndicats, les organizers « accomplissent le “sale boulot” de porte-à-porte, d’appels téléphoniques, de diffusion de tracts pendant que les dirigeants syndicaux négocient avec les adversaires » (Petitjean, 2019, p. 258).«