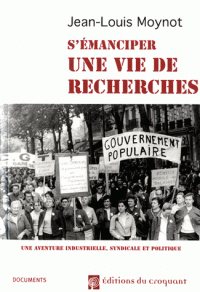Jean-Louis Moynot, ancien membre du bureau confédéral de la CGT (1967- 1981) publie un livre (nous y reviendrons) : S’émanciper. Une vie de recherche (éditions du Croquant, août 2017). Le philosophe Etienne Balibar a accepté d’en faire une postface, publiée sur son blog de Médiapart.
Jean-Louis Moynot: un témoin capital
- 28 août 2017
- Par ebalibar
- Blog : Le blog de ebalibar
Jean-Louis MOYNOT : S’émanciper. Une vie de recherches[1]
Editions du Croquant, août 2017
Postface par Etienne Balibar
Je dois à l’amitié de Jean-Louis Moynot, forgée il y a près de quarante ans maintenant lorsque, tous deux militants « de base » du Parti Communiste Français, mus par un même souci de résistance aux démons de l’autodestruction, nous nous trouvâmes à des degrés divers impliqués dans la « contestation » interne de sa direction, d’être aujourd’hui sollicité par lui d’accompagner de mes réflexions le livre dans lequel il a rassemblé les souvenirs de sa vie professionnelle et militante. C’est un grand honneur qu’il me fait, une marque de confiance, une responsabilité aussi qu’il me confère et que je ne peux refuser, même s’il est difficile de s’en montrer digne. Sur la plupart des sujets qu’il aborde en protagoniste – ingénieur, syndicaliste, expert et chercheur, missionnaire de la République – je ne suis en effet qu’un observateur extérieur, même si l’importance des différentes « scènes » qu’il décrit me paraît cruciale. Cependant nous avons été l’un et l’autre contemporains d’une grande séquence d’histoire nationale (et internationale), aujourd’hui en train de s’achever, et pour une part au moins nous nous sommes trouvés impliqués dans les mêmes événements avec des points de vue complémentaires : nous éprouvons donc le même besoin d’en faire l’objet d’une réflexion critique dotée d’intérêt général et utile à nos successeurs, tout en donnant autant que possible un sens aux trajectoires que nous y avons suivies. C’est pourquoi je me risque ici à proposer quelques lignes de commentaire pour ce qu’on vient de lire.
Jean-Louis Moynot a vraiment écrit, à ce qu’il me semble, un livre étonnant, car il est tout à la fois profondément personnel, animé par la passion et par l’exigence de sincérité, et totalement orienté vers la reconnaissance et le souci du bien public. Revendiquant d’avoir « trahi sa classe d’origine », par suite d’expériences dramatiques traversées dans sa jeunesse et de rencontres qui ont sollicité à la fois son imagination et sa capacité de décision, il démontre qu’une telle conversion pouvait, à condition d’en assumer toutes les implications, amener non pas (cela s’est vu) à l’adoption d’une foi aveugle suivie plus ou moins tôt de reniement, mais à la lucidité, à l’authenticité de la réflexion, à la solidarité critique, à l’esprit de responsabilité. La richesse de l’expérience qu’il nous restitue, en se servant de son étonnante mémoire, allant de la guerre coloniale (qu’il a vécue de l’intérieur) jusqu’à la restructuration des industries d’armement, à travers un parcours de dirigeant de la principale centrale syndicale française, va constituer pour les analystes de la société et de la politique française, du mouvement ouvrier, des politiques industrielles, un matériau extraordinaire. Mais, au-delà, ce sont tous les militants, les chercheurs et les citoyens soucieux de se repérer eux-mêmes dans le cours de leur histoire, qui se voient offrir un trésor de révélations qu’il leur faut digérer et d’interprétations qu’il leur faut discuter.
Il est rare, n’hésitons pas à le dire, que l’itinéraire d’un seul individu, mais fait de multiples rencontres, d’héritages conflictuels, de compétences accumulées, d’occasions saisies, de collaborations renouvelées, comporte de telles leçons pour la communauté. Cela tient, évidemment, à la position privilégiée dans laquelle Jean-Louis Moynot s’est trouvé en tant qu’acteur des événements qu’il rapporte, mais aussi à cette capacité d’analyse et de recul qui semble n’avoir jamais cessé de l’accompagner dans toutes ses fonctions, en dépit de l’engagement qu’elles appelaient, et qui trouve aujourd’hui à se déployer sans contrainte. A quoi ne nuit pas, bien au contraire, l’étonnante capacité qu’il a de dresser toute une série de portraits, tantôt admiratifs, tantôt (quand il le faut) plus sévères, mais jamais vindicatifs : Benoît Frachon, Georges Séguy et Henri Krasucki, Christiane Gilles, Henri Fiszbin, Waldeck Rochet, Martine Aubry ou les chercheurs du « Centre d’études économiques » de la CGT, d’autres encore, ou de souligner pour ceux qui les connaissent mal en France le rôle et l’importance de figures majeures du mouvement syndical international (Bruno Trentin, Alexandre Chelepine…).
Je parlais à l’instant de révélations. Je pense qu’elles seront substantielles non seulement pour les plus jeunes, qui n’ont pas vécu tous ces événements, pour ceux qui – comme moi, par exemple – en ont été les contemporains mais n’ont vu les choses que de l’extérieur, mais pour certains des participants eux-mêmes. Ils pourront mieux, de ce fait, apporter éventuellement leur propre pierre à la recherche de la vérité sur certains sujets sensibles, toujours en partie maintenus dans l’ombre. Cela tient à des causes diverses, qui parfois se superposent. Dans le cas de la guerre coloniale, aux effets toujours massifs de l’amnésie et de l’aphasie (comme dit l’anthropologue américaine Ann Stoler) qui frappe ce moment tragique, mais aussi honteux, de notre histoire nationale, malgré l’énorme travail des historiens dans la dernière période.[2] Dans le cas des politiques publiques, à la tradition d’opacité des administrations. Dans le cas de l’histoire syndicale enfin – le plus important aux yeux de Jean-Louis Moynot puisqu’il lui a consacré l’essentiel de ses engagements, et le point sur lequel son témoignage est le plus décisif – cela tient à la difficulté des circonstances traversées, aux risques stratégiques qu’elles comportaient (et l’on voit bien qu’il n’est jamais tenté de sous-estimer cette contrainte), mais aussi à l’existence dans le mouvement ouvrier, et singulièrement dans l’appareil syndical étroitement dépendant de l’appareil politique communiste (même s’il n’en a jamais été purement et simplement la « courroie de transmission ») d’une culture du secret qui faisait corps avec une certaine conception « centralisée », si ce n’est « militaire », de la lutte des classes. Sur la période de mouvements sociaux entourant mai 68 et surtout sur la « lutte de tendances » au sein de la CGT avant, pendant et après le 40ème Congrès de 1978, qui s’est achevée finalement par la défaite de la ligne rénovatrice incarnée par Georges Séguy (dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui), ainsi que sur le rapport que cette lutte entretenait avec les conflits de pouvoir au sein du PCF et de l’Union de la Gauche, Jean-Louis Moynot nous ouvre les yeux ou précise les soupçons que nous pouvions avoir. Depuis la place qui a été la sienne, il va plus loin, me semble-t-il, que Georges Séguy lui-même – dans les mémoires qu’il a publiés peu avant sa mort, même complétés par quelques entretiens dont il les a fait suivre.[3] C’est pour mieux illustrer la conviction qui leur fut commune, constituant visiblement à ses yeux la grande leçon – plus que jamais valable aujourd’hui – de cette période intense de luttes, d’avancées et de reculs, de rassemblements et de déchirements : la lutte des classes et la démocratie syndicale sont les deux faces inséparables d’un même combat (partie intégrante de la démocratie tout court, dans sa dimension sociale et politique). Or la transparence maximale des organisations et de leur direction est une composante décisive de la démocratie, puisque sans elle le peuple travailleur est privé des éléments du contrôle et de la discussion, donc n’accède pas à l’initiative dans son propre mouvement d’émancipation. Dès lors, il ne peut que passivement influencer la ligne de ses propres organisations, ce qui finit par conduire celles-ci à l’isolement et à l’immobilisme.
Cet exemple est central dans le travail réflexif de Jean-Louis Moynot, mais évidemment il n’est pas le seul. D’autres « épisodes » sont tout aussi étonnants. Je pense que le lecteur aura été frappé, autant que moi-même, par l’histoire vécue de la résistance des appelés et de certains cadres militaires à la tentative manquée du putsch des généraux en Algérie (dans les derniers mois de la guerre), ou par celle des manœuvres d’appareils qui tantôt (pour le plus grand bénéfice des travailleurs) renforcent l’unité d’action entre CGT et CFDT, tantôt l’affaiblissent, ou encore par l’éclairage jeté sur le fonctionnement du Conseil d’Etat et d’autres instances de gouvernement. Mais je voudrais faire un sort particulier, évidemment, à ce que Jean-Louis Moynot rapporte de son expérience en matière de restructurations industrielles et d’articulation des politiques publiques et privées dans les secteurs de l’électronique et de l’armement : questions que les orientations aujourd’hui dominantes de l’économie néo-libérale semblent reléguer au musée, mais dont il montre qu’on pouvait et qu’on peut peut-être encore les aborder dans une autre logique que celle de la rentabilité financière immédiate, à condition notamment de considérer la recherche en sciences humaines et les capacités d’adaptation des travailleurs eux-mêmes comme une ressource fondamentale. Enfin et surtout, je voudrais faire partager l’intérêt passionné que j’ai porté au récit qu’il nous donne des projets de collaboration franco-soviétiques (ou franco-russes…) à propos de la reconversion pacifique des industries militaires (projets finalement torpillés à la fois par l’hostilité américaine et par l’effondrement du programme gorbatchévien de démocratisation du « socialisme réel »). Ici encore, de façon stupéfiante, Jean-Louis Moynot s’est trouvé, en raison de son histoire, de ses compétences, et de sa clairvoyance, au cœur d’un processus stratégique invisible pour le grand public, et pourtant chargé d’enjeux décisifs pour toute notre communauté humaine, à la recherche des voies de sortie de ses affrontements nationalistes et impérialistes.
Ce qui m’amène directement aux deux points « théoriques » par lesquels je voudrais conclure ces notes de lecture. Il me semble que deux grandes questions travaillent, de bout en bout, le compte-rendu que Moynot nous propose de son expérience et de ses réflexions. Elles sont historiquement liées entre elles, en réalité, non pas de façon simple, mais de façon continue et récurrente. Le privilège de l’auteur est d’avoir pu les aborder de l’intérieur, l’une après l’autre, alors que pour la plupart des acteurs que nous côtoyons, qu’ils soient militants, chercheurs, entrepreneurs, cadres ou politiques, elles demeurent généralement incommunicables, pour ne pas dire antagonistes.
La première est celle de ce que j’appellerai l’institution du travail : ce qui comprend non seulement le syndicalisme, mais aussi les législations sociales et les réglementations internationales, précédant ou suivant les grandes vagues de revendications et de rejet de l’organisation capitaliste du travail, constamment surdéterminées aussi par l’histoire politique et géopolitique.[4] On voit bien, en réfléchissant à ce qu’il dit, rejoignant à sa façon les analyses de Bruno Trentin sur la « cité du travail » ou celles de Robert Castel sur la « société salariale », qu’une époque s’achève aujourd’hui, qui avait été ouverte par le nouvel équilibre des forces sociales, au lendemain de la première guerre mondiale et de la révolution russe, et précipitée par la grande crise des années 30, dans laquelle, sans doute, la domination est restée du côté du capital, mais où la classe ouvrière a pu l’affronter sur son propre terrain (celui de la production et, comme on dit en langage marxiste, de la « valorisation »), en lui imposant de tenir compte de ses propres besoins.[5] Cette époque s’achève avec la mondialisation et son expression stratégique « néo-libérale » qui est en même temps postcoloniale et postsocialiste. Cela ne veut pas dire que les conflits et les rapports de forces disparaissent, mais certainement qu’ils changent de lieux et d’enjeux, devenant à certains égards (pour prendre la formulation de Pierre-Noël Giraud) plus « errants », voire plus erratiques.[6]
A ce point il faut alors se retourner vers l’autre domaine de questionnement qu’aborde Jean-Louis Moynot : celui du processus industriel et de la façon dont sa logique (depuis la conception des produits et de leur rapport à la demande jusqu’à l’organisation du travail, à la recherche de productivité et à la concurrence des unités de production) peut ou non s’autonomiser relativement par rapport aux logiques financières et boursières. Au niveau très « théorique » dont je suis obligé de me contenter faute de compétences suffisantes pour aller plus loin, je trouve très intéressant à cet égard que l’expérience de Moynot ne le conduise pas à proposer de « recettes » unilatérales, mais à souligner que l’articulation des interventions publiques (y compris, à la limite, les nationalisations) et des projets d’investissements privés dépend, pour son efficacité et sa contribution à l’intérêt commun, de conjonctures et de « moments critiques » qu’il faut pouvoir saisir au moyen de structures de recherche mixtes. Mais on voit bien aussi qu’il est conscient que les synergies qu’il a contribué lui-même à rechercher (en particulier par sa collaboration avec Jacques Caumartin chez Thomson-CSF) se situent et font sens dans une époque donnée du progrès technologique, des formes de financement de la production, et de la connexion des espaces économiques nationaux. Sans parler, bien entendu, d’un rapport de forces politiques et sociales favorable. Or tout ceci, à l’évidence, est complètement bouleversé aujourd’hui, ce qui fait qu’il faut remettre la question sur le métier.
Moynot, à ce sujet, parle souvent de « crise ». Le mot, admettons-le, est parfois galvaudé : mais je pense qu’il l’entend dans un sens dialectique, incluant à la fois le blocage ou l’obsolescence des formes anciennes et l’émergence du nouveau, plus ou moins clairement identifiable. De ce point de vue l’idée de crise s’applique à la fois, symétriquement, à l’institution du travail et à la forme du processus industriel, c’est-à-dire aux deux composantes de ce que Marx avait appelé le mode de production capitaliste. Celui-ci, qui s’est déjà transformé plusieurs fois, n’est pas tant arrivé à ses limites ultimes (comme semblent pourtant le croire certains très bons théoriciens) qu’il n’entre dans une nouvelle phase, peut-être très instable, de son histoire pluriséculaire. En éclairant à sa façon une séquence récente, mais cruciale, de cette histoire, faite non seulement d’institutions et de processus socio-économiques, mais d’actions et de passions humaines, Jean-Louis Moynot nous appelle à en analyser les formes, pour continuer d’y inscrire nos engagements individuels et collectifs, sans jamais renoncer à en dépasser pour de bon les mécanismes d’aliénation et de domination.
[1] Préface de Christian Dellacherie, secrétaire de la Fédération CGT des cheminots (1979-1983).
[2] Ann Stoler, « Colonial Aphasia : Disabled Histories and Race in France”, in Duress: Concept-work for Our Times, Duke University Press, 2016.
[3] Georges Séguy, Résister : de Mauthausen à Mai 68, L’Archipel, 2008.
[4] Moynot évoque la Déclaration de Philadelphie, et la façon dont ses conséquences ont été infléchies par la guerre froide : Alain Supiot vient d’en souligner lui aussi l’importance dans sa réédition augmentée du rapport présenté en 1999 aux Commissions Européennes (et demeuré lettre morte) : Au-delà de l’emploi (Alain Supiot, dir.), Flammarion 2016.
[5] Bruno Trentin : La cité du travail. La gauche et la crise du fordisme (Introduction d’A. Supiot, Préface de Jacques Delors), Fayard 2012 ; Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, Fayard, 1995.
[6] Pierre-Noël Giraud, L’homme inutile. Du bon usage de l’économie, Odile Jacob, 2015.