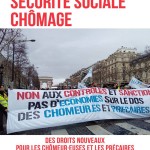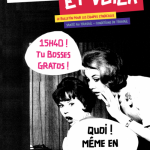Voici la deuxième partie de l’entretien de Sophie Binet dans la revue en ligne BALLAST, que nous envoie et commente Marsanay de l’Université populaire (UP) de Toulouse. Elle y aborde ici le rapport du syndicalisme aux questions politiques, historiquement et dans l’actualité.
- Article commentaire N° 2 Marsanay (UP) : Marsanay (2) commentaire S. Binet
La criminalisation de toutes les formes de contestation a, ces dernières années, atteint une intensité rare. Il y a quelques jours, le secrétaire général de l’Union départementale de la CGT du Nord était condamné à une peine d’un an de prison avec sursis pour un tract en soutien à la Palestine — soutien qui a valu à des responsables de LFI une convocation lunaire pour « apologie du terrorisme ». Un an plus tôt, une répression sans précédent s’abattait sur les militants mobilisés contre les mégabassines à Sainte-Soline, parmi lesquels des représentants syndicaux. Face à cette offensive répressive, quelles modalités d’action et de lutte sont encore possibles ? Dans ce second volet de notre entretien, Sophie Binet nous livre ses réflexions sur l’histoire du syndicalisme, notamment révolutionnaire, sur ses victoires et ses échecs, afin de penser les stratégies des combats en cours et à venir.

Quelle est votre position concernant la logique de la « double besogne » exposée dans la charte d’Amiens ? Certes, le contexte était différent, puisque la CGT était à l’époque révolutionnaire et ne négociait pas du tout avec le gouvernement. Mais est-il pertinent aujourd’hui, de maintenir une séparation étanche entre syndicalisme et politique ?
L’intéressant avec la charte d’Amiens est que tout le monde s’en revendique et, in fine, nous pouvons lui faire dire beaucoup de choses. À l’origine, c’est un texte de compromis entre la tendance guesdiste, du nom de Jules Guesde, qui était plus politique et voyait le syndicalisme comme une courroie de transmission des partis, et de l’autre celle des anarcho-syndicalistes. La Charte affirme à la fois l’indépendance de l’organisation syndicale vis-à-vis des partis politiques et l’impératif de transformation de la société. La CGT s’en revendique parce qu’elle est indépendante et pratique un syndicalisme de la double besogne. L’indépendance, par contre, ne signifie pas que nous nous interdisions de nous positionner sur les débats politiques. Ça veut dire que nous nous positionnons sur tous les débats à partir du prisme du travail, de notre position de travailleuse ou de travailleur.
On pourrait se demander : « Mais pourquoi la CGT a‑t-elle une position sur toutes ces questions-là alors que ce sont des questions éminemment politiques ? ». Quand nous traitons par exemple la loi asile et immigration, nous le faisons en considérant que les immigrés sont avant tout des travailleurs et des travailleuses. S’ils ne sont pas régularisés, ça donne les pleins pouvoirs au patron qui peut organiser le dumping social. De la même manière, sur la question de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), qui est très importante pour la CGT : si nous ne permettons pas aux femmes d’avoir droit à l’IVG, leurs droits fondamentaux au travail sont remis en question. On les enferme à la maison pour qu’elles fassent des enfants et les élèvent. Autre exemple : la CGT a une position sur la prostitution, qui est abolitionniste, parce que nous considérons que la prostitution ne peut pas être un travail, mais que c’est une violence. Nous ne pouvons pas vendre notre corps.
Si, historiquement, la CGT a marché main dans la main avec le PCF, l’évolution des forces au sein de la gauche parlementaire a eu des incidences évidentes. Il y a eu ces dernières années de grosses dissensions entre Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon. Plus récemment, vous avez à plusieurs reprises participé à des entretiens avec François Ruffin. Y a‑t-il une volonté de dépasser le clivage entre syndicat et parti politique ?
L’histoire de la CGT et de son rapport au politique a toujours été bien plus compliquée que ce qu’on veut croire. La CGT n’a jamais été une courroie de transmission du PCF, comme on se plaît à le dire. Si elle a été majoritairement dirigée par des militants communistes, le Bureau confédéral a jusqu’à très récemment été constitué pour qu’il y ait une moitié de non-communistes. Une anecdote : j’ai découvert récemment qu’il y a même eu pendant dix ans un prêtre ouvrier toulousain au bureau — c’était dans les années 1960, période durant laquelle on affirmait justement que la CGT était cette fameuse courroie de transmission du PCF ! Or, après la scission de Force ouvrière, une réflexion a tout de suite été entamée sur la manière de conserver des non-communistes dans la CGT, ce qui s’est traduit par un partage des pouvoirs. Ainsi, le secrétaire général était plutôt communiste, tandis que l’administrateur, soit le numéro 2 de l’organisation, était non-communiste. Ça n’a jamais été écrit, mais ça faisait partie, de manière informelle, des pratiques organisées. La bataille principale, à l’origine de la CGT, est de garder le plus de monde possible en son sein. De faire masse. C’est cette volonté qui permet, encore une fois, un équilibre des débats, des pouvoirs, et qui empêche cette structuration de bloc contre bloc. C’est pourquoi j’ai dit que le fonctionnement que nous avons eu au Congrès, avec des affrontements et oppositions clivantes, était anormal pour la CGT — on courait à la catastrophe par la division.

Nous souhaitons une normalisation de nos relations avec les partis. Je pense qu’il y a aujourd’hui une certaine maturité des organisations syndicales dans leur rapport au politique, et inversement. Pendant une longue période, une forme de défiance ou de peur a existé, celle de se retrouver dans une position, justement, de courroie de transmission entre partis et syndicats. Pour l’expliquer, il faut rappeler qu’il y a eu des désillusions très fortes, notamment après 1981, entre 1997 et 2002 par exemple, où il y a eu une première loi pour les 35 heures qui était positive, mais une deuxième qui l’était beaucoup moins, et également de grandes privatisations. Et puis 2012, évidemment. Depuis, de nombreuses réflexions ont été menées au sein du mouvement syndical à ce sujet. Comme nous ne sommes pas majoritairement anarcho-syndicalistes, nous pensons que pour transformer la société, il faut se donner les moyens d’accéder au pouvoir, donc réfléchir à l’exercice du pouvoir et, par là-même, à notre rapport au politique. Reste que le syndicalisme doit fondamentalement demeurer indépendant vis-à-vis des partis et savoir jouer son rôle de contre-pouvoir au sens large, y compris et d’autant plus quand c’est la gauche qui est aux manettes, afin de ne pas répéter les erreurs passées.
Comme avec François Hollande ?
« Jamais une lutte ne doit être mise sous le boisseau pour ne pas déranger un parti, quel qu’il soit, ou telle force politique qui serait au pouvoir. »
Durant le mandat de François Hollande, le voile s’est très vite dissipé, avec sa « politique de l’offre » et le chèque de 20 milliards de CICE au patronat, sa réforme des retraites puis sa loi travail. Il s’agit d’une violente trahison des travailleuses et travailleurs. Nous n’oublions pas que c’est lui qui, à la demande du patronat, a installé Emmanuel Macron ! Il y a deux lignes rouges concernant notre rapport à la politique à la CGT. Premièrement, jamais une lutte ne doit être mise sous le boisseau pour ne pas déranger un parti, quel qu’il soit, ou telle force politique qui serait au pouvoir. Les travailleurs ont des revendications, une lutte à mener. Le syndicalisme est là pour les organiser, les défendre, que le gouvernement soit de gauche ou de droite. D’autre part, jamais une lutte ne doit être instrumentalisée pour autre chose qu’elle-même. C’est l’un des points de débat qu’il y a eus dans la mobilisation sur la réforme des retraites. Par exemple, à un moment de la mobilisation, certaines organisations politiques commençaient à demander la démission du gouvernement. Notre mot d’ordre était le retrait de la réforme des retraites. Certes, cela aurait été un plaisir que le gouvernement démissionne, mais cela ne garantissait en rien le retrait de la réforme, qui était la revendication centrale des travailleuses et des travailleurs.
Mai 68 a été l’un des plus grands moments de grève ouvrière sur des revendications salariales, de démocratie au travail, de conditions de travail, etc. Et aussi un mouvement plus large de transformation de la société, de dynamique politique, etc. Mais nous, la CGT, nous sommes allés à la discussion de Grenelle. Il n’y a pas eu d’accord à la sortie, mais on y est allés, nous, avec les revendications des travailleuses et des travailleurs. Et notre stratégie, en Mai 68, c’était de répondre à ces revendications immédiates tout en appelant à une transformation sociale plus large. En Mai 68, Georges Seguy réunit l’ensemble des partis de gauche et les appelle à proposer une alternative rassemblée et offensive au gaullisme. La CGT joue donc l’ensemble de la partition : obtenir des avancées immédiates et faire en sorte que la mobilisation sociale débouche sur une alternative politique, dynamique qui aboutira en 1981 à 18 mois de conquêtes sociales (nationalisations, retraite à 60 ans, 39 heures, cinquième semaine de congés payés…), avant le tournant de la rigueur.

Nous fêtons cette année les 80 ans du Conseil national de la Résistance (CNR), qui a obtenu de nombreux acquis sociaux, notamment parce qu’en faisaient partie des ministres issus du PCF comme de la CGT. Comment voyez-vous rétrospectivement l’articulation entre ces deux grandes forces, politique et syndicale ?
À l’évidence, c’est un moment de référence. La période 1945–1947 est même le plus grand moment de réforme sociale qu’on ait connu, qui a commencé dès 1944. C’est allé très vite. C’est en partie grâce à la force de la CGT que le CNR a existé, parce que nous nous sommes réunifiés avec les Accords du Perreux trois mois avant sa création. La CGT était membre du Bureau du CNR. Il y a eu trois présidents au CNR : Jean Moulin, Georges Bidault, et enfin Louis Saillant, qui était président de la CGT. À l’époque, nous avions effectivement des députés et des ministres CGT. Dans les grands moments de conquête sociale, que cela soit 1936, 1945 ou 1981, la CGT a toujours joué un rôle important dans l’union de la gauche, pour qu’il y ait un programme offensif en termes de nationalisation, de retraite, de sécurité sociale, etc. Les conquêtes sociales ne sont jamais arrivées grâce à des dynamiques politiques venues d’en haut, mais seulement parce qu’il existait des dynamiques sociales dans lesquelles la CGT a joué un rôle majeur. Si nous avons eu 1936 et non les ligues fascistes au pouvoir, c’est parce que la CGT a organisé le 12 Février 1934, parce qu’elle s’est réunifiée et parce qu’elle a permis, grâce à la dynamique ainsi amorcée, la création du Front populaire. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’à chaque fois, l’unité syndicale précède l’unité politique.
De la propagande à la propagande par le fait, il n’y a qu’un pas. Justement, la mobilisation contre la réforme des retraites semble renouer avec une diversité de modes d’action qui ne se limitent plus uniquement aux grèves et aux manifestations. Casserolades, blocages, etc. Émile Pouget1, l’un des fondateurs de la CGT, a signé un livre dont le titre est clair : Le Sabotage. Est-ce qu’il n’y aurait pas lieu de réfléchir aux origines du syndicalisme révolutionnaire de la CGT, qui prend en compte la question du sabotage, ou encore d’autres modes d’action directe ?
« C’est le patronat qui sabote l’outil de production, pas les travailleurs ! »
C’est le patronat qui sabote l’outil de production, pas les travailleurs ! Premièrement, il y a eu de nombreuses actions dans l’énergie, comme les mises en « sobriété énergétique ». Durant la mobilisation contre la réforme des retraites, nous ne sommes pas restés les deux pieds dans le même sabot, nous avons mené des actions diverses. En conséquence, certains nous ont accusés d’être des voyous. À tel point que de nombreux syndicalistes sont criminalisés et traînés devant les tribunaux. Aujourd’hui, c’est plus de mille militants et militantes de la CGT qui sont poursuivis par la justice.
Pourriez-vous préciser ce chiffre ?
Attention à ne pas rajouter à l’omerta organisée par le pouvoir sur ce sujet. Ce chiffre est minimisé car les poursuites sont si nombreuses que nous peinons à les recenser. Il y a bien sûr d’abord des centaines de militant.e.s de l’énergie qui ont été le fer de lance de la mobilisation et que le patronat et le gouvernement veulent mater. Très récemment, le parquet a requis 1 an de prison avec sursis contre le secrétaire général de la CGT du Nord suite à une phrase sur un tract, le secrétaire général de la CGT de Seine Saint-Denis a subi 9 heures de garde à vue suite à une manifestation organisée à l’occasion de la venue d’Emmanuel Macron à Saint-Denis, et le secrétaire général de la CGT de l’Allier a été poursuivi pour la 29e fois suite à une opération escargot… Et je ne parle pas des cas quotidiens de répression patronale décomplexée que nous affrontons, avec des militants licenciés dès que nous implantons une nouvelle base dans une entreprise ou dès que nous faisons grève. La répression syndicale atteint un niveau que nous n’avions plus connu depuis la décolonisation, où la CGT avait payé cher son engagement pour l’autodétermination des peuples !

Citez-moi une autre organisation, syndicale, politique, qui affronte le gouvernement avec autant de militants et militantes poursuivies en justice ! Récemment, les agriculteurs ont mis le feu à des bâtiments publics, mais le gouvernement a fermé les yeux et appelé les forces de l’ordre à la clémence. Nous, nous faisons un feu de palettes sur la voie publique et nous avons un procès… Nous ne pouvons mener ce type d’action que lorsque l’opinion est massivement avec nous. Si nous le faisons sans un rapport de force de masse, nous nous isolons, et il devient très facile de nous faire taire. De façon réciproque, les stratégies d’avant-garde éclairée ne fonctionnent pas : il faut toujours avoir la dynamique de mobilisation avec soi, et l’emmener le plus loin possible. C’est pour ça que nous sommes allés sur toutes les actions que nous pouvions faire, sauf des actions de violence contre les personnes, ou de dégradation volontaire de bâtiments, parce que ça ne fait effectivement pas partie de notre répertoire d’actions.
Seuls les militants écologistes paraissent aujourd’hui hériter de cette tradition. Face à un pouvoir radicalisé, ne serait-il pourtant pas pertinent de s’en inspirer ?
« La répression syndicale atteint un niveau que nous n’avions plus connu depuis la décolonisation où la CGT avait payé cher son engagement pour l’autodétermination des peuples ! »
Nous ne cherchons pas à masquer la nécessité de l’action de masse par des coups de com’ ou des buzz sans efficacité réelle. Nous n’avons pas de fétichisme d’un mode d’action en particulier plutôt qu’un autre. Une seule chose est sûre, c’est que le bon mode d’action est celui choisi par les salariés collectivement. Par exemple, les actions dans l’énergie ont été mises en place par les salariés de l’énergie eux-mêmes : ils ont décidé collectivement et ont agi sur leur outil de travail. Par contre, il faut le dire, les actions où des écologistes bloquent une mine de charbon sans les ouvriers qui y travaillent, voire contre eux, sont une catastrophe, car elles mettent en opposition le social et l’environnemental. La CGT, effectivement, n’en passera jamais par là. Je le répète, il faut nous rassembler et non nous diviser !
La séquence de mobilisations contre la réforme des retraites a été marquée aussi par la dure répression vécue à Sainte-Soline par les manifestants contre les mégabassines. Parmi eux, il y avait bien des syndicalistes de la base de la CGT. Y avait-il le souhait d’une agglomération des luttes lors de ce moment décisif ? Officiellement, il n’y a pas eu de déclaration forte de la CGT à ce sujet, qui aurait permis de rassembler les ailes rouge et verte…
Détrompez-vous ! La CGT du département y était bel et bien. Preuve en est, le secrétaire général de l’Union départementale vient d’être condamné. Il est vrai néanmoins qu’avoir toute la CGT au niveau national là-bas était impossible. Cette séquence s’est déroulée pendant le congrès confédéral et en plein conflit contre la réforme des retraites… Je suis allée à Niort en septembre, au moment des premiers procès contre les mégabassines, afin de soutenir le secrétaire général de l’Union départementale. Je m’attendais à ce que nous soyons une pièce rapportée car, effectivement, nous n’avons pas initié cette mobilisation. Mais, sur place, nous formions la moitié, voire les deux tiers du nombre de personnes présentes au moment de l’audience. Il y avait au moins 3 000 militants CGT dans la ville ! À tel point qu’on pouvait avoir l’impression que c’était une mobilisation de la CGT. Donc, nous étions et sommes bien au rendez-vous pour les combats écologiques de Sainte-Soline.

Vous avez dit, à propos des Jeux olympiques de Paris, ne pas vouloir « gâcher la fête ». Pouvez-vous recontextualiser cette phrase ? Car certains regrettent que la CGT ne saisisse pas l’opportunité des JO pour pouvoir créer un rapport de force, non seulement au niveau national, mais aussi international.
Je maintiens que la CGT ne dira jamais qu’il ne faut pas faire grève pendant les JO – d’ailleurs la CGT dépose des préavis de grève dans de nombreux secteurs. Il y a un certain nombre de problèmes, par exemple dans la santé, où c’est une catastrophe (manque de soignants, réquisitions de personnel). La CGT hausse donc le ton. Si ces problèmes ne sont pas réglés d’ici aux JO et que les travailleurs souhaitent se mettre en grève, nous les soutiendrons et nous appellerons à la mobilisation. À aucun moment, en vertu d’un quelconque intérêt supérieur, les travailleuses et travailleurs ne devraient s’abstenir de faire grève et d’exprimer leurs revendications. Il faut toutefois rappeler que les JO, c’est cinq milliards de téléspectateurs. C’est un événement à forte dimension médiatique, avec une adhésion populaire. C’est énorme.
« Si ces problèmes ne sont pas réglés d’ici aux JO et que les travailleurs souhaitent se mettre en grève, nous les soutiendrons et nous appellerons à la mobilisation. »
Prenons l’exemple de la Coupe du monde de football au Qatar. Évidemment, nous avons appelé à la boycotter, la CGT a dénoncé les conditions de travail, etc. Mais tous ceux qui aiment le foot avaient beau critiquer cette compétition, ils l’ont tous regardée. Ceux qui affirment « qu’il faut bloquer les JO » à la va-vite sont souvent ceux qui ne voient pas le rapport de force nécessaire pour réussir à faire entendre leurs revendications sans être contre l’opinion. La bataille fonctionne sur ces deux pieds, celle de l’opinion et celle du rapport de force.
Philippe Poutou, parmi d’autres, a récemment déclaré que les mobilisations des agriculteurs pouvaient être le match retour pour le mouvement social qui s’est opposé à la réforme des retraites l’an passé — en somme, qu’il faudrait que tout le monde aille dans la rue avec les agriculteurs, partis politiques et syndicats compris… Qu’en pensez-vous ?
Il faut rappeler que structurellement, les agriculteurs ne sont pas salariés, pour la plupart. Ce sont majoritairement des patrons. Et la FNSEA, de fait, n’est pas une organisation de salariés, mais de patrons. Elle a partie liée avec l’agrobusiness : ils ne sont pas du même côté de la frontière Capital-Travail que nous. Et ils exploitent près d’un million d’ouvriers agricoles, dont personne ne parle jamais d’ailleurs, alors qu’ils ont des conditions de travail très dégradées. Il faut aussi être très clair sur les stratégies d’infiltration de l’extrême droite, via la Coordination rurale notamment. Pour notre part, nous avons renoué des liens étroits avec la Confédération paysanne et le MODEF2 avec qui nous partageons des conceptions sociales et environnementales. L’unité doit se faire sur des accords de fond. Tout ce qui bouge n’est pas forcément rouge. La CGT a lancé un appel clair à aller rencontrer les agriculteurs et agricultrices sur les barrages, pour construire des convergences contre l’agro-industrie. Ceci a permis sur certains territoires des dynamiques très intéressantes. Malheureusement, la FNSEA et la Coordination rurale se sont mises d’accord avec le gouvernement pour tenter de détourner la mobilisation contre les normes environnementales, pour mieux protéger le capital et l’agrobusiness.
Concernant la situation actuelle, ce que nous souhaitons, c’est un véritable débat sur l’alimentation : comment bien produire, bien manger et bien vivre de son travail ? Les agriculteurs sont enfermés dans un productivisme toujours plus effréné tandis que toutes les réglementations sont affaiblies. Il en résulte que leur situation s’effondre avec la fin des quotas sucriers et des quotas laitiers. Leurs revenus s’effondrent, tandis que les prix de l’alimentaire explosent avec au milieu l’industrie agroalimentaire et la grande distribution qui se gavent. Nous nous battons donc, avec la Confédération paysanne et le MODEF, pour mettre la question du revenu des agriculteurs au centre du débat.
Photographies de bannière et de vignette : Cyrille Choupas