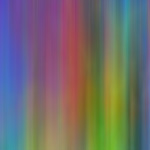Ci-dessous un commentaire sur le guide Comment faire? guide de la démarche revendicative à partir du travail, récemment sorti par la CGT. Ainsi que des réflexions plus générales sur la CGT et le travail, thème qui devrait être porté au 51ème congrès CGT.
Pour commander le guide : 20160310_GuideTravail_Precommande
Démarche revendicative à partir du travail : un guide CGT
La CGT, à partir de sa commission Travail-santé, vient d’éditer un petit guide militant (20 pages) intitulé : Comment faire ? Guide de la démarche revendicative à partir du travail. Cela participe d’une volonté politique maintenant bien ancrée dans les documents confédéraux (ce qui ne veut pas dire les pratiques réelles) : transformer la pratique syndicale, réécrire en quelque sorte l’alphabet du syndicalisme par « la porte d’entrée » du travail (comme le disent les documents CGT officiels), ou en commençant par refonder ce qui a été un peu oublié : la CGT s’appelle Confédération générale du travail.
Le guide commence par l’évidence : rien ne fonctionnerait dans la société si les « petits riens, ces petites choses » qui font marcher les trains, l’électricité, ou tout ce qui concourt à la vie humaine (car il n’y a pas que les machines) ne se faisaient pas avec soin. L’acte du travail, physique et mental, construit la personne, mais c’est aussi un acte souvent non pensé (une boite noire), ou non collectivement, ou pas officiellement : on en discute à la pause-café, entre pairs, au vestiaire, peut-être entre amis le week-end ou dans des repas. Mais même ses moments informels sont de plus en plus réduits, supprimés ou niés. Dès lors, le (la) travailleur-euse est seul-e face à cet impensé et cela peut engendrer de la souffrance, surtout si le sentiment existe que le travail est mal fait, empêché par des ordres dépourvus de sens, contradictoires, strictement liés à des objectifs tombant d’en haut et dont la finalité échappe (même si elle est devinée : la rentabilité).
Le guide CGT cherche donc à donner des repères aux salariés, aux syndiqués, aux militants pour redonner du poids et de la valeur à la nécessité de penser le travail : « Les salariés ont besoin d’en parler ». Il faut donc « reconquérir ces lieux comme les pauses, les temps de repas ».
C’est d’autant plus nécessaire pour redonner sa légitimité au syndicalisme (et donc recruter sur de bonnes bases) que « les jeunes qui rentrent au travail veulent réussir leur vie » et qu’ils sont spontanément demandeurs de sens. Il ne faut pas laisser le patron occuper ce terrain. Et en effet, les jeunes « ne s’attendent pas à voir le syndicat s’occuper de leur travail ». Implicitement, ils ne placent pas le syndicat du côté du « sens », de la « valeur » qui les motive (mais ce n’est pas toujours le cas, car il y aussi beaucoup de situations indignes dans le travail), mais sans doute du côté de la simple assistance-assurance, le service à rendre.
Le guide s’efforce donc d’aiguiller les réflexions sur « Comment tu travailles aujourd’hui ? Qu’est-ce que ne va pas ?», etc. Et à partir de là déboucher sur une « stratégie revendicative ». Pour cela, il propose un syndicalisme qui soit « plus passeur de parole que porte-parole », en posant l’idée que les salariés sont ou doivent être les « experts du travail». Concrètement, il est par exemple proposé que 3 à 5 heures par trimestre soient obtenus pour discuter du travail hors hiérarchie, puis 3 à 5 heures encore « avec » la hiérarchie pour déboucher sur des « décisions ».
« Des compromis, pas de compromissions »
Dans le numéro de février 2016 de la Nouvelle vie ouvrière (NVO), journal de la CGT, un exemple de ces pratiques est donné à partir d’un entretien entre Geoffrey Rabier, secrétaire du syndicat CGT de l’hôpital d’Alès (Gard), Alain Alphon-Laire, responsable confédéral Santé/Travail, et Yves Clot, psychologue du travail et auteur de nombreux ouvrages sur ces questions (exemple : Le travail au cœur, La Découverte, 2015).
Geoffrey Rabier décrit des situations de débats parfois conflictuels entre salariés et approches syndicales classiques, lorsqu’on prend le temps de discuter très attentivement avec ce que désirent les salarié-es. Par exemple travailler 12 heures par jours en maison de retraite (au lieu de 7h40), souhait exprimé par eux/elles, n’apparait pas à première vue très progressiste, y compris pour la santé. Des débats « houleux » ont eu lieu, débouchant finalement sur des augmentations de personnels, des contrats précaires pérennisés, et un horaire de 8 heures avec des jours RTT. D’autres exemples du même type sont décrits. Il conclut sur l’idée suivante : collectivement, on débouche sur des « compromis », mais aussi un refus de « compromissions ». Il affronte le débat avec certains qui l’accusent d’être « réformiste », mais le syndicat enregistre un score de 67% aux élections.
Le chercheur Yves Clos ajoute que pour un syndicat, être « radical », c’est « prendre les choses à la racine », consistant à restaurer « la liberté des salariés d’agir sur leur travail ». Il dénonce une « subordination salariale surannée ». Et il constate que les jeunes surtout ont besoin d’être « à l’origine de ce qui leur arrive », et c’est pour cela qu’ils peuvent être tentés par des formes de vie professionnelle « hors du salariat », donc hors du lien de subordination. Une réflexion utile en plein débat sur le Code du travail.
« La porte du travail » et le contrôle de la valeur
Redonner du sens au syndicalisme en passant « par la porte du travail » est sans aucun doute essentiel en plein bouleversement des outils du travail (numérique), des relations de travail (ubérisation), de l’éthique même du travail (indépendance ou pas, etc). Il est vrai que le conflit social a trop porté de manière routinière sur « l’enveloppe autour du travail » (salaires, temps), comme le dit Alain Alphon-Layre. Il est vrai que porter le regard sur la boite noire du travail concret comporte dans un premier temps un danger : on ne sait pas où on va, on est sur la corde raide, on quitte les terrains syndicaux bien balisés, on peut se faire accuser de faire de mauvais compromis, de « réformisme », etc. De ce point de vue le livre collectif de la CGT : « Pourquoi nous travaillons » (Yves Bongiorno, Jean-Christophe Le Duigou, Nasser Mansouri-Guilani, Jean-François Naton, Catherine Nédelec, éditions de l’Atelier, VO éditions, 2013), suscite certainement des interrogations, des doutes, voire des suspicions. Ce débat émergera-t-il au 51ème congrès de la CGT ? Ce n’est pas sûr, car au 50ème congrès, si le document d’orientation commençait bien par cette question, il n’en fut aucunement question dans les échanges ! Malgré les efforts de la commission Santé/travail, la CGT est encore loin de prendre cette question à bras-le-corps, car elle est dérangeante, comme l’est tout débat sur le travail abordé avec les salariés-es. Nous sommes là dans l’inter-subjectif, voire dans l’intimité (on cache des choses lorsqu’on travaille !), dans ce qui est le plus souvent « non-dit ». C’est la raison pour laquelle l’apport extérieur d’un tiers médiateur (chercheurs) a été et reste utile.
Inversement, il convient de ne pas lâcher l’autre face de l’exploitation du travail. Si l’organisation du travail reste bien sûr l’apanage du patron « seul juge » (comme le dit l’interprétation de la Cour de cassation) de ce qu’il faut faire et comment le faire, despotisme qu’il faut faire sauter par une pratique syndicale nouvelle, le travail est également entre les mains de la classe possédante au sens où celle-ci détient seule la maitrise de la valeur économique, qui est à l’échelle macro-sociale une force extrême. Conquérir une sécurité sociale professionnelle, c’est-à-dire étendre au travail ce qui a été obtenu dans la socialisation du salaire pour la sécurité de la santé et de la retraite, ce serait là aussi enfoncer une porte majeure (avec le contrôle du temps et la réduction du travail contraint) pour la conquête de l’émancipation. La socialisation du salaire, si elle se généralise, serait la voie salariale de la production de valeur, ouvrant un pouvoir potentiel d’agir pour la société tout entière.
Jean-Claude Mamet