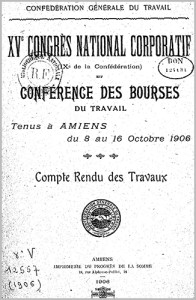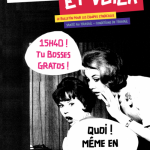A l’occasion d’une journée d’étude sur les partis politiques initiée par la Fondation Copernic et l’association Coudes à Coudes (en novembre 2024), Claude Debons, ancien secrétaire général de la Fédération CFDT Transports, puis militant dans la Fédération des cheminots CGT (après 2003) a fait une contribution sur la question complexe des rapports entre partis et syndicats. Claude Debons est aussi un des initiateurs de l’Appel de syndicalistes à « un sursaut unitaire » (lire : http://syndicollectif.fr/?p=25372). Cet article comprend son exposé, des annexes sur la Charte d’Amiens (1906) et sur des éléments d’histoire européenne de ce débat.
Rapports partis – syndicats, vieille question…
QUELS DEFIS AUJOURD’HUI ? DES CONVERGENCES DANS L’INDEPENDANCE ?
Les conditions de la lutte des classes ont été profondément transformées par la mondialisation capitaliste, la contre-révolution néolibérale, la nouvelle division internationale du travail, la concurrence exacerbée, la désindustrialisation, la sous-traitance, l’éclatement du salariat, etc… Dans ces conditions, les luttes d’entreprises sont à la peine, le patron décideur n’est pas toujours « à portée de main », les multinationales appellent des actions internationales difficiles, la concurrence sauvage appelle des régulations publiques, les attaques contre l’Etat social appellent des alternatives politiques, etc… L’action syndicale seule n’y parvient pas…
Les partis de gauche au gouvernement ont perdu une part de leur ancrage dans le salariat, des théorisations hasardeuses les y ont encouragé, leurs programmes ont glissé vers le social- libéralisme puis le néo-libéralisme à rebours des attentes populaires, l’électorat perdu a glissé vers l’abstention et l’extrême-droite, les divisions à gauche ont entaché sa crédibilité à proposer une alternative crédible. La gauche et les écologistes ne pourront entreprendre une reconquête populaire en ignorant syndicats et associations qui ont gardé un certain ancrage social…
S’y ajoute maintenant la menace sur l’avenir que fait peser une extrême droite qui est toujours aux portes du pouvoir. L’unité de la gauche et des écologistes et l’engagement déterminé des forces syndicales et associatives a permis de s’opposer au Rassemblement National. Certaines organisations ont aussi apporté leur soutien au programme du NFP. Au second tour un Front républicain à consolidé la résistance. Mais, depuis, la mobilisation est retombée, un certain « retour à la normale » s’est installé, des forces centrifuges menacent l’unité du NFP. C’est dangereux alors que la menace est toujours là…
– Face aux menaces et pour ouvrir une autre voie, un nouveau sursaut est nécessaire, un dépassement de la coupure entre le social et le politique, dans le respect des responsabilités respectives des syndicats et partis :
. des actions en parallèle, sans convergences, sans front commun, conduisent à la défaite politique d’un côté et à la défaite sociale de l’autre,
. le chemin à parcourir pour dépasser les obstacles, méfiances et ressentiments peut paraître difficile, mais le temps presse.
– Pour avancer les partis de gauche doivent sortir une bonne fois pour toute de la croyance dans la supériorité du politique et considérer les syndicats comme des interlocuteurs à égalité :
. en finir avec les tentations de domination et d’instrumentalisation dont on a encore vu un dernier avatar au début du mouvement contre la réforme des retraites,
. ne pas ignorer les syndicats et associations dans l’élaboration de leurs projets et programmes.
– Pour les syndicats, il est temps de sortir d’une vision réductrice de la Charte d’Amiens qui n’a jamais été réductible à l’indépendance syndicale :
- il s’agit d’une conception totalisante de l’action syndicale : des revendications immédiates au renversement révolutionnaire du capitalisme par la grève générale et à l’édification d’une société nouvelle,
- les questions à se poser aujourd’hui c’est :
. comment élaborer et porter des projets de transformation au-delà des revendications immédiates,
. comment construire l’irruption du mouvement social et de ses exigences dans le politique pour peser sur les choix sociaux, économiques, environnementaux, démocratiques…
. pour mémoire, voir l’accord CGT – CFDT de 1966 : au-delà des revendications, il y a les axes d’une politique autant économique que sociale, voir aussi la plateforme CGT – CFDT de 1974.
– Comment engager un travail commun partis de gauche – syndicats (et associations) à égalité de dignité, dans le respect des fonctions respectives : candidats au pouvoir pour les uns, appelés à rester des contre-pouvoirs pour les autres ?
Vu le passif, sans doute faut-il procéder par une approche thématique :
- quelles réflexions et action communes de vigilance démocratique, de consolidation et d’élargissement du champ de la démocratie (citoyenneté en entreprise…)
- quelles réflexions et actions communes en défense du modèle social issu du CNR (où partis et syndicats coopéraient) mis à mal par la contre-révolution libérale,
- quelles réflexions et actions communes autour du rôle des services publics mis à mal dans la tourmente de l’ouverture à la concurrence,
. l’exemple du démantèlement de fret SNCF, n’est pas qu’une question sociale, c’est une question d’intérêt général d’avoir un outil public pour la transition écologique dans le transport de marchandises ; on en cause ensemble ?
- quelles réflexions et actions communes sur la mise en œuvre de la transition écologique, qui va impacter les systèmes de production et d’échange et qui n’est pas envisageable sans participation des salariés et de leurs syndicats,
- quelles réflexions et actions communes sur les questions de discriminations en tous genres et de racisme en entreprise et dans la société ?
- quels échanges sur les lignes de forces d’un projet d’avenir désirable répondant aux paniques identitaires qui nourrissent la nostalgie réactionnaire et raciste du RN,
- etc…
Mais l’urgence peut surgir d’une accélération du calendrier politique, il vaudra mieux être prêt à y répondre…
Pour conclure :
Priscilla Ludosky (ex porte-parole des gilets jaunes) interrogée pour le Labo des Partis :
“Les partis seuls n’y arriveront pas, les syndicats seuls n’y arriveront pas, les associations et activistes seuls n’y arriveront pas, il faut vraiment reconnecter ces trois gros blocs là mais pour ça, il faut que chacun se remette en question.”
Claude DEBONS – Novembre 2024
Annexe 1 : extraits Charte d’Amiens (congrès de la CGT 1906).
La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat ».Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe, qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d’exploitation et d’oppression, tant matérielles que morales, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation théorique : dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme : d’une part il prépare l’émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste, et d’autre part, il préconise comme moyen d’action la grève générale et il considère que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera, dans l’avenir, le groupe de production et de répartition, base de réorganisation sociale.
Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d’avenir, découle de la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait, à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir d’appartenir au groupement essentiel qu’est le syndicat.Comme conséquence, en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l’entière liberté pour le syndiqué, de participer, en dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu’il professe au dehors. En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare qu’afin que le syndicalisme atteigne son maximum d’effet, l’action économique doit s’exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale.
Annexe 2 : REPERES HISTORIQUES
Aux origines du mouvement ouvrier, 3 types de relations Partis – Syndicats.
L’exemple de l’Angleterre
– Le syndicalisme nait avec la révolution industrielle :
- loi interdisant association d’ouvriers abrogée en 1824,
- statut légal reconnu en 1871, nouveaux droits en 1875 (piquets de grève pacifiques).
– La création des Trade Union Council a lieu à Manchester en 1867 :
- dans les années 1860, aucun parti ne représente les classes laborieuses,
- jusqu’en 1890, les TUC se tournent vers le Parti libéral pour porter leurs revendications dans le champ politique,
- mais en 1869 les TUC créent la Ligue pour la représentation des travailleurs qui soutient certains
– Le Parti travailliste est créé sous l’impulsion du mouvement syndical qui veut promouvoir une représentation politique des travailleurs au Parlement :
. un Comité de représentation des travailleurs (Labour Representation Committee) est créé en 1900,
. il prend le nom de Parti travailliste (Labour Party ) en 1906,
– les TUC sont représentés à la direction du Parti.
- Cette construction traversera deux guerres mondiales et la crise de 29, mais sera mise à mal après les gouvernements Thatcher (1979 – 1990) :
- les TUC sortent affaiblis de l’affrontement imposé par Thatcher,
- le Labour Party voit sa base ouvrière rétrécie par la mondialisation et la désindustrialisation,
- John Smith, Gordon Brown et Tony Blair, adeptes de la « 3ème voie », en profitent pour rompre les liens avec les TUC et leur présence à la direction du Parti. Le New Labour est créé pour mener une politique néo-libérale.
L’exemple allemand
– L’industrialisation est plus tardive qu’en Angleterre ou en France et les idées socialistes précèdent l’organisation syndicale :
- naissance des mouvements socialistes dans les années 1860,
. Association générale des travailleurs allemands, Ferdinand Lassalle, réformiste,
. Parti ouvrier social-démocrate (SDAP), Wilhelm Liebknecht, August Bebel, influence marxiste,
- s’unifient en 1875 lors du congrès de Gotha et fondent le Parti socialiste des ouvriers allemands (SAP)
- interdiction par Bismark (1878 – 1890) qui adopte des lois « antisocialistes » (maladie, retraite, repos hebdomadaire…), sans succès.
– Le parti ouvrier renait en 1890, au congrès Erfurt, sous l’impulsion d’August Bebel, le programme est inspiré par Karl Kautsky. Il est plus révolutionnaire que celui d’Erfurt mais contient toujours des éléments réformistes. Il prend le nom de Parti social-démocrate (SPD) :
- tendance révolutionnaire, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, inspiration marxiste,
- tendance réformiste, sous l’influence d’Edouard Bernstein,
– leur conception commune est que le parti et le syndicat doivent être alliés dans la lutte des classes avec une prééminence du parti,
- toutefois en 1906, le congrès du SPD reconnaît l’égalité de traitement entre syndicat et
– Les premiers syndicats sont autorisés en 1878 s’ils ne sont pas affiliés au SAP :
- en 1890, l’abolition des lois antisocialistes permet aussi le développement et l’organisation du mouvement syndical,
- en 1892, les syndicats (sidérurgie, mines, chimie, imprimerie…) s’unissent en une Confédération nationale des syndicats sous l’impulsion de Karl Legien,
- avec une orientation réformiste comme la majorité du SPD qui n’empêche pas le recours à la grève.
– Les liens entre syndicats et SPD sont importants, les dirigeants de la Confédération intègrent la direction du parti et des militants syndicaux adhèrent au parti (voir la vision de Karl Kautsky, théoricien important de la social-démocratie allemande, en 1900) :
« Malgré l’organisation tout à fait indépendante des syndicats, il existe entre eux
et le Parti socialiste l’entente la plus étroite. Ce sont la plupart du temps les mêmes hommes qui se trouvent groupés dans l’une et l’autre organisation. Les socialistes se montrent les meilleurs syndiqués, et presque tous les syndiqués vraiment actifs
sont aussi de bons socialistes. Si la question des rapports d’organisation entre le
Parti socialiste et les syndicats est hors de discussion en Allemagne, il m’apparaît par contre qu’en France cette question est extrêmement controversée (…) ».
– La période 1890 -1914, constitue apogée du mouvement ouvrier allemand, le SPD devient le premier parti d’Allemagne.
- Les secousses et divisions surviennent : l’attitude face à la guerre en 1914, l’écrasement de la révolution allemande sous un chancelier SPD en 1919, la division du mouvement ouvrier entre SPD et KPD qui en résulte facilite l’arrivée de Hitler, la période nazie qui suivra entrainera l’anéantissement du mouvement ouvrier allemand.
– En 1945, des partis se recréent : CDU, SPD, KPD (interdit en 1956, guerre froide)
- l’orientation réformiste du SPD, est consolidée en 1959 au congrès de Bad Godesberg (renoncement au marxisme et à la lutte des classes, acceptation de l’économie de marché),
- le syndicalisme reconstitué s’inscrit dans la même orientation réformiste,
– les syndicats puissants se regroupent dans la Confédération allemande des syndicats (DGB),
- une loi de 1952 instaure un système de codétermination / cogestion dans les
- La symbiose culturelle et les liens entre SPD et DGB se distendront avec l’Agenda 2010 de Gerhardt Schroeder (chancelier de 1998 à 2005) adepte de la 3ème voie (Clinton, Blair) et les lois de régression sociale (Hartz4) qu’il met en œuvre et qui suscitent des résistances politiques et
L’exemple français
– A la différence de l’Angleterre ou de l’Allemagne où des liens s’établissent très vite entre partis et syndicats, en France syndicats et partis ouvriers se constituent parallèlement :
- syndicats autorisés par la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 qui abroge la loi Le Chapellier de 1791, permet des créations de syndicats,
- le mouvement s’accélère avec la création de la Fédération nationale des syndicats (1886) et de la Fédération des Bourses du travail (1892) qui se rejoindront dans la CGT,
- le congrès constitutif de la CGT a lieu à Limoges les 23 – 28 septembre 1895, piliers fédérations Livre et Cheminots, fédération Bourses du travail, des métiers restent extérieurs
- en 1906 la grève générale les consolide et le congrès d’Amiens fixe la doctrine,
– la Charte d’Amiens, énonce une conception totalisante du syndicalisme à vocation révolutionnaire, influencée par le marxisme et l’anarchisme, qui se défi du parlementarisme et des partis qui y participent :
« La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat.
Le syndicalisme révolutionnaire séparé du parti ouvrier suscite l’incompréhension de Karl Kautsky :
« (…) il m’apparaît par contre qu’en France cette question (des rapports entre parti et syndicat) est extrêmement controversée.
Les solutions les plus divergentes sont proposées ; tandis qu’un grand nombre veut mettre les syndicats dans la dépendance absolue – au point de vue de l’organisation – des groupements politiques socialistes, les autres préconisent non seulement l’indépendance des syndicats vis-à-vis des organisations politiques, mais même l’opposition à celles-ci, et ils ne voient pas l’action syndicale et l’action politique comme les deux aspects d’un même phénomène – la lutte de classe du prolétariat –, mais deux phénomènes différents et incompatibles ».
– Les idées socialistes émergent au début XIX° siècle, Spence, Fourrier, Saint Simon, Owen
- elles sont nourries par la révolte des canuts lyonnais (1831), les journées de juin1848, la Commune de Paris (1871),
- 1848 fait apparaître des divergences entre réformistes (Ledru-Rollin, Louis Blanc) et partisans de la rupture (Blanqui, Barbès),
– les courant socialistes français sont divisés : Guesde, Vaillant, Brousse, Allemane
- le mouvement vers l’unité est amorcé après succès législatives 1893 et municipales 1896,
- les divergences sur affaire Dreyfus et la participation à un gouvernement bourgeois freinèrent le
– En 1902, il y a deux partis, le Parti socialiste français (Jaurès) et le Parti socialiste de France (Guesde) :
- en 1904 le congrès international d’Amsterdam (les thèses marxistes sur la lutte des classes y sont dominantes) prône l’unité,
- l’unification du socialisme français intervient les 23-25 avril 1905 au congrès du Globe à Paris et prend le nom de Parti socialiste, Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO).
– Les divisions au sein du parti et du syndicat surgiront avec la guerre de 14-18, la révolution russe, la scission du Parti socialiste (SFIO) et la création du Parti communiste français (PCF – Section française de l’Internationale communiste (SFIC) en 1921 :
- la scission de la CGT intervient en 1922, la CGT-U est créée, la CGT réformiste continue,
- le syndicalisme révolutionnaire s’achève, la CGT-U devient dépendante du PCF, la CGT réformiste est plus proche idéologiquement de la SFIO,
- la revue « La révolution prolétarienne », fondée par Pierre Monatte, continuera d’entretenir la réflexion syndicaliste révolutionnaire.
ET APRES ? SIMPLE RAPPEL CHRONOLOGIQUE
- La réunification syndicale intervient en 1936 avec la dynamique unitaire antifasciste et la création du Front Populaire,
- le pacte germano- soviétique avive les tensions dans la CGT, les « unitaires » sont exclus en 1939, puis réintégrés en 1943,
– le summum de la coopération Partis – Syndicats sera atteint avec la création du Conseil National de la Résistance — pour faire face à l’occupation allemande et à la collaboration du régime de Vichy — qui produira le programme des jours heureux, fondement des grandes mesures sociales de la Libération.
L’après guerre
- scission en 1947 avec guerre froide, CGT, FO, FEN
- CGT très liée au PCF, FO plus proche SFIO, FEN unité et tendances « politiques »
- histoire distincte de la CFTC (encycliques) puis CFDT 1964
- lien PCF – CGT pendant guerre froide
- les décolonisations, la guerre d’Algérie
Mai 68 et après
- grève générale, rôle des syndicats, rôle des partis,
- la CFDT post 68, syndicat-parti, socialisme autogestionnaire
- programme commun 1972, soutien CGT, distance CFDT
- opération Assises du socialisme avec CFDT 1974 au profit du PS, l’amorce d’une évolution qui abandonnera le socialisme autogestionnaire pour aller vers l’accompagnement du néo-libéralisme avec l’espoir vain d’en atténuer les effets,
- cependant, appel CGT – CFDT à voter Mitterrand en 1981
- 1992 – crise et éclatement de la FEN >> création FSU, UNSA
- 1989 – 1995 – 2004 : scissions dans la CFDT, création de différents SUD
Dans la période contemporaine
– les déceptions vis-à-vis de la gauche conduiront à la prise de distance des syndicats vis-à-vis des partis,
- éloignement de la CFDT de la gauche vers le social-libéralisme,
- distanciation PCF – CGT : Viannet quitte le BP du PCF en 1996, Thibault quitte le PCF en 2001,
- le repli sur le revendicatif entraine une certaine « dépolitisation » de l’action
Un sursaut intervenu avec la menace du Rassemblement national
. large mobilisation syndicale et associative contre le vote RN
. soutien de certaines organisations au programme du NFP
. soufflet retombé avec les tergiversations du NFP et la faiblesse d’initiatives commune
CD – novembre 2024.