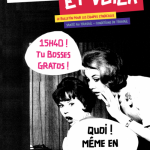Le 11ème congrès de la Fédération syndicale unitaire (FSU) témoigne d’une organisation en dynamique ascendante. Malgré un ancrage centré dans l’éducation, elle joue un rôle actif dans le débat syndical interprofessionnel, en faisant depuis longtemps des propositions vers l’unification. Avec l’élection de Caroline Chevé comme secrétaire générale, elle amplifie un ancrage territorial de la FSU et permet aussi à l’Intersyndicale nationale d’être majoritairement animée par des femmes.
Note : nous publierons les textes définitifs adoptés dès qu’ils seront sur le site de la FSU.
- Télécharger l’article : Congrès FSU Fabrique de l’unité
Unir : « 1+1 = 3 »
Jean-Claude Mamet
Le discours de clôture de Caroline Chevé, élue secrétaire générale, au sortir du congrès avait peut-être une tonalité FSU un peu nouvelle. Membre du SNES (syndicat du second degré), elle animait jusqu’ici la Section départementale (SD) FSU des Bouches du Rhône (13) : « tout un programme » dit-elle. Son message porte donc une marque très fédérative : « Vus d’une SD, les syndicats de la fédération, ce sont d’abord des camarades qui font d’autres métiers : agents des parc nationaux, ou de la collecte des déchets, cuisiniers, OP, jardiniers, ATSEM, travailleurs sociaux, éducateurs.trices, et bien sûr PLP, PE, assistantes sociales, AESH, infirmières… ». Pas seulement les profs donc ! Ce faisant, elle a probablement aussi une bonne connaissance des autres syndicats.
Rappelons d’emblée que la FSU fonctionne et tient beaucoup avec ce qu’elle appelle « le trépied » ou les « trois piliers » : les syndicats professionnels nationaux (mais « professionnels » ne veut pas dire « corporatistes ») ; les sections départementales (SD), parfois décrites comme insuffisamment consolidées face au poids des syndicats nationaux ; les « courants de pensée » ou « tendances », qui remontent loin en arrière et sont une garantie démocratique. Au cours du congrès, c’est donc constamment au nom des syndicats, ou des sections départementales (souvent plusieurs SD associés sur un amendement) ou encore au nom des courants que les interventions se font à la tribune. C’est donc bien l’expression du collectif.
En termes d’orientation, il faut insister sur le « U » de FSU : l’unité et le but d’unification du « syndicalisme », en ajoutant : « pour la transformation sociale ».
Un bilan plutôt consensuel de la mandature
Le 11ème congrès enregistre un bilan très positif des deux mandats de Benoît Teste comme secrétaire général. D’une part, il est noté une participation plus forte des adhérent-es au « vote d’orientation » qui selon la tradition FSU s’effectue sur les propositions des « tendances » et avant le congrès lui-même, donnant ainsi une sorte de « cadrage politique » préalable (un peu déroutant pour d’autres traditions syndicales) sur les rapports de force internes. La participation au vote interne pré-congrès est à 28, 27%, soit un progrès de 5,6%, sur un effectif de 159 039 inscrit-es. Mais d’autre part, comme l’écrit la tendance L’Ecole Emancipée (la revue N° 111), « le rapport d’activité ne comportait pas … d’appréciation différenciée de certains éléments du bilan du mandat écoulé ». Ce bilan est donc plutôt consensuel. Or ce mandat a été riche d’évènements et de débats internes importants : la lutte de 2023 sur les retraites, l’attitude syndicale après la dissolution (juin-juillet 2024) et la proposition de « nouvel outil syndical » en direction de la CGT et de Solidaires (mais « sans exclusive ») depuis le précédent congrès de février 2022. On sait aussi qu’en mars 2023, le congrès CGT ferme cette hypothèse à trois, avant que la CGT elle-même reprenne l’initiative des discussions la même année, mais avec la seule FSU.
Dans ce congrès la tendance majoritaire (Unité et Action) enregistre un progrès en voix (30 090, soit 5818 de plus) et un peu en pourcentage (69,23% : +0,17%). Mais la tendance N°2 Ecole Emancipée se félicite d’un progrès plus fort (plus 1,32%, avec 23,17%), venant surtout du Syndicat SNU-IPP (instituteurs et professeurs des écoles) et aussi du SNES (second degré). Le total des autres courants (7,59%) est plutôt en baisse par rapport au précédent congrès. La FSU est donc solidement animée par deux courants principaux qui semblent se conforter et (peut-être) s’enrichir dans leurs apports mutuels, surtout sur certaines questions (le thème 3 du congrès : « Rupture écologique, droits humains et justice sociale : une urgence démocratique »), mais aussi sur la question des rapports avec la CGT et Solidaires (thème 4).
La FSU « sur tous les fronts » (Benoît Teste)
Nous n’avons pu assister qu’à une partie du congrès : le thème 3 (les alternatives de société) et le thème 4 : la FSU dans le champ du syndicalisme (le thème 1 porte sur l’éducation et le thème 2 sur tous les services publics).
Cette organisation thématique des congrès ne varie pas depuis la fondation de la FSU en 1993. Le thème 3 a toujours porté sur la recherche des « alternatives », confirmant ainsi la portée politique du syndicalisme, au sens de la fameuse Charte d’Amiens : « la besogne d’avenir ». Interviewé par la revue de l’Ecole Emancipée, Benoît Teste assume vouloir « défendre des alternatives radicales au capitalisme destructeur…Bref, le syndicalisme se doit d’être sur tous les fronts ». Simultanément, la FSU affirme en même temps l’objectif d’un syndicalisme « à vocation majoritaire », de même que la CGT, présente par une forte délégation. Autrement dit être à l’écoute des salarié-es sans pour autant tout niveler au « plus petit dénominateur commun ». L’homogénéité culturelle du syndicalisme FSU facilite évidemment cette expression exigeante en congrès, présente mais de manière plus compliquée dans les congrès des confédérations syndicales, où les statuts sociaux sont plus hétérogènes.
La réflexion du thème 3 est souvent un foisonnement. Aucune question contemporaine n’y manque. La première partie réaffirme l’engagement écologique de la fédération. Notamment la nécessité de « réorienter les productions », contre le « techno-solutionnisme », pour l’économie circulaire, l’interdiction des « polluants éternels » tels que les PFAS (en mobilisant le principe de précaution). Elle met fortement l’accent sur la « démocratisation du travail » avec des collectifs autorisés à débattre sur son sens. Elle se fixe un mandat d’étude pour « une sécurité sociale professionnelle et environnementale » (comme la CGT). Elle va plus loin en se fixant le mandat « de se rapprocher » du Collectif national « pour une sécurité sociale de l’alimentation » (SSA), et pour une agriculture biologique « majoritaire «. La deuxième partie de ce thème est centrée sur « le droit des peuples » et n’élude aucune question difficile : Gaza, Ukraine, Nouvelle Calédonie, le rôle de la Cour internationale de justice et la caractérisation du « fascisme libertarien ».
La concrétisation organisationnelle du mandat écologique est renvoyée au thème 4 sur le champ syndical. Elle réaffirme l’engagement de la FSU dans l’Alliance écologique et sociale (AES-ex-Plus Jamais ça), avec l’Union syndicale Solidaire, Greenpeace et Oxfam. Cécile Duflot (Oxfam) a pris la parole pour réaffirmer l’urgence et la nécessité de ce croisement d’expérience entre syndicalisme et associations. Signalons que des structures CGT, comme la fédération Métaux, poursuivent une collaboration dans ce même cadre remis en cause au congrès de 2023 (par exemple sur la question des transports et de l’automobile lors d’un colloque en novembre 2024). L’AES a également pris langue avec le Pacte du pouvoir de vivre (plus de 60 organisations), dont la CFDT est la force motrice, ce qui a débouché le 16 juin 2024, au moment de la campagne électorale, par la publication de « 16 propositions pour changer la vie des gens » au sein de ce qui s’est nommé « Coalition 2024 » (lire ici : http://syndicollectif.fr/?p=24166). Le congrès FSU a validé cet engagement. La CGT poursuit en même temps son travail de réflexion pour approfondir dans ses structures (fédérations, interpro, UGICT) son propre projet syndical en la matière (cf : nos articles sur ce point dans Syndicollectif, par exemple : http://syndicollectif.fr/?p=24563).
Enfin, il est important de souligner la proximité des positionnements FSU et CGT sur la séquence politique de la formation du Nouveau Front populaire en juin-juillet 2024. La CGT a carrément appelé dès le matin du 11 juin (après la dissolution du 10 juin) à un « front populaire » (et à « l’union des gauches ») avant même qu’il occupe l’espace politique et médiatique. Ce positionnement (avant le 1er tour d’une élection) n’était pas arrivé depuis plus de 30 ans. La FSU a soutenu le programme du NFP et à faire barrage au RN et la droite. Tentant d’aller plus loin dans la réflexion, le texte proposé au congrès comportait (sous forme interrogative) la proposition suivante : « faut-il, et si oui comment, construire un cadre d’échanges impliquant les partis de gauche, le mouvement associatif et le syndicalisme-a minima celui de transformation sociale- où pourraient s’ébaucher des alternatives économiques, sociales et écologiques dans le respect de la diversité et de l’indépendance de chaque organisation ? ». Le texte voté répond négativement à la question en en développant une opérationnalité différenciée selon les cas : « Aussi, pour la FSU, porter la construction d’espaces d’échanges impliquant le syndicalisme, les mouvements associatifs et les partis politiques progressistes est souhaitable, Ces espaces devront prendre en compte des situations politiques locales parfois complexes. Les échanges doivent permettre de faire connaître nos mandats et notre projet syndical de transformation sociale ce qui peut permettre de nourrir la réflexion politique. Ils sont aussi un moyen de construire des mobilisations larges. Ces espaces d’échanges doivent aussi permettre de développer des alternatives économiques, sociales et écologiques dans le respect de la diversité et de l’indépendance de chaque organisation ». Benoît Teste était intervenu le 19 janvier dernier dans l’initiative organisée par Lucie Castets à Pantin, en présence de toutes les forces du Nouveau Front populaire, mais aussi d’Attac, du Planning familial, d’associations de lutte pour les droits des sans-papiers, etc.
« Maison commune » : les murs s’élèvent
Le grand évènement du congrès a bien entendu été la validation (à 96%) de la proposition de « maison commune » avec la CGT, en présence de Sophie Binet et d’une délégation forte d’une vingtaine de responsables confédéraux et fédéraux x: Bureau confédéral, FERC (éducation et culture), UFSE (syndicats de l’Etat), Fédération des services publics, Union des ingénieur-es et cadres UGICT).
Rappelons l’historique : les premiers échanges datent de 2009, mais ils n’ont jamais été très au-delà des secrétaires généraux (G. Aschieri FSU-B. Thibault CGT). Cette question restait quasiment inconnue dans la CGT, malgré les relances FSU. Depuis 2010, la FSU est porteuse d’une proposition de « nouvel outil syndical ». En février 2022, elle avait même envisagé la perspective d’Etats généraux du syndicalisme) avec la CGT et Solidaires, « sans exclusive » (encouragée à ce congrès de 2022 par la présence et la parole actives de Philippe Martinez pour la CGT, mais sans mandat formel). En mars 2023, le 53ème congrès CGT ne valide pas cette perspective. Mais en juillet de la même année, c’est la CGT qui reprend l’initiative en direction de la seule FSU. Un travail très sérieux est alors entamé avec un groupe de suivi, et une appropriation réelle dans les instances CGT (en premier lieu dans l’éducation, l’Etat, les services publics) y compris au Comité confédéral national (CCN) en juin 2024.
La question non résolue en 2022, côté FSU, était cependant la suivante : quel « outil » exactement ? Fusion ? Intégration ? Nouvelle organisation ou confédération ? Il suffit d’énumérer ces mots pour en comprendre le défi, tant les deux organisations sont à la fois convergentes dans l’action et les revendications (au moins depuis 1995), mais différentes en taille et mode de fonctionnement. Différentes aussi, peut-être encore davantage, en type de syndicalisme : très professionnel côté FSU, interprofessionnel côté CGT (au moins dans la culture et l’histoire longue).
C’est pourquoi Benoît Teste a pu dire en janvier 2024 que « c’est à dessein que la FSU ne définit pas précisément les contours » du « nouvel outil syndical » proposé en 2022 (article dans Enjeux, revue du courant Unité et Action). D’autant que la direction CGT a dû justifier son choix de reprendre sérieusement le dialogue avec la FSU en mettant en avant une « histoire commune » interrompue après 1948. Ainsi dans ce même numéro d’Enjeux, Thomas Vacheron, secrétaire confédéral en charge de cette question, explique : « Nos histoires sont communes ; jusqu’en 1947, la FEN était la fédération de l’enseignement de la CGT. Aujourd’hui, la « culture majoritaire », nos analyses et nos revendications sont partagées ». Cette manière de voir les choses répond à une inquiétude possible dans la CGT, où l’histoire a une forte charge symbolique. Mais selon la manière dont elle a été parfois exprimée publiquement, elle a pu surprendre dans la FSU (ou ailleurs). La réunification entre CGT et CGT-U de 1936 renvoyait bien à des histoires (alors récentes) communes. Mais entre la FEN et la FSU, d’autres histoires (conflictuelles !) se sont déroulées. Et cette grille de lecture d’un « tronc commun » historique n’explique pas pourquoi il n’y a pas de rapprochement entre FO et la CGT depuis…1948. Autrement dit l’histoire n’efface pas le plus important : une approche convergente dans les grandes luttes syndicales du moment présent.
Aussi la FSU a dû préciser ses « lignes rouges », très clairement exprimées dans le congrès de févier 2025, et poser les termes des défis à relever : « Le processus de construction d’un nouvel outil syndical de transformation sociale ne peut se faire que progressivement, sur la base d’accords partagés. Si la question structurelle et organisationnelle de ce nouvel outil syndical va nécessairement se poser, elle ne pourra déboucher sur une quelconque absorption/fusion avec la CGT. Elle devra surmonter les difficultés de concurrence syndicale au sein de certains secteurs professionnels afin de préserver l’unité de chacune des deux organisations et de ne pas fragiliser leurs syndicats. L’existence de cultures syndicales parfois éloignées doit faire l’objet d’un travail et d’une réflexion pour créer du commun. »
Le plan architectural de la maison commune est donc inscrit sur le papier. Mieux, il donne déjà lieu à des initiatives communes non seulement sur le plan professionnel mais aussi entre les Unions départementales CGT et les Syndicats départementaux FSU (exemple : Pyrénées orientales). Dans plusieurs dizaines de villes ou départements, des délégations CGT ont assisté à des débats préparatoires du congrès FSU. Petit à petit, les murs de l’édifice s’élèvent.
Table ronde Binet-Teste : « 1+1 = 3 »
Immédiatement après le vote (96%) du congrès sur la « maison commune », les débats s’interrompent, et une table ronde avec deux convives mais passionnante s’est tenue : Benoit Teste et Sophie Binet. En voici quelques moments-clefs à partir de prises de notes.
Sophie Binet : « Ce vote nous oblige » commence-t-elle. Pour elle, cette convergence « forte » ne vient pas de « nulle part », mais d’une « histoire commune ». C’est cette approche (qui peut faire débat) qui est argumentée dans la CGT, où les symboles historiques comptent beaucoup. Pour toucher les cœurs, Sophie Binet rappelle une lutte mémorable de l’histoire ouvrière bretonne (le congrès est à Rennes…) : celle des sardinières de Douarnenez, notamment l’épisode de grève de plusieurs mois en 1924. « Nous avons une grand-mère commune » sourit-elle. Elle s’appelle Lucie Coliard, enseignante à la direction de la CGTU. Elle est envoyée sur place pour porter le soutien de la confédération à cette lutte de femmes exemplaire. Sophie Binet rappelle les rencontres CGT-FSU en 2009 entre Bernard Thibault et Gérard Aschieri (présent et salué dans la salle). Elle fait le parallèle entre l’identité CGT « de classe et de masse », et le projet FSU de « transformation sociale à vocation majoritaire ». Non pour cultiver des différences, mais pour dépasser les divisions : le taux de syndicalisation ne progresse pas malgré une offre syndicale devenue pléthorique. Il faut donc « travailler au rassemblement du syndicalisme » et « construire du neuf ensemble ».
Benoît Teste : « Entre nos deux organisations, beaucoup de choses se jouent, et peuvent être dynamisantes, mais pas uniquement à deux ». Il rappelle « les scénarios noirs » du contexte général. Et ajoute : « Le syndicalisme peut se rétracter, s’étriquer ». Un retour du « corporatisme est possible » avec l’influence de l’extrême-droite parmi les salarié-es et un refus possible de s’occuper de la « double besogne ». Alors qu’il s’agit de « changer radicalement de société ». Il poursuit : « nous n’avons pas choisi de donner une forme définitive à cette maison commune » ; « il faut conserver ce que nous faisons de bien » et viser plus que l’addition : « 1+1= 3 ». Il appelle aussi à prendre garde « à ne pas perdre des forces en route ; l’unité de la FSU doit demeurer ; il ne faudra pas la découper par secteurs ». Mais continuer à « mener les débats de fond et les sujets d’action ». La FSU a ses « spécificités à garder » : par exemple le « pluralisme », ou « le droit de tendance », et « cela ne s’oppose pas à l’unité ».
Sophie Binet explique que jusqu’ici, cela a marché grâce au « groupe de travail mensuel » entre CGT et FSU. Caroline Chevé est invitée à la commission exécutive confédérale (CEC) CGT. Mais elle préconise aussi de « construire pas le bas » entre instances locales (une quarantaine d’échanges auraient eu lieu). Elle appelle à « ne pas voir la CGT comme monolithique ». Elle ne fonctionne pas en « tendance », mais par un fédéralisme qui choisit ses « modes de fonctionnement ». Elle reprend l’image de l’addition : 1+1 ne font pas deux seulement, mais pas 1,5 non plus. L’enjeu, c’est 3 : « Nous sommes dans une guerre de mouvement, et pas de position » (selon la citation de Gramsci). Elle appelle à refuser « la logique hégémoniste », au « respect des cultures » et la « fertilisation réciproque ». Par exemple, l’expérience du secteur privé peut aider à traiter le « new public management » dans le secteur public. Elle revient sur les urgences de l’heure. Et toujours l’histoire : dans les années 1930, c’est l’unité syndicale qui donne sa dynamique au Front populaire. Idem pendant la guerre avec la « réunification syndicale de 1943, juste avant la mise en place du Conseil national de la résistance » (CNR).
Benoît Teste conclut : « L’unité est un chemin qui peut être long et difficile ». Il faudra « travailler sérieusement et apprendre à se connaître ». « Nos mandats vont maintenant plus loin que là où nous étions avant : nous avons trouvé un équilibre ». En tant que secrétaire général sortant, il est « fier d’avoir eu ce mandat ».
Sophie Binet termine en disant que plus on avance, plus il faudra « entrer dans le dur ». Elle appelle par exemple à surmonter les « enjeux de pouvoir » et à ne pas « jouer les gardiens du temple et ne pas donner de leçon ».
Tonnerre d’applaudissements.
Maison : périmètre extérieur et pièces intérieures
La prochaine grande étape sera bien entendu le congrès confédéral CGT de mars 2026. D’ici là des questions en suspens vont se poser.
Une des premières est celle de l’Union syndicale Solidaires. La CGT n’a pas souhaité en juillet 2023 s’adresser à Solidaires dans les mêmes termes que pour la FSU. Solidaires, à son congrès de mars 2024, n’a pas non plus montré de volonté dans ce sens (voir notre article sur le risque « d’isolement« : http://syndicollectif.fr/?p=23746) tout en décidant d’ouvrir un débat interne. Bien entendu les contacts ne sont pas rompus. Thomas Vacheron (CGT), Murielle Guilbert et Julia Ferrua (Solidaires) ont dialogué dans la revue Ecole Emancipée de janvier 2025, et les co-déléguées généraux de Solidaires ont pu conclure : « Nous pensons que parler ainsi de maison commune du syndicalisme permet d’ouvrir à d’autres syndicats la perspective d’une idée de rapprochements et de la nécessaire unité. » Et puisque la FSU a toujours répété qu’elle agissait « sans exclusive », le débat peut en être facilité. Dans la CGT, il est souhaitable qu’il progresse, notamment si la notion de rassemblements « à vocation majoritaire » était approuvée conjointement, comme elle l’est entre FSU et CGT. CGT, FSU et Solidaires sont la plupart du temps en action commune sur les grands enjeux revendicatifs, depuis au moins la fin des années 1990.
Quant aux pièces intérieures de la maison commune, et surtout à son toit, il est certain que comme le dit Benoît Teste : « La bonne nouvelle c’est que les ennuis commencent ! » Dit autrement il faudra « rentrer dans le dur » (Sophie Binet dans la table ronde !). Ainsi donner une définition structurelle (légale ?) de l’édifice commun, avec des moyens partagés. Envisager des listes communes aux élections professionnelles, lorsqu’elles apparaissent pertinentes selon les secteurs et les réalités locales, comme des marques d’aboutissement. Et trouver des solutions partagées dans les secteurs professionnels non enseignants (territoires, Pôle emploi…).
Le danger serait une déception autour d’un simple affichage. Mais on peut penser, à l’issue de ce congrès, que le processus ne peut plus revenir en arrière. La FSU ne peut pas revenir à la seule autonomie et la CGT a un besoin vital de construire l’imaginaire d’une confédération unitaire du travail à la mesure de son histoire et des défis contemporains. Un nouveau souffle ambitieux est nécessaire, et l’addition des sigles ne suffit évidemment pas. Lier la construction intersyndicale (à 8) et la consolidation des plus « proches maisons », est une nécessité. Mais tout le monde doit rester dans le même village. Les vents mauvais menacent de plus en plus rapidement le socle démocratique commun. Trouver une manière d’institutionnaliser la réflexion (une sorte d’université ouverte ? de convention syndicale à inventer ?) sur des positionnements interprofessionnels est à la mesure du temps présent.
Le 25 février 2025.