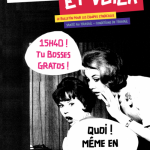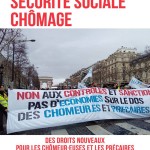A l’occasion des 130 ans de la CGT (1995-2025), la revue trimestrielle La Vie ouvrière, « revue du travail et des luttes sociales », publie une « rencontre » entre Sophie Binet, secrétaire générale, et Karel Yon, sociologue, pour un débat sur les « perspectives« . Cette conversation introduit un dossier complet sur ce qui fait les « valeurs » de la CGT, ses « structures » sous toutes les coutures, et son avenir ou plus généralement celui du syndicalisme, dans une société confrontée à des bouleversements sociaux, internationaux, écologiques. Quelles « perspectives de progrès« ? Ou encore : quel message « politique » propre peut délivrer le syndicalisme?
Notre rubrique EmanciPassion :
Karel Yon a dirigé la publication : « Le syndicalisme est politique » (La Dispute-2023), avec des contributions de : Sophie Béroud, Pauline Delage, Fanny Galot, Baptiste Giraud, Guillaume Gourgues, Maxime Quijoux, Adrien Thomas.
- Télécharger l’entretien : NVO-itw K Yon S binet
Syndicalisme et « perspectives de progrès »
 Photo Laurent Hazgui pour la VO
Photo Laurent Hazgui pour la VO
Rencontre
SOPHIE BINET ET KAREL YON
« C’est grâce à l’action syndicale qu’on peut ouvrir des perspectives de progrès »
Bouleversements géopolitiques, extrême droite, stratégies de lutte, unité… À l’occasion de ce numéro anniversaire, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT et Karel Yon, sociologue, échangent sur les défis majeurs auxquels sont confrontés le syndicalisme et la CGT.
La CGT souffle cette année sa 130e bougie. Comment se porte-t-elle ?
SOPHIE BINET Emmanuel Macron a voulu signer l’acte de décès du syndicalisme car dans la « start-up nation », il n’y a pas de syndicats. Mais avec le conflit des retraites de 2023, nous avons montré la centralité de notre rôle. Nous avons retrouvé, en 2023, le niveau record du nombre de grévistes atteint en 2010. Le levier de l’action collective est donc bel et bien vivant. Par ailleurs, lors des élections législatives anticipées qu’Emmanuel Macron a provoquées l’été dernier, nous avons déjoué tous les pronostics et réussi non seulement à empêcher l’arrivée de Jordan Bardella à Matignon, mais aussi à ce que la gauche finisse en tête ! Emmanuel Macron nous a ensuite volé les résultats de notre vote, mais il n’a pas de majorité et ses gouvernements sont si fragiles qu’ils ne peuvent dérouler les nombreuses réformes qu’il avait prévues. Le syndicalisme est donc bien vivant et en forme ! Cette année, il est bien sûr confronté à des défis immenses mais il reste dans une position stratégique pour aborder tous les enjeux d’avenir. C’est notamment grâce à l’action syndicale qu’on peut ouvrir des perspectives de progrès. Le signal de confiance, ce sont les nouvelles adhésions gagnées à la suite des mobili- sations de 2023. La cote de popularité des organisations syndicales est bonne, nous ne sommes pas atteints par la défiance des Français vis-à-vis des partis politiques et des élites d’une façon générale. Cela confirme l’ampleur de nos responsabilités. Les syndicats donnent encore le sentiment d’être des boussoles pour défendre les salariés.
KAREL YON Le syndicalisme se porte bien mieux que ce que des oiseaux de mauvais augure pouvaient annoncer. Les années 2023 et 2024 ont en effet été des moments d’affirmation du rôle structurant des syndicats dans la mobilisation sociale et politique, et, pour la première fois depuis longtemps, cela s’est traduit par un regain de syndicalisation. C’est d’autant plus important que le syndicalisme reste confronté à des défis majeurs. La statistique publique montre en effet un recul de la présence syndicale dans les entreprises, ce qui se traduit par un déclin aussi bien de la conflictualité gréviste que de la participation aux élections professionnelles. Nous sommes dans un contexte où le discours dominant est celui de la remise en cause des solidarités, de l’intérêt d’agir collectivement et ce, au profit des stratégies individuelles.
SOPHIE BINET Je partage avec Karel le constat sur les défis à relever. Les déserts syndicaux progressent en France. Cela confirme ce que nous disons depuis des années sur la représentativité. Il ne s’agit pas d’une course à l’échalote, de savoir qui sera le premier ou le deuxième syndicat. L’enjeu, c’est une question globale posée à tout le syndicalisme. Ces déserts syndicaux n’existent pas par magie. Ils sont la conséquence de stratégies patronales, de la répression syndicale et du recul des droits à cause des ordonnances travail, les régressions qui vont avec en termes de conventions collectives, d’accords de branche, etc. Nous entrons dans une période marquée par une exacerbation des rapports de classe, avec une extrême droite soutenue par un patronat qui ne veut plus faire de compromis.
Face à ces défis, de quels atouts dispose le syndicalisme ?
KAREL YON Les syndicats conservent une légitimité que n’ont pas d’autres cadres d’engagement, comme les partis politiques qui semblent de plus en plus réservés à des franges privilégiées de la population. La citoyenneté sociale repose dans notre pays sur un droit syndical important, des obligations en matière de représentation du personnel, un droit de grève relativement protecteur. Certes ces institutions sont de plus en plus remises en cause, mais il y a de beaux restes. Tout cela permet aux syndicats d’être ancrés dans la diversité du monde du travail. Les représentants syndicaux ont gagné leur légitimité auprès de leurs collègues. Ils et elles offrent une image de la société beaucoup plus en phase avec sa réalité que les partis politiques. Les syndicalistes sont cadres, ouvriers, employés. Ce sont des hommes et des femmes, des personnes racisées ou non, issues de vagues d’immigration plus ou moins récentes, etc.
SOPHIE BINET Le point fort du syndicalisme, c’est qu’on se rassemble à partir de notre travail. Quand on est au boulot, on est unis entre collègues pour bien faire notre travail, et, encore plus quand on est en lutte, on est unis pour gagner face à notre patron. Un des leviers majeurs pour combattre l’extrême droite, c’est d’ailleurs de réhabiliter le conflit de classe face aux conflits identitaires que l’extrême droite veut monter en épingle. Et puis, le syndicalisme, c’est l’outil d’émancipation des travailleurs par eux-mêmes. Dans l’approche CGT, nous ne donnons pas des leçons d’en haut. Les travailleurs et les travailleuses s’organisent et décident d’eux-mêmes de ce qu’ils ont à faire. Cela dit, c’est un chantier sur lequel on doit quand même s’améliorer car il y a des tendances au délégataire dans nos pratiques.
C’est-à-dire ?
SOPHIE BINET De plus en plus de syndicats reposent sur quelques élus et mandatés. La pratique démocratique avec les syndiqués prend du temps, exige des moyens. Ils ne vont pas forcément aller aux réunions, il y a donc une solution de facilité à se replier sur un petit noyau. Or, il est crucial que les syndiqués, plus largement les salariés, aient un rapport démocratique avec leurs syndicats. C’est ce que nous a enseigné la mobilisation des Gilets jaunes. Certains d’entre eux disaient : « On ne va pas avec les syndicats parce qu’on veut pouvoir déci- der nous-mêmes .» C’est vraiment problématique parce que, normalement, c’est tout l’inverse. C’est parce que l’on se syndique que l’on reprend la main sur son travail et sur sa vie, que l’on peut gagner des leviers d’action pour relever la tête. C’est parce que l’on se syndique que l’on s’émancipe. Mais s’ils nous ont vus comme ça, cela veut dire aussi que l’on a des questions à se poser. La CGT doit être vue comme un outil d’émancipation et pas comme quelque chose qui fasse perdre sa liberté. Le syndicalisme donne les moyens de s’émanciper face à son patron, mais aussi face à son conjoint. Et quand on est une femme, c’est un vecteur d’émancipation au travail mais aussi dans la vie.
KAREL YON La création des CSE a renforcé la concentration des instances de représentation. Quand on est élu du personnel en entreprise, on est de plus en plus représentant d’une vaste popu- lation de salariés. On est censé maîtriser des compétences relevant du droit, de la comptabilité, de la santé au travail, etc. L’action syndicale finit par reposer sur des spécialistes. Il y a donc aussi un vrai enjeu militant à s’appuyer intelligemment sur ces institutions. Pas pour les rejeter, évidemment, mais pour faire en sorte de ne pas être pris au piège de la spécialisation.
Comment éviter ces écueils liés aux ordonnances Macron, notamment ?
SOPHIE BINET Il faut bien évidemment contester ces ordonnances et il nous faut en faire un sujet majeur du prochain débat présidentiel. Ce que nous voulons, c’est gagner un espace pour que les salarié.e.s puissent reprendre la main sur leur travail, sur les stratégies économiques et même sur la finalité de leur entreprise. C’est nous qui produisons les richesses, nous devons pouvoir décider de la finalité de notre travail ! L’enjeu, c’est de pouvoir dire, par exemple : « Je suis salarié de Thales, dans le secteur de l’armement. Mais avec mes savoir-faire, je peux aussi fabriquer de l’imagerie médicale, alors qu’il y a un énorme besoin en Europe. » Ce que j’évoque, c’est un projet que la CGT Thales a monté avec grande difficulté. Il nous a même fallu dix ans. Mais j’ai été très fière, en juillet dernier, de venir lancer à Grenoble la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC ) d’imagerie médicale Axel. Et ça, il faudrait que l’on puisse le faire partout.
KAREL YON De nombreux chercheurs, en lien avec les organisations syndicales, ont réfléchi à des pro- positions pour refonder la citoyenneté sociale. C’est un enjeu politique autant que social, car le recul de la démocratie au travail favorise l’extrême droite. Le risque de voir le Rassemblement national arriver à la tête du pays est toujours là. Sophie l’a dit, la surprise du deuxième tour lors du scrutin de 2024 a été possible parce que les syndicats ont mis leurs forces dans la bataille politique. Il va falloir de nouveau interpeller toutes les organisations syndicales et les partis de gauche sur ce sujet. En effet, la gauche a besoin du mouvement syndical pour gagner face à l’extrême droite, et les syndicats ont besoin de la gauche pour se redéployer. Il faut donc recréer les conditions de l’unité autour d’un agenda de réformes favorables au monde du travail et décliné en autant de propositions de lois.
Quelles stratégies syndicales déployer ?
SOPHIE BINET Évidemment, il faut changer la loi, mais il ne faut pas croire que si on supprime les ordonnances, tout sera réglé. Revoyons aussi nos pratiques syndicales en contournant les obstacles que le patronat place devant nous. Face à un agenda patronal ou gouvernemental de régression, il faut mobiliser contre, c’est clair. Mais il arrive aussi qu’il y ait un agenda simplement « occupationnel » pour lequel il faut se rendre disponible en mettant un autre sujet à l’ordre du jour. Il nous faut hacker l’agenda patronal et imposer nos sujets à la place. Ce que le patronat sait très bien faire malheureusement : les concertations sur les retraites étaient censées parler du renforcement de la retraite par répartition. Le patronat a pourtant réussi à ce qu’on y parle de la capita- lisation. C’est riche d’enseignements. Il y a un sport qui doit nous servir de leçon, c’est le judo ! Nous devons prendre la force de l’adversaire pour l’utiliser contre lui. Et donc imposer effectivement nos propres thèmes dans les discussions.
KAREL YON Ce que Sophie évoque est fondamental, c’est la question de l’autonomie stratégique du syndicalisme. En entreprise, par exemple, pour ne pas réduire le syndicalisme à une petite équipe d’élus, les collectifs militants doivent pouvoir exister indépendamment du rythme des instances de représentation du personnel. Emmanuel Macron veut bien des syndicats, à condition qu’ils servent à légitimer les décisions du patron auprès des salariés. Pour lutter contre cela, le syndicalisme doit pouvoir exister indépendamment des structures et des logiques de l’entreprise.
 photo Laurent Hasgui pour la VO
photo Laurent Hasgui pour la VO
Mais comment met-on cela en œuvre ?
SOPHIE BINET C’est toute la complexité. Il ne s’agit pas de faire la politique de la chaise vide et de dire : « C’est des trucs patronaux, on n’y va pas. ». C’est plus compliqué que ça. Quand il y a une feuille de route gouvernementale ou patronale, il faut d’abord regarder. Et s’il y a des reculs, il faut mobiliser pour les empêcher. Mais il ne faut pas s’enfermer dans leurs sujets mais en faire exister d’autres à partir des priorités des salarié.e.s. C’est ce que nous avons fait l’an dernier avec les plans sociaux dans l’industrie. Aucune force politique ne traitait alors de cette question, et certainement pas le gouvernement. Macron avait soi-disant réindustrialisé le pays alors qu’en réalité sa politique de l’offre est un échec. Or, la CGT a ramené le sujet sur la table. Nous avons changé l’état des consciences, tout le monde a reconnu qu’il y avait une désindustrialisation et nous avons mis nos efforts sur des luttes emblématiques avec de premières victoires à Valdunes [dernier fabricant français de roues ferroviaires] et à la centrale thermique de Gardane, qui seront suivies, je l’espère, à la Fonderie de Bretagne, Vencorex [chimie], Chapelle d’Arblay [papeterie]… C’est très important pour donner confiance et créer un effet d’entraînement.
Vous avez évoqué l’un et l’autre les mobilisations de 2023, l’unité syndicale était alors puissante, qu’en est-il aujourd’hui à l’heure des concertations sur les retraites ?
SOPHIE BINET L’unité est toujours là. C’est la première fois dans l’histoire sociale qu’il y a une intersyndicale qui dure si longtemps. Évidemment, elle est plus compliquée qu’en 2023, et il est normal d’avoir des débats entre nous sur la concertation en cours. Mais on se parle toujours et nous avons la maturité de nous dire que ce qui avait permis l’unité syndicale en 2023, il faut le conserver. C’est-à-dire accepter la diversité des analyses et se dire que ça n’est pas grave si on n’est pas d’accord sur tout. C’est d’ailleurs un sujet crucial : au moment où l’on fête les 130 ans de la CGT, il nous faut faire le bilan de l’affaiblissement de la négociation collective. Pour gagner, il faut appuyer la négociation sur le rapport de force et la mobilisation des salarié.e.s. Nous avons là un désaccord structurant avec les autres organisations syndicales qui considèrent, en général, que la négociation exclut par principe la mobilisation ! Ensuite, la division syndicale est utilisée par les patrons pour toujours négocier sur la base de leur propre feuille de route. Que l’on soit à l’échelle d’une entreprise, d’une branche ou au niveau interprofessionnel, les négociations où l’on travaille sur la base du document syndical et non du texte patronal sont très rares. Pourquoi ? Parce que les organisations syndicales sont divisées et sont incapables d’arriver avec le même texte. Or, quand on négocie sur la base du document syndical, le résultat, c’est que l’accord signé comporte de vraies avancées. À l’inverse, si on bouge seulement les virgules du texte patronal, c’est une « cata ». J’ai négocié la convention 190 sur les violences sexistes et sexuelles à l’échelle de l’organisation internationale du travail à Genève. Il y avait une voix syndicale unique et nous avions une porte-parole pour toute notre délégation au plan mondial. Nous avions des réunions de prépa- ration où nous définissions le mandat, puis nous assistions à la séance et nous faisions ensuite une analyse collective. Nous nous sommes, en plus, appuyées sur la mobilisation féministe et syndicale qui a suivi immédiatement #MeToo. Ça change tout, nous étions très fort.e.s et nous avons d’ailleurs remporté une magnifique victoire. Il serait possible de négocier de cette façon chez nous, à condition que les syndicats aient conscience que l’enjeu n’est pas de défendre leurs intérêts de chapelle mais de maximiser le rapport de force. Les seuls moments où on arrive à changer la donne, c’est quand nous mobilisons et que nous avons une stratégie unitaire. C’est le cas aujourd’hui en Espagne : le salaire minimum y a augmenté de 20 % en cinq ans et la réduction du temps de travail est à l’ordre du jour. Il y a, là-bas, une stratégie unitaire très solide entre l’Union générale des travailleurs (UGT) et les Commissions ouvrières et donc un vrai rapport de force. Cela devrait nous inspirer.
Le rapport de force passe aussi par la grève, et c’est là que le bât blesse bien souvent. Karel Yon, vous dites qu’il y a souvent une incapacité syndicale à convertir le soutien massif des salariés en actions de grèves, pourquoi ?
KAREL YON Pour qu’il puisse y avoir grève, il faut déjà qu’il y ait une présence syndicale, or celle-ci recule, comme nous l’avons déjà dit, et il y a aussi une forte répression antisyndicale ! Les évolutions comme le télétravail contribuent à déstructurer les collectifs. Sur un même lieu de travail, tout le monde n’a pas toujours le même employeur. Cela complique les choses. Mais les gens sont prêts à faire grève quand le jeu en vaut la chandelle, souvent pour les salaires. La grève est possible quand il y a un travail pour la préparer, des militants pour l’animer, des ressources financières aussi pour tenir. Car, comme Sophie le disait, l’intransigeance patronale, encouragée par celle des pouvoirs publics, est de plus en plus forte. La grève n’a pas perdu de son utilité, simplement elle devient plus difficile à organiser.
SOPHIE BINET Il ne faut pas laisser dire que la grève, c’est fini. Le 5 décembre dernier, il ya eu une grève historique des fonctionnaires, alors qu’on entendait dire depuis des années qu’ils et elles ne se mobilisaient plus. Ce qui déclenche une grève, c’est quand il y a une revendication concrète, perçue comme atteignable. La construction du rapport de force au niveau interprofessionnel est plus compliquée. Lors des mobilisations retraites, il y a eu des grévistes, à un niveau record même, mais pas encore assez de notre point de vue. Parce qu’il n’y a pas eu suffisamment de travail d’ancrage à l’entreprise pour faire le lien entre salaires et retraites. S’il y avait eu beaucoup plus de conflits salaires, comme on a pu le voir chez Vertbaudet [lire aussi p. 60], cela aurait permis de lier la bataille interprofessionnelle sur les retraites avec celle face aux patrons pour les salaires. Parce que pour une même grève, on a deux revendications et donc deux possibilités de gagner. Le souci en France, c’est qu’il y a des grèves par procuration mais aussi un syndicalisme par procuration. C’est d’ailleurs ce qui choque nos homologues européens qui disent :
« Vous les Français, vous êtes hallucinants, vous mettez des millions de personnes dans la rue, bien plus nombreux que le nombre de syndiqués que vous avez. »
Comment transformer l’essai ?
SOPHIE BINET Il faut convertir la sympathie envers les organisations syndicales en adhésions. Nous ne proposons pas assez la syndicalisation, qui est pourtant un levier central de la construction du rapport de force. On pense que les gens vont venir tout seuls et même que c’est commercial de proposer de se syndiquer. Nous fêtons les 130 ans de la CGT, souvenons-nous que les périodes de conquêtes sociales sont les périodes au cours des- quelles la CGT a le meilleur taux de syndicalisation.
La CGT a traversé bien des crises depuis sa création, quels sont les défis majeurs auxquels elle est confrontée aujourd’hui ?
SOPHIE BINET L’un des enjeux qui se pose à nous de façon aiguë, c’est la question environnementale. L’exacerbation des rapports de classe est aussi liée à ce sujet. On voit bien que la part du gâteau ne peut pas augmenter éternellement puisque c’est la mort de notre planète qui s’organise, et si le syndicalisme ne s’empare pas de cette question, on ne dépassera jamais les contradictions avec les questions sociales. Or, le capital prospère sur ces contradictions, sur le climato-scepticisme porté par l’extrême droite. Et à la fin, ce sont toujours les mêmes qui passent à la caisse ! C’est pour cela que nous avons déployé le plan d’action syndicale pour l’environnement et l’industrie. Peut-être y aura-t-il demain 30, 40, 50, 60 % de la planète qui sera invivable ou alors il sera compliqué d’y vivre. Mais les milliardaires auront toujours des petits paradis dans lesquels ils pourront habiter. C’est la raison pour laquelle le capital tourne aujourd’hui clairement le dos au défi environnemental. Avec la montée du climato-scepticisme, ils n’ont même plus besoin de faire de greenwashing. Au moins, Il y a une vraie clarification sur ce point.
KAREL YON Depuis le retour de Trump, il y a en effet de moins en moins de patrons qui font semblant de croire au capitalisme vert. Les salariés et leurs syndicats ont un rôle majeur à jouer dans la redi- rection écologique. Or, ils sont le plus souvent marginalisés dans les débats sur la transition. Il y a un enjeu à faire exister la parole du travail dans le débat écologique. De façon plus générale, l’enjeu, demain, pour la CGT est de savoir répondre aux transformations du capitalisme. Elle était à l’origine basée sur des syndicats de métier et a ensuite fait la bascule vers le syndicalisme d’industrie, au moment où le capitalisme changeait de dimension. Aujourd’hui, de nouveaux défis se posent avec un morcellement croissant des entreprises, l’émergence de formes de travail pseudo-indépendant. La forme organisationnelle de base de la CGT, héritée du capitalisme industriel, reste celle du syndicat d’entreprise. On peut se demander si cette forme fait toujours sens, qu’il s’agisse de répondre à l’éclate- ment des collectifs de travail ou de résister aux politiques néolibérales qui cherchent justement à enfermer les syndicats dans l’entreprise.
Dans le contexte géopolitique actuel, la surenchère guerrière sert d’alibi pour appeler à de nouveaux reculs sociaux…
SOPHIE BINET Avant, l’excuse pour contrer le progrès social, c’était la compétitivité internationale. Aujourd’hui, c’est la guerre, demain ça sera autre chose. Le problème de la guerre, c’est que ça fait très peur, et, effectivement, la CGT ne nie pas qu’il y a de nouveaux défis internationaux. Il y en a, certes, qui sont liés à la mise en place d’une internationale d’extrême droite, mais les premiers défis posés sont d’ordre démocratique, pas militaire. Le point commun entre Trump et Poutine, c’est leur action organisée pour déstabiliser les démocraties, européennes notamment. Si notre réponse est de nous militariser et de supprimer les budgets sociaux et les services publics, alors nous ne faisons que dérouler le tapis rouge à l’extrême droite qui prospère sur le déclassement, les désordres sociaux et environnementaux. Un véritable cercle vicieux ! Le danger principal est démocratique, il faut donc sanctuariser les services publics et donner des perspectives au monde du travail.
KAREL YON L’enjeu pour le syndicalisme, c’est de participer à l’affirmation d’une alternative sociale, démocratique et environnementale, alors que nous sommes pris dans une fuite en avant militariste, qui va justifier plus de sacrifices sociaux, et renforcer l’extrême droite. L’instrumentalisation de la rhétorique de l’« économie de guerre » pour justifier les mêmes politiques néolibérales est une évidence. Quand on regarde ce qu’est vraiment une économie de guerre, comme celle que la France a connue pendant la Première Guerre mondiale, ou les États- Unis pendant la guerre 39-45, le souci de concorde nationale avait produit un ensemble de droits sociaux pour les travailleurs et de droits d’expression pour les syndicats. C’est tout le contraire de ce qui est dans la tête des gouvernants actuels.
Quelles actions soutenir, aujourd’hui, sur le plan géopolitique ?
SOPHIE BINET Il faut nous protéger face à ces menaces. La première des actions consiste à défendre la liberté de la presse, à reprendre en main les réseaux sociaux, le numérique, afin de les protéger des milliardaires. La deuxième doit préserver la recherche face à ce monde de post-vérité que l’on veut nous imposer. À cet égard, l’Union européenne doit annoncer un grand plan d’investissement dans la recherche. Il y a une opportunité énorme, avec nombre de cerveaux américains à accueillir. Sur le plan géopolitique, l’Europe doit s’émanciper des États-Unis. Il faut changer de logiciel sur la construction européenne, jusque-là bâtie sur un mode d’inféodation vis-à-vis des États-Unis. En s’autonomisant, elle doit s’affirmer non plus comme une Europe de la concurrence mais comme une Europe de la coopération. Aujourd’hui, le premier lieu de dumping social, fiscal et environnemental, ce ne sont pas les Bahamas ou la Chine, c’est l’Europe. Le premier lieu de délocalisation de nos entre- prises, c’est l’Europe. Et donc, pour résister face à l’offensive de Trump et de Musk, la solution n’est pas de créer un choc de dérégulation, mais plutôt d’harmoniser les normes fiscales, environnementales, sociales vers le haut. L’Europe doit prendre des mesures fortes pour soutenir son industrie et lui permettre d’être souveraine dans ses choix. En clair, avoir une stratégie diplomatique et de défense basée sur le multilatéralisme et donc l’ONU. Il faut réformer cette dernière et faire sauter le verrou de son Conseil de sécurité qui aujourd’hui l’empêche de jouer son rôle. Enfin, l’Europe doit revoir ses alliances pour se tourner vers le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Indonésie, les grandes démocraties du Sud global pour se sortir de cet étau Trump-Poutine.
De quels outils dispose-t-on pour peser dans le débat ?
KAREL YON Le syndicalisme est un excellent outil, à condition d’assumer la dimension politique de son action ! Je donnerai deux exemples. D’abord, l’actualité aux États-Unis témoigne d’un alignement du grand patronat américain, en particulier celui de la tech, avec le gouvernement Trump. Or, les syndicats sont en première ligne face aux patrons de Tesla, de Google ou de Facebook qui dirigent leurs entreprises comme ils entendent gouverner le monde, en seigneurs féodaux. Il y a des batailles, aux États-Unis et ailleurs, pour imposer la présence de syndicats dans ces entreprises. Ces luttes portent ainsi une dimension politique et démocratique. Second exemple : on entend beaucoup le RN dire qu’il est le premier parti ouvrier. Face à cette prétention de l’extrême droite à représenter les classes populaires, la seule force capable de lui opposer un démenti, c’est le syndicalisme. Pour cet ancrage social que j’évoquais tout à l’heure, et aussi parce que le monde du travail est le seul espace institué de citoyenneté où la nationalité n’est pas une condition de participation.
SOPHIE BINET Dans notre ADN CGT, il y a l’internationalisme depuis 1895. Notre internationale ouvrière était alors modeste, aujourd’hui, avec nos instances comme la Confédération syndicale internationale (CSI), elle rayonne sur quasiment tous les pays. Je suis confiante car nous sommes les seuls à avoir une telle internationale, qui puisse être un levier concret d’action. Et même si un vaste chantier se présente à nous, et qu’il nous faut plus de force de frappe, elle nous donne aussi les moyens d’avoir des stratégies pour agir sur les multinationales et sur nos gouvernements de façon concertée. La bonne nouvelle dans l’élection de Trump, c’est qu’elle apporte une clarification majeure : une internationale d’extrême droite est bien alignée avec le capital. Toute la tech américaine était présente lors de l’investiture de Trump, tout comme l’homme le plus riche de France, Bernard Arnault. D’ailleurs, on l’a vu quand il y a eu cette polémique, quand j’ai dit « les rats quittent le navire » en évoquant les patrons qui menaçaient de délocaliser, et que ces mêmes patrons n’ont visiblement pas compris ce que c’était qu’une métaphore… Qui a alors lancé l’offensive contre la CGT ? C’est Jordan Bardella qui est intervenu pour faire huer la CGT et défendre Bernard Arnault. Donc, qui défend les patrons aujourd’hui ? L’extrême droite.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR EVA EMEYRIAT