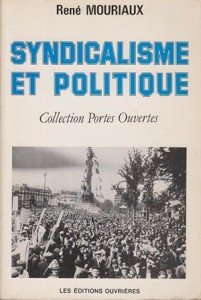Le numéro 60 (janvier 2024) de la revue Contretemps publie un dossier sur la situation politique française en « temps de crise« . Dans ce dossier figure une chronique (par Jean-Claude Mamet) du livre : « Le syndicalisme est politique », sous la direction de Karel Yon, sous-titré : « Questions stratégiques pour un renouveau syndical » (La Dispute, 2023, 16 euros).
- Karel Yon est sociologue et politiste, IDHES, CNRS Université Paris-Nanterre. Le livre contient des contributions de : Sophie Béroud, Pauline Delage, Fanny Gallot, Baptiste Giraud, Guillaume Gourgues, Maxime Quijoux, Adrien Thomas.
- Télécharger l’article : CT60, syndicalisme et politique
Syndicalisme et politique
Jean-Claude Mamet
Affirmer tout de go le caractère « politique » du syndicalisme est devenu osé, voire un peu provocateur. C’est peu fréquent depuis 30 ans, période de « dépolitisation syndicale », comme le rappelle Karel Yon (sociologue et politiste, université Paris-Nanterre) coordinateur du livre. Il y a 38 ans cependant (1985), René Mouriaux (politiste, chercheur au CEVIPOF) publiait Syndicalisme et politique (Les Éditions Ouvrières). On remarquera qu’il utilise la conjonction « et » reliant deux notions, et non le verbe « est » affirmatif ! Des aspects de sa méthodologie, qui reste actuelle, seront rappelés plus loin. Sera rappelé aussi le « manuel » de Sociologie politique du syndicalisme, daté de 2018 (chez Armand Colin), dont les trois auteurs et autrice (Baptiste Giraud, Sophie Béroud, Karel Yon) ont participé à ce nouveau travail, et dont le chapitre 2 traite précisément du même sujet : « Pluralisme et (dé)politisation du syndicalisme », sous un angle plus large.
La première question est donc : pourquoi ces 30 ans et qu’est-ce qui a changé aujourd’hui ?
Dépolitisation, repolitisation ?
Nous abordons ici l’introduction (Karel Yon) et le premier chapitre du livre (Baptiste Giraud, Karel Yon).
Il y a 30 ans, l’année 1993 est celle de l’écroulement du mitterrandisme et du gouvernement socialiste aux élections législatives. Quelques années avant, c’est la chute de l’URSS. La fin du 20e siècle témoigne donc d’un double échec historique : l’espoir dévoyé d’une gauche au pouvoir, et la catastrophe du « socialisme réel » en Europe de l’Est. Or, le syndicalisme avait été fortement impliqué dans l’accompagnement et même le soutien de ces deux expériences dissemblables mais emblématiques.
C’est peu de dire que la CGT (très active dans l’Union de la gauche) a aussi soutenu le « communisme » et formé des cadres à cette vision du monde. Dès le 44e congrès de 1992, une certaine distanciation se manifeste, amplifiée lors de celui de 1995, en pleine grève de décembre. Ce 45e congrès révise les statuts de la CGT notamment en supprimant la notion de « socialisation des moyens de production », en raison de son rapport direct supposé avec feue l’URSS bureaucratique. Mais déjà des « oppositionnels » (le courant néo-stalinien « Continuer la CGT ») critiquaient cette décision de distanciation politique, surtout que rien ne la remplaçait. Puis Louis Viannet démissionne du Bureau politique du PCF en 1996, tandis que Bernard Thibault n’y est jamais entré et quitte le Comité national en 2001 (lire sur ce point le chapitre 2 de Sociologie politique du syndicalisme, évoqué plus haut).
Du côté de la CFDT (dont la direction avait participé aux Assises du socialisme en 1974), on rappelle que le « recentrage » (d’abord un repli sur son pré-carré syndical) débute dès 1978, que marque la défaite de l’Union de la gauche. Mais cela n’empêche pas la centrale de pactiser fortement avec le gouvernement Mitterrand (après la victoire surprise), et d’en subir assez vite les effets négatifs (par exemple aux élections professionnelles de 1983). La CFDT de Nicole Notat s’éloigne ensuite de la gauche jusqu’à assumer en 1995 le soutien assumé à une réforme « d’un gouvernement de droite », comme le dit sans ambages le secrétaire général adjoint Marcel Grignard en 2010 dans une rétrospective de toutes ces années.
Les années 1990 et suivantes voient aussi la naissance de la FSU et de l’Union syndicale Solidaires, ainsi qu’un regain de luttes contre la montée du néolibéralisme agressif. Mais dans le syndicalisme de résistance (CGT, FSU, Solidaires, gauche CFDT…) et dans les divers collectifs d’action qui se forment à cette époque (par exemple Agir ensemble contre le chômage-AC !, ou Attac), il n’était tout simplement pas imaginable (sans même parler de FO) qu’une forme quelconque de rapports – et encore moins d’alliance organisée – s’établisse avec les forces de gauche en échec cuisant (côtés socialiste comme communiste). Au demeurant, en 1995 la gauche est totalement absente du champ politique ouvert par les mobilisations. Et en 1996, les États Généraux du mouvement social, qui rassemblent les forces sociales et syndicales actives, évacuent d’emblée tout lien avec le « politique », mais échouent à construire dans la durée « une politique » propre émanant de l’expérience des luttes. Une occasion manquée de marquer réellement une indépendance en positif. Résultat : en 1997, après la brusque dissolution, lorsque la gauche revient aux affaires avec Jospin, le mouvement social et syndical de lutte n’est pas prêt, notamment sur la loi des 35 heures. La CGT par exemple se refuse à formuler un contre-projet.
En 2005, la dépolitisation ambiante produit une grave crise dans la direction CGT (B. Thibault), à propos du Traité constitutionnel européen (TCE). Elle se refuse dans un premier temps à formuler une position critique au nom d’une conception de l’indépendance qui confine à une sorte de neutralité, malgré un discours officiel contraire.
Ainsi les 30 dernières années ont incontestablement produit une dépolitisation syndicale, assumée comme refus de subir les effets de la crise du politique à gauche, ce que Karel Yon appelle un « réflexe de survie » dans son introduction. Ce qui peut se comprendre, à condition qu’une nouvelle « stratégie » et un « renouveau » voient le jour, comme il nous y invite. On ne peut pas en effet échapper au champ politique, même si Force ouvrière en fait son credo dans le paysage syndical. À la fin du quinquennat Sarkozy, après le mouvement des retraites de 2010, un certain repositionnement se manifeste vers la gauche, aussi bien côté CGT, « qui sort de sa réserve » sur les positionnements électoraux (et côtoiera parfois assez ostensiblement J.L Mélenchon), que côté CFDT. Celle-ci finira par être l’interlocutrice syndicale de Hollande, rôle que Macron lui dénie depuis 2017, ce qui explique son tournant « syndicaliste » : elle n’a plus de miettes à négocier, et elle stagne en puissance. Voilà donc ce qui a changé pour expliquer à la fois l’apparition de l’intersyndicale complète au printemps 2023, et que celle-ci soit perçue « comme un nouvel acteur », parce qu’incarnant une autre forme de démocratie légitime : la « démocratie sociale », ou « l’irruption directe des intérêts des travailleurs dans le champ politique » (page 24). Par ailleurs l’extrême-droite menace la société, ce qui ne va pas non plus sans troubler à nouveau une autre partie du syndicalisme, réputée apolitique, atteinte dans ses racines. Cette frange de l’Intersyndicale serait sans doute peu désireuse d’assumer un choix politique douloureux vis-à-vis du RN, qui mord sur ses bases sympathisantes, pour les années 2024 et suivantes. Ce choix décisif se jouera tôt ou tard.
Les deux aspects du « politique » dans la Charte d’Amiens
Bien entendu les auteurs reviennent sur l’inévitable Charte d’Amiens (1906), constitutive de la doctrine syndicale française sur la politisation du syndicalisme. Mais, on ne le dira jamais assez, ce texte très beau et très concis produit aussi des ambiguïtés, notamment autour de la polysémie du mot « politique ».
Ce dédoublement de sens (au moins) n’est pas abordé et précisé dans le livre, contrairement à l’autre ouvrage cité de 2018 (Sociologie politique du syndicalisme, ch. 2). Le premier sens est celui communément retenu dans les pratiques syndicales officialisées : l’indépendance du syndicalisme, vis-à-vis des partis, du patronat et de l’État. Ou, plus globalement, du champ politique, précisément délaissé depuis 30 ans. La Charte explique que les syndicalistes qui seraient aussi membres de partis politiques peuvent bien faire ce qu’ils veulent, mais « à l’extérieur » du syndicat, qui ne doit pas s’en préoccuper. Mais elle préconise aussi, ce qui est moins connu ou retenu, la « double besogne » : celle « quotidienne » (les revendications courantes) et la perspective « d’avenir ». Autrement dit, l’émancipation « intégrale » des travailleurs, qui relève de la responsabilité du syndicalisme, appelé à être « la cellule de base de la société future » (ch.2, page 52) débarrassée de l’exploitation capitaliste.
Avec ces ajouts, le plan du nouveau livre peut être précisé. L’introduction et le chapitre 1, déjà évoqués, traitent du rapport au champ politique, et nous y reviendrons. Et les chapitres 3, 4 et 5 ouvrent des pistes de réflexion et de pratiques sur la « double besogne ». Le chapitre 2, écrit par Sophie Béroud (sociologue et politiste, Université Lyon 2), sur la « giletjaunisation » des syndicats, est un peu intermédiaire.
S’il ne fait aucun doute que les Gilets jaunes n’avaient aucun rapport avec les forces politiques constituées et ne voulaient pas en avoir, ils ont cependant ouvert une forme de mobilisation très « politique », au point de hanter la société depuis 2018. Sophie Béroud décrit un mouvement qui met en scène un pan totalement occulté jusqu’ici du monde du travail (et syndical) : elle ose la comparaison avec « la symbolique des sans-culottes de la Révolution française », notamment dans la référence à un « peuple » agissant : le fameux « nous » et sa fierté d’agir sous une forme « héroïque ». Ce peuple rassemblé, qui semble « sortir de nulle part », ne s’affronte certes pas aux petits patrons (et encore moins aux artisans), mais prend pour cible politique Macron comme patron du néolibéralisme (« on vient te chercher chez toi »). Il met sur la scène un pan invisible de la société, avec une sociologie spécifique (dont beaucoup de femmes), en partie prolongée dans la radicalité du démarrage des grèves de la fin de 2019 sur la retraite à points (RATP) et en 2023 : petites villes, campagnes. Les Gilets jaunes sauront aussi fabriquer à leur manière des formes « institutionnelles » inédites (territorialisation) sur les ronds-points. Vont-ils inspirer, « giletjauniser » durablement le syndicalisme ?
« Syndicalisme du combat économique »
Ce titre et ce chapitre (3) sont écrits par Guillaume Gourde (maître de conférences en sciences politiques à Lyon 2) et Maxime Quijoux (sociologue et politiste-CNRS-CNAM). Il ouvre des pistes pour des « alternatives » de démocratie du travail et de « combat économique », trop souvent délaissées ou vues comme des dangers de compromissions pour l’action syndicale. On parle ici de l’expérience des SCOP (Fralib !), des reprises d’entreprises, des propositions économiques ou industrielles, et bien entendu il faut ajouter maintenant des solutions écologiques à inventer dans la production (exemple : Chapelle Darblay). Ce qu’on peut appeler un « déjà-là » gestionnaire ou « autogestionnaire », ou au moins des pas en avant, comme l’expérience de LIP l’a montré en 1973. Faut-il rappeler la gestion des caisses de Sécurité sociale entre 1946 et 1967 ? On exige syndicalement un « droit de veto » contre des licenciements ou des restructurations, mais ensuite que faut-il proposer ? Là encore il vaut la peine de rappeler la Charte d’Amiens qui préconise que « le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera dans l’avenir le groupement de production et de répartition, base de la réorganisation sociale ». Comme souvent dans les textes vénérés du mouvement ouvrier, il y a des proclamations magnifiques, mais toujours envisagées pour… plus tard. Nous sommes là dans le déni du possible immédiat. Pourtant Marx écrivait en 1864 dans l’Adresse inaugurale de la Première internationale : « l’économie politique de la bourgeoisie » peut être « battue par l’économie politique de la classe ouvrière ». Dommage que ce filon ait été délaissé, y compris par les marxistes…
La portée émancipatrice du syndicalisme féministe et écologiste
Ce sont les chapitres 4 (Pauline Delage, sociologue, CNRS, et Fanny Gallot, historienne, CRHEC) et 5 (Adrien Thomas, politiste, LISER).
Le mouvement féministe a complètement changé le rapport au « social », pour comprendre comment sont faits les « mondes masculins » et féminins, renverser les hiérarchies quotidiennes au travail (qui dirige et comment) et dans la famille. Mais il a fallu un rapport de forces parfois extérieur (ainsi le monde du cinéma), des modes d’organisations nouveaux (commissions mixtes et non mixtes, liens associatifs), et mettre à jour des évidences niées ou cachées : violences du langage, des plaisanteries, jusqu’au harcèlement sexuel et aux viols. Il a fallu faire du droit autrement (« présomption d’innocence », versus « présomption de sincérité »), apprendre à « écouter la parole des victimes ». Au total il s’agit de « repenser le syndicalisme d’un point de vue féministe », si on veut l’articuler aussi à la tradition de « lutte des classes ».
Ces « dilemmes internes » touchent aussi et ô combien la conversion écologique du syndicalisme, dans son rapport à l’industrie, aux matières, à l’énergie, et aux risques angoissants d’emplois transformés ou supprimés. Les objectifs « à court et à long terme » s’entrechoquent dans leurs contradictions apparentes. Là aussi il est nécessaire de sortir de sa zone de confort et d’envisager des « alliances excédant le champ syndical ». On sait les vifs débats que cela a pu produire dans la CGT, par exemple avec le Collectif Plus jamais ça, à la fois plurisyndical et pluriassociatif, ce qui est une « révolution » dans la pratique habituelle si celle-ci est envisagée comme un mode pérenne de travail. Évidemment la qualité démocratique en est le corollaire : une « démocratie syndicale vivante », articulant le local à l’européen et au mondial, mais aussi la justice sociale et les solutions techniques, les travailleuses et travailleurs et « les intérêts de la société dans son ensemble ». Quoi de plus « politique » ?
Syndicalisme et pouvoir politique
On terminera par ce retour aux « questions stratégiques pour un renouveau syndical », voulu par les auteurs, et dont ils/elles voient les prémisses émerger après 30 ans de distanciation. Pour éclairer cela, ajoutons que le même Marx qui encourage « l’économie politique des travailleurs » les appelle aussi dans le même texte à « prendre le pouvoir », dont la nécessité serait « devenue le premier devoir de la classe ouvrière ». On sait que dans la Première Internationale se côtoyaient des courants politiques, mais aussi des syndicats (notamment anglais) et des coopératives. Néanmoins c’est bien l’option stratégique de la prise du pouvoir avec « un parti » que le « marxisme post-Marx » a surtout retenu pendant des décennies, les syndicats jouant dans ce schéma un rôle de soutien subalterne.
Les rédacteurs de la Charte d’Amiens, syndicalistes révolutionnaires, ont refusé ce rôle subalterne à juste titre (en proposant la besogne syndicale et politique « d’avenir »), mais ils ont jeté l’enfant avec l’eau de la baignoire : ils ont refusé d’occuper – et la notion même – de champ politique du pouvoir, l’autre face du « politique ». Leur conception passait par le « tout syndical ». René Mouriaux distingue (en 1985) au moins deux (voire trois) niveaux du « politique » : celui du projet (l’avenir) et celui du pouvoir.
Résumant les défis posés en ce sens pour le syndicalisme, Karel Yon pose la question suivante : « Est-il possible pour le syndicalisme d’instaurer un rapport aux partis et au champ de la compétition électorale qui ne relève pas de la subordination ? » (Page 37). Telle est bien le problème en effet. Auparavant, il avait expliqué qu’agir stratégiquement « c’est définir son propre théâtre d’opération ». Si on réfère cette proposition à la séquence de la lutte des retraites, on notera trois types de réponses, ou de conditions.
Premièrement, si l’Intersyndicale a demandé une « consultation citoyenne », puis soutenu le Référendum d’initiative partagée (RIP), elle est cependant restée dépendante des forces politiques dans la manière de l’obtenir. Dès lors que les études d’opinion montraient une grande confiance dans l’Intersyndicale pour résoudre les problèmes de la société au printemps 2023, alors les syndicats auraient pu envisager d’organiser eux-mêmes cette « consultation citoyenne » et demander aux partis de les soutenir. Les syndicats prenaient ainsi l’initiative politique, sans attendre les partis.
Deuxièmement, à l’heure où nous en parlons, la principale difficulté de la « repolitisation » est sans doute de recueillir un soutien populaire, ou en tout cas pas de rejet. Le passif est énorme. Le baromètre annuel de la CGT, qui mesure l’audience syndicale précisément depuis 1993 (institut CSA à l’époque), renvoie inexorablement à la CGT le reproche de sa trop grande « politisation », alors que sa combativité est approuvée. Certes, son histoire s’y prête. Mais la prise de distance de ses responsables nationaux avec le PCF (évoquée plus haut) ne semble pas avoir changé grand-chose. Même si une étude approfondie serait nécessaire, on touche ici à un problème très enraciné : d’une part le syndicalisme est pluraliste dans les préférences idéologiques de ses membres, d’autre part les « citoyen-nes-salarié-es » ne vivent pas la politique en congruence mécanique avec leur carte syndicale. Cette séparation du social et du politique est incrustée dans la société capitaliste, et il n’est nullement facile de la combattre. Elle s’est renforcée sans doute depuis les échecs politiques historiques du 20e siècle, au point de susciter la méfiance pour le mélange des genres. Certains syndicalistes estiment qu’il ne faut en aucun cas prendre un risque qui ne relève pas des prérogatives syndicales. Réhabiliter une gauche crédible et un syndicalisme attractif sont deux tâches complémentaires pour lever ces « interdits » auto-infligés. Mais par où commencer ? D’infinies précautions sont nécessaires. Aucun syndicat ne peut résoudre en solo ce problème. Le pluralisme et le collectif sont de rigueur, tant sur le plan politique que syndical. La perception de menaces graves peut aussi changer la donne.
Troisièmement, dans le chapitre 1 rédigé par Baptiste Girault et Karel Yon, il est proposé « une intervention directe du syndicalisme sur le terrain politique », pour « reconquérir le pouvoir » dont le néolibéralisme l’a dépossédé. Nous sommes bien là au cœur du problème. Il est proposé de bâtir des « alliances », et des « espaces d’élaboration ». Les auteurs ont l’audace d’imaginer une « coalition électorale élargie » (au-delà de la NUPES) qui réserve au « front syndical un espace autonome », avec des « circonscriptions réservées ». Tout est évidemment discutable, dès lors qu’il y a accord (ce qu’il faudrait vérifier) sur la nécessité de reprendre la main sur le politique. Mais il y a deux préalables : d’une part la confiance collective (ne pas être piégé) est aujourd’hui inexistante avec le monde partidaire, comme nous l’avons décrit un peu plus haut. D’autre part, il faut que le syndicalisme uni se dote d’un projet autonome solide : la besogne d’avenir, on y revient par ce détour. Il reste beaucoup de chemin ! Mais c’est bien vers cet « univers symbolique commun » (page 71) que l’on peut gagner une contre-hégémonie contre le néolibéralisme rejeté et le RN son rejeton identitaire.■