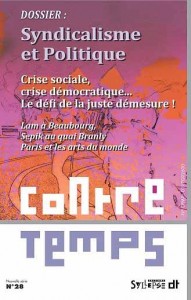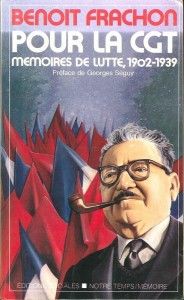La mémoire du Front populaire retient surtout l’énorme grève générale de juin 1936, après la victoire électorale de la gauche. Mais cet évènement a été précédé d’une phase d’au moins deux années où le syndicalisme a pris des initiatives, en lien avec celles des forces politiques, aboutissant à la naissance fin 1935 du Rassemblement populaire où participent plus de 100 organisations politiques, syndicales, associatives, culturelles, sportives, etc.
L’article ci-dessous a été publié dans la revue Contretemps dans une version condensée. Il décrit comment le Front populaire est le produit conjoint d’initiatives syndicales et politiques entrées en synergie. Il comporte aussi un volet similaire sur mai 1968.
Contretemps a publié un dossier sur Syndicalisme et politique dans deux numéros : 28 et 29. Le sommaire du numéro 29 (ci-dessous) comprend l’article cité ici, écrit par Jean-Claude Mamet.
Syndicalisme et politique (2)
° Benoît Borrits, Syndicalisme de rupture ou de transformation sociale ?
° Jean-Claude Mamet, Quand le syndicalisme s’intéresse aux alternatives politiques. Retour sur les expériences du Front populaire et de Mai 68.
° Pierre Cours-Salies, Trouver une unité nouvelle ? Le Collectif 3A. Signes nouveaux et questions.
° Josiane Zarka, Vers des luttes de transformation de la société
° Patrick Darré , Crise systémique et enjeux du syndicalisme
° Jean Gersin, Filpac Cgt. Les enjeux d’un congrès
L’article complet (1936-1968) : Syndicalisme et pouvoir politique3
Extraits sur la période de constitution du Front Populaire:
[…] La dynamique du Front populaire
C’est donc avec un souci de précaution et de contextualisation des débats qu’il convient de lire la portée du Front populaire, dont l’imaginaire frappe encore aujourd’hui. Il nous est souvent resté de cette époque des raccourcis conceptuels, comme par exemple les deux suivants :
- Pour une certaine tradition, il est entendu que le programme officiel du Front populaire était d’une pauvreté affligeante ; et c’est la grève générale qui lui a donné son vrai programme en obligeant le gouvernement à légiférer sur les congés payés et la semaine de 40h (non prévus dans le texte).
- Pour une autre tradition, ce fut l’apogée de la capacité du Parti communiste à être en phase avec son époque (jusqu’en 1947), avec les aspirations populaires à l’unité, et donc à écrire une page glorieuse de l’histoire du mouvement ouvrier.
Nous ne pouvons ici revenir sur les enchainements évènementiels supposés connus. Il s’agit d’abord d’insister sur le fait que la période se structure sur plusieurs années, du 6 février 1934 (manifestation des ligues factieuses contre le Parlement) à la grande grève générale de juin 1936, suivant la victoire électorale de la gauche (en mai), mais allant ensuite jusqu’au retournement complet de situation en 1938 où les forces de la réaction, patronat en tête, reprennent totalement le dessus. De 1934 à 1936 notamment, une relecture attentive donne l’impression d’un enchevêtrement d’actes et de débats qui font synergie ensemble, en associant un grand nombre d’acteurs, de forces de nature très diverses, et au départ pas du tout en accord sur une stratégie commune à l’instant T du 6 février 1934 (avec un énorme passif conflictuel derrière elles), mais qui finissent par converger. Ces forces ont bâti en cheminant, parfois difficilement entre elles, une sorte de front social et politique empirique, finalement adéquat au bon moment à une situation où quantité de paramètres évolutifs s’emboîtent:
- aspirations populaires à se serrer les coudes et à demander l’unité, face aux libertés menacées le 6 février 1934 ;
- décrépitude du pouvoir en place totalement discrédité (scandales) et effrayé par la situation ;
- capacité concomitante d’initiative du syndicalisme CGT (CGT dite confédérée, liée au PS) à y répondre le 12 février avant même les forces politiques : le 12 février, lors de la fameuse manifestation où les cortèges se rencontrent, les syndicats sont devant et les forces politiques soutiennent derrière, scénario que l’on connait bien aujourd’hui ; par la suite, la CGT tentera aussi de construire par son initiative propre un rassemblement plus généraliste et plus « politique » autour d’une logique « planiste » (nationalisations, etc) ;
- réflexe citoyen antifasciste et républicain, dans le champ intellectuel, dans le débat public, avec des savants et intellectuels illustres (naissance en mars 1934 du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes-CVIA) ;
- exigences sociales d’une jeune classe ouvrière industrielle en voie de massification et de concentration (Renault Billancourt existe) : c’est bien entendu le substrat social de toute l’affaire ;
- capacité du syndicalisme CGT U (U comme unitaire, liée au PC)- en perte de vitesse mais influente chez les cheminots et dans la métallurgie- à mener la bataille pour la réunification syndicale (achevée au début de 1936) par un travail de terrain et d’influence intelligente dans l’autre CGT (rôle globalement actif du Syndicat des instituteurs SNI, pourtant pas du tout pro-communiste) ;
- exigences institutionnelles de la direction du Parti socialiste SFIO qui cherche à reprendre le leadership face aux crises gouvernementales répétitives avec les ministères radicaux précédents ;
- tournant et ouverture du Parti communiste abandonnant enfin la théorie du « social-fascisme » à l’encontre du PS, pressentant sinon son isolement total, et tendant dès lors la main aux radicaux décrépis, lesquels sont valorisés à l’extrême par son action. « Le Parti radical est plus grand de tous les partis » écrit Maurice Thorez dans l’Humanité (Georges Lefranc, Histoire du Front populaire, Payot, 1965) ;
- mais tournants bien « en phase » (à la mi-1935) avec la direction de l’Internationale communiste avec un Staline effrayé par la menace hitlérienne, sous-estimée depuis son avènement au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, et donc favorable à une alliance gouvernementale républicaine en France pour encercler l’Allemagne. Selon le 7ème congrès de l’Internationale communiste de juillet 1935, il ne s’agit pas du tout d’aller vers le socialisme en France, explique un Commissaire du peuple à un journaliste français, mais plutôt « vers une France forte, unie, décidée à répliquer à Hitler» (Lefranc, 1965).
Tous ces éléments forment donc les pièces d’un puzzle qui d’un seul coup forme un tableau saisissant, d’abord par une victoire électorale (mais sans marée déferlante, la droite n’est pas totalement défaite), et ensuite par la grève générale qui se propage à cause de provocations patronales stupides (licenciements de militants) au lendemain des élections.
Concentrons-nous maintenant sur un aspect de ce tableau : la couleur, ou si on veut le programme du Front populaire. Il fut mis au point à la suite de la force propulsive de l’énorme rassemblement du 14 juillet 1935 (plusieurs centaines de milliers de personnes à Paris, peut-être un million en France), suite aux premiers succès électoraux à gauche aux municipales du printemps, avec une évidente radicalisation. Certes, il y avait eu auparavant, un Pacte politique d’unité d’action SFIO-SFIC (PS-PC) signé en juillet 1934, avec même un débat sur l’unité organique poussé par la SFIO qui en faisait même une condition de l’unité tout court. Ce Pacte était une étape nécessaire, indispensable même (les deux morceaux du congrès de Tours de 1920 impulsant un front commun), mais finalement peu décisive sur le contenu du projet. Nous découvrons là une différence majeure avec le programme commun de 1972, signé entre PCF, PS et radicaux de gauche, puis « s’imposant » aux forces syndicales. En 1934-35, les forces syndicales ont joué un rôle d’initiative bien plus fort, suite aux mobilisations populaires qui exprimaient par leur massivité une demande politique. De plus, le Comité antifasciste (CVIA), ainsi que la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) réclamaient aussi un contenu à l’unité et joueront un rôle médiateur dans la conduite des débats sur le programme.
Léon Jouhaux, secrétaire général CGT « confédérée »
Benoit Frachon, secrétaire général CGT-U
Le Comité d’organisation du Rassemblement de masse du 14 juillet 1935 se maintient donc, et le débat devient inévitable sur la nécessité d’un programme commun pour les suites. Ce programme du Rassemblement populaire deviendra ensuite celui dit du « Front populaire » selon la terminologie popularisée par Maurice Thorez dans un meeting. On ne va pas ici entrer dans une chronologie de sa rédaction, rendue publique en janvier 1936, mais en dégager les traits les plus saillants.
Premier élément : on l’a dit, le Rassemblement unitaire est issu d’une poussée sociale de plus en plus massive, jusqu’au déferlement du 14 juillet 1935.
Deuxième élément : la forme. Ce n’est pas un cartel de partis. Ceux-ci sont minoritaires. Au départ, il y a dix organisations (quatre partis, deux confédérations syndicales, quatre associations, dont Ligue des droits de l’Homme-LDH-et le Comité antifasciste- CVIA). A la fin, il y en a une centaine ! De toutes natures : associations sportives, philosophiques, laïques, comités de chômeurs, Rassemblement mondial des femmes, confédération de paysans travailleurs, coopératives, toutes sortes d’organisations de jeunesses, etc. Encore une fois : on ne retrouve pas du tout le même scénario dans l’Union de la gauche de 1972.
Troisième élément : la méthode. On travaille au consensus. « Les décisions importantes sont prises à l’unanimité » (Lefranc, 1985). LDH et CVIA jouent un rôle d’animation et d’écriture. De plus, un « règlement de travail » est établi. Des comités locaux peuvent essaimer dans les régions sur le modèle national. Les adhésions individuelles ne sont pas reconnues, mais on peut penser qu’à cette époque cet aspect est moins important qu’aujourd’hui, à cause de la forte légitimité des organisations. Il vaut la peine de lire les précautions prises pour que chaque organisation soit respectée : « Le Comité national entend que chaque parti, chaque organisation participant au Rassemblement Populaire puisse se joindre à l’action commune, sans rien abdiquer de sa doctrine, de ses principes et de ses fins particulières […]. Les partis et les organisations [du Rassemblement] ont collaboré amicalement, dans un esprit de conciliation et de synthèse ». Quant au règlement intérieur, il précise que « Le Rassemblement populaire n’est ni un parti, ni un super-parti. Il est un centre de liaison entre les organisations et les groupements ».
Quatrièmement : le rapport au pouvoir. « Le rassemblement populaire n’est pas une organisation électorale » (extrait du règlement). Aucun candidat futur à une élection ne peut donc s’en prévaloir comme d’un label. Les partis gardent la main sur cet aspect s’ils parviennent à se mettre d’accord.
Cinquièmement : le contenu. La CGT confédérée (notamment son secrétaire général Léon Jouhaux) a tenté de prendre la main avec son projet d’un « plan » global élaboré en 1934, sous l’inspiration du socialiste Henri de Man au sein du Parti ouvrier belge. Ce plan comporte des réformes de structures et notamment un projet de nationalisations : banques, assurances, mines, énergie, chemins de fer, industries-clefs, et une économie de plein-emploi et grands travaux. Le souci officiel est d’avoir un cadre contraignant pour assurer une cohérence et pas seulement un « catalogue de revendications immédiates ». On retrouvera cette problématique plus tard dans la CGT autour de 1968 et après, mais aussi dans la CFDT et la stratégie de la « position commune » (avec des forces politiques) impulsée par Edmond Maire, mais nous y reviendrons.
Il serait nécessaire de faire une étude sérieuse sur la portée du planisme CGT de ces années-là, pour démêler entre deux options : une logique de réformes assimilables par le capitalisme, ou une logique plus clairement anti-capitaliste. Un indice de ce débat conflictuel est peut-être à déceler dans le congrès confédéral CGT de l’automne 1935 (centré sur la réunification avec la CGTU, alors en débat passionnel) où certains se prononcent pour une participation de la CGT à un gouvernement sur la base du « plan », et d’autres, dont Jouhaux, y sont totalement opposés (La CGT du Front populaire à Vichy, Morgan Poggioli, Institut CGT d’histoire sociale, 2007). On sait par ailleurs que Léon Trotsky (il séjournait en France avant 1936), critiquait fortement l’absence de programme dans le « front unique » en cours, et s’est intéressé à cette logique planiste en conseillant à des militants syndicaux de s’en emparer et de développer une logique anti-capitaliste alternative. Il pensait que comme en Belgique, les ouvriers prendraient « le plan tout à fait au sérieux » (L. Trotsky, Où va la France, Ecrits, Editions de Minuit).
Mais ce n’est pas la logique du « plan » CGT qui fut retenue dans le Rassemblement populaire. D’une part Léon Blum lui-même (dirigeant SFIO et futur Président du conseil) critiquait ce plan au nom d’un certain maximalisme et même de la « Révolution » estimée incontournable pour imaginer un vrai « plan». Et le PCF y était totalement opposé ainsi que la CGTU, avec un rôle important de Benoit Frachon portant les deux casquettes ! Ce refus pouvait évidemment se justifier par une critique du caractère timoré du plan CGT, mais ce n’est pas cela qui primait. On estimait qu’il ne fallait pas « semer des illusions » sur une logique planiste dans un cadre capitaliste. En réalité, les radicaux non plus n’en voulaient évidemment pas. Et le PCF accompagnait cela avec l’argumentation consistant d’abord à exiger des mesures d’urgence comme garantie pour aller plus loin. Opinion qu’on peut entendre lorsque la confiance ne règne pas, mais qui se mélange ici -comme on l’a dit plus haut- avec la stratégie minimaliste d’un projet d’accord gouvernemental défensif intégrant le principal parti démocratique de la bourgeoisie française, selon les options d’alors de l’Internationale communiste.
Ce débat confus aboutit donc à un compromis sur le contenu final. D’abord il est indiqué que le contenu revendicatif est déjà le résultat « élaboré par les organisations syndicales » elles-mêmes (cela rappelle des idées d’aujourd’hui sur les programmes basés sur les luttes !). Qu’en conséquence il se limite à des « revendications urgentes » dont on sait qu’elles sont « restreintes », mais que leur satisfaction apporterait une « première modification au système ». Il restera ensuite à « compléter par des mesures plus profondes pour arracher définitivement l’Etat aux féodalités industrielles et financières ».
Plusieurs « commissions » de rédaction furent mises en place par thèmes, puis mises en commun. Le texte global, s’il est précis sur les mesures politiques et démocratiques (dissolution des ligues fascistes), est effectivement limité sur le plan social et économique :
- réduction de la semaine de travail sans perte de salaire mais sans chiffrage de durée ; pas d’évocation des congés payés.
- fond national de chômage et fond de retraites pour les « vieux travailleurs » ; grands travaux.
- nationalisation uniquement des industries de guerre.
- droit syndical pour tous (pas d’allusion aux conventions collectives signées dans les accords Matignon en juin 1936).
Martha Desrumeaux (à droite) représente la CGT-U au comité d’unification avec la CGT.
Au total donc, un simple programme d’exigences. Mais comme le dit à ce moment Victor Basch de la Ligue des Droits de l’Homme : « Pour la première fois depuis que la République existe, tous les partis et groupements de gauche se sont entendus sur un nombre précis et déterminé de revendications » (Lefranc, 1985). Ce qui n’est pas en effet une mince affaire.
Le problème, c’est qu’une fois la vague gréviste passée (après juin 1936), celle-ci ayant radicalisé et élargi le programme, précisé les 40 heures, obtenu les congés payés, les conventions collectives généralisées, les délégués du personnel, les augmentations importantes de salaire, et plus globalement la reconnaissance nationale du poids politique de la classe ouvrière, le gouvernement Blum n’avait plus rien à proposer (il finit par démissionner en 1937) et n’a pas voulu dépasser le projet minimum du Rassemblement. Une coalition de forces politiques peut élaborer, avec le mouvement syndical et associatif, un ensemble d’exigences minimales et urgentes. Cela peut se comprendre pour agir, mais pour gouverner, on ne peut en rester là [1]sauf à laisser le patronat et la réaction reprendre des forces et finir par écraser ce qui a été acquis. C’est ce qui s’est produit très vite. On connait les suites tragiques après la grève générale trop peu suivie de 1938 où la répression fut terrible.
Ces questions méritent d’être clarifiées aujourd’hui, et nous le ferons en conclusion.
[…]
[1] On laisse de côté ici le débat stratégique de fond sur le « Tout est possible » de Marceau Pivert (leader de la gauche SFIO en mai 1936), ou le point de vue voisin de Trotsky selon lequel en juin 36 « la Révolution française a commencé » (Où va la France, Ecrits, Editions de Minuit), à quoi fait écho le « Tout n’est pas possible » et « Il faut savoir arrêter une grève » de Maurice Thorez en pleine grève de juin 1936.