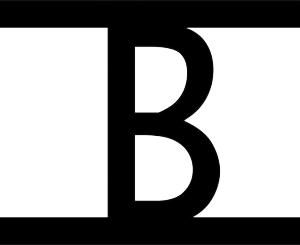Théo Roumier (SUD Education, Solidaires Loiret) est membre du comité éditorial de la revue Les Utopiques, cahiers de réflexions de l’Union syndicale Solidaires. Nous reproduisons son interview à la revue Ballast.
Ballast est un collectif, créé en novembre 2014, d’une cinquantaine de bénévoles (de France, de Belgique et du Québec), indépendant de tout groupe de presse et parti politique. Sa revue, sans publicité, est disponible en librairie ; son site est quant à lui alimenté chaque semaine en articles et entretiens inédits.
Convergence des luttes, grève générale, stratégie syndicale : c’est autour de ces trois grands thèmes, en plein mouvement social, que nous rencontrons Théo Roumier, syndicaliste à SUD éducation et membre du comité éditorial des cahiers de réflexions de l’Union syndicale Solidaires, Les Utopiques. « Le dialogue social
, c’est le patronat qui impose son agenda, ses thèmes, son calendrier, son idéologie. On s’est fait assez arnaquer », lâche-t-il, assis à la table d’une salle de réunion du siège, dans le dixième arrondissement de la capitale. Face au « bulldozer » macronien, comment réorganiser la lutte par la base : le quotidien des travailleurs et des travailleuses ?
 On fête le cinquantenaire de 1968. Dans quelle mesure les travailleurs avaient-ils dépassé leurs directions syndicales ?
On fête le cinquantenaire de 1968. Dans quelle mesure les travailleurs avaient-ils dépassé leurs directions syndicales ?
La question qu’on devrait se poser est d’où vient cette base qui dépasse les appareils syndicaux ? En 1968, les occupations d’usines sont beaucoup le fait de militants syndicaux pour qui l’appartenance à une organisation syndicale a un sens. Le « dépassement » consiste alors plutôt à imposer le calendrier et la maîtrise de la grève par les grévistes eux-mêmes — ce qui est totalement souhaitable. Mais ça ne revient pas forcément à rejeter les syndicats. La CFDT — qui développe à l’époque un positionnement autogestionnaire original — va largement épouser l’esprit de Mai 68. Son communiqué parle de substituer à l’ordre actuel, celui de la « monarchie industrielle », une société fondée sur des rapports d’autogestion. Près de 40 % de la population active travaillait dans l’industrie ; on voit « pousser » de nouvelles usines comme celles de Renault Flins ou du Joint français à Saint-Brieuc. C’est une population jeune souvent issue des campagnes qui y travaille, une jeunesse que le patronat imagine très malléable : en réalité, elle va s’avérer la plus combative. Elle n’est pas imperméable aux luttes étudiantes ; elle est, elle aussi, concernée par cette révolte de la jeunesse contre de Gaulle mais aussi contre la guerre d’Algérie, d’abord, puis du Vietnam. Dans la décennie d’insubordination ouvrière qui suit, les travailleurs et les travailleuses vont imposer des pratiques qui leur correspondent davantage, avec des débordements, des occupations d’usines, des séquestrations, des pratiques assembléistes…
« Le syndicalisme, c’est d’abord la construction d’un collectif de travailleurs et de travailleuses qui pense et qui agit pour son émancipation. »
C’était déjà perceptible avant 1968, comme on le voit dans le film À bientôt, j’espère de Chris Marker, sur la grève de mars 1967 dans l’usine de textiles Rhodiacéta de Besançon. Les femmes, les jeunes, les immigrés forment une population ouvrière entrant dans un processus de radicalisation et bousculant un ordre dominant qui leur est insupportable. Les acquis stratégiques, tactiques et politiques de l’auto-organisation et des AG sont si forts qu’ils s’imposeront même à la CGT. Cette séquence des années 68 sera clôturée en deux temps. D’abord, le patronat profite conjointement du choc pétrolier, de la défaite de la sidérurgie lorraine en 1979 et du début du chômage de masse pour reprendre la main1. Le second événement est l’arrivée de « la gauche » au pouvoir avec l’élection de Mitterrand, perçue comme « le débouché politique aux luttes » : une erreur fatale rapidement visible avec le tournant de la rigueur, l’exploitation de la montée du FN par le PS et, encore plus immonde, la division raciste au sein du travail — le Premier ministre Pierre Mauroy accuse ainsi les grévistes d’Aulnay en 1983 d’être à la solde des ayatollah iraniens… Ces deux phénomènes ont contribué à « étatiser les luttes2 », au détriment de ce mouvement large, profond, d’auto-organisation et de volonté d’émancipation porté par 1968. Un mouvement qu’on peine à retrouver…
Où faites-vous remonter le syndicalisme, en France ?
C’est un phénomène très ancien. Avant même la fondation des premières chambres syndicales vers 1868, on peut voir dans les sans-culottes ou les canuts révoltés les figures d’un proto-prolétariat. Le syndicalisme, c’est d’abord ça : la construction d’un collectif de travailleurs et de travailleuses qui pense et qui agit pour son émancipation. C’est la devise de la Première Internationale : « L’émancipation des travailleurs et travailleuses sera l’œuvre des travailleurs et travailleuses eux/elles-mêmes » — je féminise, car on ne le faisait pas à l’époque ! L’essentiel est posé. Ensuite il y aura bien sûr l’histoire des cadres et des structures d’organisation syndicale, des rythmes de discussions et d’élaborations collectives, mais aussi des conflits — comme dans toute organisation —, des analyses différentes de la situation et diverses manières d’agir ou de faire. Tous ces éléments se cristallisent au tournant du XXe siècle autour de deux courants fondamentaux dans le syndicalisme : le courant « lutte de classe » et le courant syndical chrétien.

Le premier courant étant alors porté par la CGT.
Sa quintessence est la Charte d’Amiens, adoptée en 1906 par la CGT. Elle instaure la « double besogne » : d’une part le travail quotidien sur les revendications immédiates et de l’autre le travail d’émancipation sociale pour l’avenir, ayant pour finalité l’expropriation capitaliste — soit la fin de ce système d’exploitation de l’Homme par l’Homme. Le second courant, on pourrait le qualifier actuellement d’accompagnement et de collaboration. Loin d’être un syndicalisme d’action et de luttes, c’est un syndicalisme d’association ouvrière ayant pour but de discuter avec un patronat chrétien très paternaliste qui s’occupe de ses ouvriers et ouvrières, les loge, les « chaperonne »… La CGT pratique la grève quand le syndicalisme chrétien met en avant la discussion et la négociation.
De nos jours, la majeure partie de la population n’est plus familière du monde syndical…
« Prenons le secteur du nettoyage : les collectifs de travail y sont composés de femmes immigrées, très mal payées, cumulant parfois deux jobs, atomisées par une organisation du travail particulière. »
En 2018, les organisations syndicales existantes sont le fruit de cette histoire : elles ont évolué autour de cette double culture syndicale… Une division qui peut parfois traverser certaines organisations ! Le monde syndical est très fractionné, avec cinq grandes confédérations (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC) mais aussi des unions syndicales comme Solidaires ou encore des petits collectifs syndicaux tels que la CNT et la CNT-SO, qui font un travail syndical de terrain tout à fait honorable. Entre elles, il y a des divergences sur la manières de pratiquer le syndicalisme. FO a été traversé à la fois par des tendances de luttes et de collaboration de classe : ces dernières impliquent un refus de construire un rapport de force et de s’investir dans une démarche conflictuelle. La CGT dégage majoritairement une image de syndicat de lutte, qui bâtit des résistances collectives — mais elle a évolué depuis 1968 et la chute du mur de Berlin, surtout. Solidaires a globalement hérité de l’histoire et des pratiques de la gauche autogestionnaire de la CFDT. Mais, en effet, malgré de solides bastions (la SNCF, Air France, l’automobile, les raffineries, la fonction publique…), le taux de syndicalisation en France est faible : autour de 10 % des travailleurs.
Au sortir de la Seconde Guerre, le grand patronat a largement collaboré. Les Francs-Tireurs et partisans ont dû rendre leurs armes de maquisards ; le PCF et la CGT se sont lancés dans « la bataille de la production » et le pouvoir a été partagé avec de Gaulle pour « maintenir l’unité nationale » et étouffer dans l’œuf les velléités révolutionnaires de la Résistance. S’ensuivit une séquence historique favorable aux droits sociaux et aux services publics. Aujourd’hui, les réformes structurelles s’attaquent à ces conquis : les syndicats ne devraient-ils pas être plus offensifs ?
Être offensif ? Il faut préciser ce qu’on entend par là. Un bon mot d’ordre ne suffit pas à enclencher des mobilisations collectives. Il faut revenir à cette pratique syndicale fondamentale et originelle, partant du travail réel, tel qu’il est exercé par les collectifs de travail existant, et non pas celui prescrit par l’employeur, qui charge la barque tant qu’il peut. C’est à partir de l’exploitation salariale, dans ces frottements entre la volonté de l’employeur et le vécu du salarié, qu’on a une marge de manœuvre pour reconstituer de l’action collective — notamment sur la question de la pénibilité du travail. Prenons l’exemple du secteur du nettoyage : les collectifs de travail y sont composés de femmes immigrées, très mal payées, cumulant parfois deux jobs, atomisées par une organisation du travail particulière, avec parfois des heures de nuit, mais qui ont pourtant mené des grèves victorieuses dans les gares du nord de l’Île de France, à l’Holliday Inn ou dans plusieurs hôtels à Marseille, impulsées par la CNT-SO. Pour l’essentiel, les revendications portaient sur des augmentations de salaires : ça pouvait paraître bien peu « révolutionnaire » au gauchiste averti, mais on s’en fout ! Ces revendications correspondaient à ce que ces grévistes ne voulaient pas lâcher ; ça a permis de tenir plus de 100 jours de grèves à l’Holliday Inn. Et ça a marché ! Car quand le ménage n’est pas fait, l’hôtel ou la gare deviennent très vite dégueulasses. La radicalité, elle est là ! Ils et elles ont radicalement rompu le lien avec l’ordre coutumier du travail, avec les horaires établis et les desiderata de l’employeur. Ce qui existe ici dans le travail salarié est aussi valable pour les auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses (ces travailleurs hors du salariat que sont les coursiers à vélo, travailleurs ubérisés). Ils se basent sur le travail concret, sur sa pratique et renouent par là avec les mêmes fondamentaux à l’origine du mouvement ouvrier, entre le syndicalisme, l’associationnisme, le coopérativisme (pensons à Coopcycle). Prenons l’exemple de SCOP-TI, soit la reprise en coopérative de l’usine Fralib à Gémenos (les thés « Éléphant ») : elle crée un travail émancipé sans rompre avec le mouvement ouvrier puisque les salarié.e.s continuent pour beaucoup d’être adhérent.e.s à la CGT. On a tout intérêt à se ressourcer à ce large panel de pratiques grévistes et solidaires.

Revenons à l’augmentation de salaire, fixée comme objectif de lutte. De quelle façon l’action concrète parvient-elle à politiser des salarié.e.s qui n’étaient pas militants ou syndiqués ?
Il n’y pas de théorie sans pratiques. Prenons l’exemple de la création du syndicat de Transport de l’agglomération urbaine d’Orléans (la TAO), arrivé récemment 3e aux élections professionnelles — mais 1e sur un certain nombre de scrutins où il se présentait. Cette représentativité syndicale est l’aboutissement d’un long combat, avec la difficulté de maintenir et de faire exister un collectif syndical et militant dans une entreprise de plus de 700 salarié.e.s sur lequel le patronat fait planer la menace de licenciements. En construisant conjointement leur collectif et leurs revendications, ces militant.e.s se sont intégré.e.s dans tout le travail de formation syndicale que nous faisons aussi à Solidaires Loiret (sur d’autres thématiques, comme la lutte contre l’extrême droite, l’égalité de genre et la persistance des stéréotypes avec la création de matériel spécifique). C’est dans les discussions entre militantes que notre « commission femmes » locale a eu l’idée de réaliser un tract dénonçant « la petite blague de cul en trop », diffusé ensuite en entreprises. On est dans la praxis évoquée par Marx. C’est un exemple de construction d’une politisation dans et par les luttes — hors des logiques institutionnelles, donc avec pour préalable nécessaire l’auto-organisation du collectif de travail de manière régulière sur le lieu de travail, pendant des pauses ou à l’extérieur, dans des temps informels. C’est un enjeu déterminant. Plus ça appartient au collectif, plus il va le défendre avec vigueur.
Comment s’exprime cette auto-organisation dans les moments de luttes ?
« Il faut construire la grève à partir des revendications locales, en s’assurant de son auto-organisation. »
En période de confrontation accrue, elle est d’autant plus cruciale. C’est l’héritage des AG significatives et représentatives entre 1968 et 1995. Cette configuration est bien plus rare aujourd’hui, comme on le voit à travers l’actuelle grève des cheminots. Sud Rail défend la grève reconductible par des AG quotidiennes afin de permettre aux grévistes de donner le tempo de leur lutte. Le calendrier « grille de loto » porté par les autres organisations — certainement avec sincérité, par ailleurs — a pour conséquence que la lutte appartient maintenant aux syndicats. Pousser la grève cet été est une décision de la centrale sans qu’aucune AG de grévistes ne l’ait votée. Les camarades de Sud Rail défendent la grève reconductible mais peinent à mobiliser les salariés sur cet objectif. Les AG, notamment « interprofessionnelles », me semblent être une dérive quand très peu de secteurs sont mobilisés — sauf si on assume que c’est un outil militant pour jauger la combativité de tous les secteurs. Il faut toujours vérifier que ce qu’on appelle « AG » est véritablement représentatif, a un ancrage collectif… sinon c’est une sorte de « comité de luttes », mais pas une AG. Il me semble qu’il faut construire la grève là où on peut, à partir des revendications locales, en s’assurant de son auto-organisation. À partir de là peuvent prospérer des phénomènes assembléistes réellement représentatifs et significatifs, donc plus marquants en termes de politisation.
On parle très peu du puissant mouvement de grèves par secteurs professionnels de 1986 et 1988, alors que les forces en présence sont quasiment les mêmes qu’aujourd’hui : la mobilisation étudiante contre la loi Devaquet, avec le meurtre de Malik Oussekine, les cheminots, les instituteurs et institutrices, les infirmières, les agents d’Air France… On voit s’articuler des grèves très fortes, auto-organisées, avec des coordinations de grévistes et des vraies AG regroupant énormément de salariés. Ces grèves s’appuyaient sur des revendications propres qui ne s’opposaient pas mais créaient un effet d’aspiration, comme quand on court dans un couloir d’athlétisme. Bien plus que la grève générale de 1995, ce sont ces grèves auto-organisées et cette culture assembléiste qui sont la matrice du syndicalisme de SUD. Les profils militants post-1968 qui défendaient ces modes sont en train de disparaître, nous imposant en conséquence des responsabilités supplémentaires sur la formation, sur les modes d’action et les pratiques. Au dernier congrès de Solidaires, le débat sur l’autogestion a rebondi : plusieurs fédérations syndicales Sud et des Solidaires locaux l’ont défendu très activement, et son application pratique est mise au calendrier interne des débats.

Ces dernières années, le monde du travail a été refaçonné par plusieurs « réformes » : les retraites en 2003, l’auto-entrepreneuriat en 2008, la loi Travail en 2016… Quelles ont été les conséquences sur les stratégies de mobilisation, les modes d’action et le discours, face à des dirigeants ne parlant que de mutations saines et inévitables ?
Pour ceux-là, ça ne fait aucun doute, vu que les profits et les « eaux glacées du calcul égoïste », comme disait Marx, sont sans limites ! Ils veulent reprendre le plus possible aux travailleurs et aux travailleuses. L’attaque est frontale et majeure. On a un patronat de combat contre lequel on n’arrive à arracher que des victoires partielles mais plus difficilement sur des grands mouvements sociaux. Le retrait du CPE en 2006 est un recul manifeste du pouvoir, dont on peut donner le crédit au mouvement social mais dans lequel la jeunesse a joué un rôle moteur. Mais dans les mouvements sociaux issus et portés par le monde du travail stricto sensu, on va de défaites en défaites. Il faut donc réinterroger les stratégies syndicales de mobilisation. Le modèle d’une grève générale mythifiée comme en 1968, qui a débouché sur de vraies victoires, doit être adapté aux coordonnées contemporaines. Aujourd’hui, mon appréciation, c’est qu’on a trop systématiquement cherché à mimer et revivre 1995, à faire un mouvement social large autour d’une revendication unifiante — les retraites, la loi Travail — avec si possible un secteur clé locomotive (les cheminots en 1995, l’éducation en 2003, les raffineries en 2010 et 2016) : l’imaginaire du secteur bloquant entraînant le reste est très prégnant. Tous les corps de métiers, toutes et tous les salarié.e.s ont à l’heure qu’il est des capacités de blocage, avec des dynamiques plus ou moins importantes mais qui, mises bout-à-bout, permettraient le blocage de l’ensemble de l’économie et de l’activité. Il faut corréler cela avec le phénomène de « la grève par procuration » dans lequel un secteur clé est épaulé en alimentant les caisses de grèves : ces caisses de grève popularisent la lutte, c’est très bien, ça n’est pas neutre politiquement, mais stratégiquement, ça interroge de fait l’option de la grève générale… Car qui va payer pour les grévistes si on s’y met toutes et tous ? les professions libérales ?… Les diverses caisses de grève actuelles en faveur des cheminot.e.s pèsent plus d’un million d’euros, mais elles ne sont pas une solution miracle à même d’entraîner des victoires sociales : elles ne paient que quelques jours de grève pour chaque gréviste ! En plus, ça fait l’impasse sur l’action gréviste en tant que moment politique d’appropriation de la lutte par les travailleurs et les travailleuses.
« Cela implique peut-être d’éviter les méthodes gauchistes, drapeau rouge au vent, censées entraîner une grève générale. »
Il ne s’agit pas de dénigrer : c’est un geste solidaire vraiment estimable. C’est « bien », c’est clair. Mais ça n’est pas pareil que de démontrer qu’en arrêtant le travail on stoppe l’activité, que ce sont donc celles et ceux qui travaillent qui font tourner la société. C’est sur le terrain du travail, de la production de biens et de services que se mène la lutte des classes. Il faut réinterroger collectivement toutes ces stratégies dans les structures, dans les organisations syndicales, en le faisant au plus près des salariés : pourquoi on n’y va pas ? pourquoi on ne fait pas plusieurs jours de grève d’affilée ? Dans mon boulot, je vais finir par cumuler 9 jours de grève en discontinu depuis le début de l’année. On a un cahier revendicatif construit patiemment depuis plusieurs années, avec des revendications qualitatives et quantitatives claires, qui pourraient aboutir si on avait fait grève d’affilée, avec occupation du bâtiment par exemple — de quoi faire vivre la lutte au quotidien, dans la localité… Il faut penser ces stratégies de mobilisation syndicale de manière plus large, au niveau micro et macro. La base doit être le pacte revendicatif dans l’entreprise à partir des motivations et des processus de mobilisation des salariés : il faut mettre en avant le vol de notre temps par l’employeur, la part croissante des souffrances au travail… C’est-à-dire à partir du travail, même quand on n’en a pas, peu ou mal.
On entend énormément parler de « convergence des luttes ». Peut-on vraiment la décréter ?
Avant de faire converger des luttes, encore faut-il qu’il y en ait ! (rires) Le premier niveau de réponse est celui du social et du syndical. Les grèves SNCF et Carrefour se font sur des revendications professionnelles propres non-réductibles à la revendication centrale et unifiante de défense du service public, comme lors des mouvements sociaux sur les retraites ou la loi Travail. Cela implique peut-être d’éviter les méthodes gauchistes, drapeau rouge au vent, censées entraîner une grève générale — c’est un peu le modèle dominant du syndicalisme de lutte. Ne doit-on pas opter plutôt pour un climat de conflictualité rythmé par des moments de mobilisation sans mot d’ordre unifiant, type 1986-1988 ? Cette stratégie génère de la confiance pour agir, pour entraîner des luttes et des grèves partout où c’est possible. Les questions de fond sur le service public peuvent être posées mais ne peuvent être le mot d’ordre unifiant actuel. Comment s’y retrouveraient les grévistes de la grande distribution ou de la restauration rapide, sinon ? Le second aspect de la convergence des luttes, c’est le continuum entre luttes sociales et « sociétales ». Mobiliser sur les violences policières dans les quartiers populaires, les luttes écologistes, les luttes féministes… À l’Union syndicale Solidaires, toutes ces questions sont répercutées dans la construction de notre syndicalisme car elles traversent toute la société : nous luttons contre la domination masculine lorsque nous dénonçons l’inégalité salariale fondée sur le genre, qui fait que les femmes gagnent près de 20 % de moins que les hommes. Autre combat capital : les questions antiracistes. Elles doivent avoir des effets sur nos pratiques syndicales contre la discrimination structurelle à l’œuvre contre des catégories de population spécifiques, comme lorsque nos camarades de la Poste ont mené des luttes avec les personnels antillais, guyanais, réunionnais. Si on permet d’établir des statistiques dites « ethniques » dans les entreprises et les services, peut-être qu’on pourra mettre en lumière des inégalités de salaires et de carrières spécifiques. Puis construire des revendications pour agir dessus !

Un article stimulant du philosophe Geoffroy de Lagasnerie explique que la convergence des luttes, si elle devient un « totem », risque de faire entrer les luttes de force, dans cette seule optique, en outrepassant les spécificités et le rythme propre à chacune d’entre elles. C’était particulièrement visible lors de Nuit Debout. La question est alors de qui décide et indique où doivent converger les luttes. Il faut toujours s’opposer aux mécanismes hégémoniques pour affirmer que c’est aux premier.e.s concerné.e.s d’auto-organiser et auto-déterminer leurs luttes. La marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983 était exemplaire à ce titre — avant que le processus de récupération autour de SOS Racisme ne se mette en place dès l’année qui a suivi.
Comment faire pour mobiliser les chômeurs et les précaires dans une société qui organise l’isolement ? Dématérialisation de Pôle emploi, du RSA, suivi groupé… Comment les syndicats — et notamment Solidaires — peuvent-ils soutenir ces sphères placées hors du travail productif ?
« La question de la réduction du temps de travail à 32 heures est une bonne base pour construire des stratégies de revendication plus larges. »
La précarité est une notion subjective : un fonctionnaire en CDD l’est moins qu’un auto-entrepreneur livreur. Pourtant, les deux peuvent se dire précaires. Chez Solidaires, il existe dans quelques endroits des structures horizontales de type « Solidaires précaires et chômeurs » avec une action spécifique. Cela pose des problèmes pratiques : un chômeur dans un corps de métier doit-il rester adhérent au syndicat de son secteur « de tutelle » ou aller dans ces structures horizontales ? Quelle éventuelle articulation avec les syndicats de Pôle emploi touchés eux aussi par la dématérialisation et le changement de leurs missions ? Il faut regarder comment s’était organisé le mouvement des chômeurs et précaires dans les années 1990 autour d’Agir contre le chômage ! (AC), du Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP), des comités des sans-logis, de la CGT des chômeurs rebelles… Ce mouvement a perdu son ancrage dans les populations concernées, notamment en raison de l’atomisation et de la dématérialisation : la file devant l’ANPE permettait peut-être plus facilement de s’organiser… Inspirons-nous des formules qui ont fonctionné. Dans les années 1990, les marches contre le chômage et la précarité — en France et à l’international, sur Amsterdam, Cologne… — étaient de formidables modalités de politisation, de conscientisation et de mise en avant d’une appartenance à une entité collective sociale commune. Il y a aussi eu les occupations d’agences ANPE ou Assedic lors du mouvement des chômeurs et chômeuses de 1997, avec à la clé une prime de fin d’année. Ces moments de structuration politique peuvent entraîner la création de collectifs militants plus légitimes pour agir, avec à l’époque le soutien de syndicalistes salariés. La mobilisation des travailleurs et travailleuses privé.e.s d’emplois est un des grands défis à relever. On peut à mon avis la lier à la montée de l’auto-entreprenariat pour générer du revendicatif et imposer ces questions comme débat de société. La question de la réduction du temps de travail à 32 heures est une bonne base pour construire des stratégies de revendication plus larges. Reprendre ce temps volé est un combat historique. C’est les 8 heures de la CGT en 1906, les congés payés en 36, la semaine de 40, 39 et 35 heures…
L’absence du privé dans les mobilisations est souvent soulignée. N’est-elle pas due à l’organisation même du travail ? Un secteur privé fait de PME/TPE placées en position de soumission totale par la sous-traitance… Comment se mobiliser quand se mettre en grève c’est mettre en péril son emploi, voire la pérennité de la boîte ?
Il faut quand même rappeler que l’exploitation salariale et un fonctionnement très paternaliste jouent à plein dans ces PME et TPE. On ne va pas pleurer des larmes de crocodile sur les « petits patrons », comme le font tous ces politiciens professionnels à la télé. Les luttes s’y expriment sous la forme de débrayages ou d’une conflictualité larvée, comme la résistance au travail rendue possible par des solidarités collectives directes et matérielles, bien souvent dans le dos du patron. Il faut l’assumer syndicalement en construisant de l’action collective, y compris dans de telles configurations. Au pire, il existe les tribunaux de commerce, les reprises, les gérances provisoires pour régler ces questions. Il y a aussi la question de qui est le donneur d’ordre. Par exemple, la fonderie SBFM à Lorient avait été cédée par Renault afin de ne pas avoir à gérer la « masse salariale » de cet équipementier. En 2009, face aux menaces de licenciements, les salarié.e.s ont fait le choix de la grève dure et ont réussi à faire réintégrer la SBFM au sein de l’entreprise donneuse d’ordre. Les artisans, c’est une question complexe, un peu à part, avec des petits patrons sortis du salariat mais qui de fait sont des travailleurs et travailleuses mais pas salarié.e.s. Le MEDEF suivi par les médias rabattent ces travailleurs sur une identité d’entrepreneurs alors que leurs intérêts matériels et moraux pourraient tendre vers les luttes du mouvement ouvrier. Ils peuvent se rattacher aux luttes du salariat plus globalement sur les droits collectifs et la sécurité sociale, par exemple. Mais, de fait, seule la réorganisation de la production, dans un sens socialiste et autogestionnaire, permettrait de lever cette contradiction.

Ces défaites successives expliquent-elles le grand chelem capitaliste de Macron depuis un an ?
Macron, Thatcher à la française ? Il s’inscrit en réalité dans le sale travail de ses prédécesseurs. Mais en mode bulldozer. Il cherche à accroître la domination du capital dans le rapport capital/travail, une démarche initiée au moment du tournant de la rigueur sous Mitterrand, en 1983. Mais n’enterrons pas les résistances sociales ! La grève cheminote aujourd’hui, celle d’Air France, des salarié.e.s de McDo, du nettoyage… Macron finira par payer le prix de sa politique antisociale. Il faut l’avoir en tête : on a les ressources et les moyens de défaire Macron et son monde. Sa légitimité est très relative, avec un socle absolument pas majoritaire au regard du taux d’abstention très élevé — de surcroît, il a été élu face à Marine Le Pen. Il incarne et est seulement représentatif d’une caste de cadres sup’ techno et des professions libérales — en résumé, des traders aux avocats… à l’exception des camarades du Syndicat des avocats de France et du Syndicat de la magistrature, que je salue ! (rires) Sur cette base sociale, on peut le défaire. Mais il faut que le mouvement social et ouvrier reprenne confiance en ses capacités. Rappelons-nous qu’avant Mai 68, un éditorial célèbre du Monde titrait « La France s’ennuie ». Cela dépendra de la capacité du monde syndical à se dépasser stratégiquement en incarnant autre chose, tant d’un point de vue théorique que… sportif. (rires) Il a à assumer la place qu’il tient aujourd’hui dans le tissu social français comme principal opérateur d’actions collectives. À cette condition, il pourra ouvrir bien des possibles et des futurs.
« Le
dialogue social, c’est le patronat qui impose son agenda, ses thèmes, son calendrier, son idéologie. »
Il faut, au préalable, rompre avec cette idée de « dialogue social » : elle ne rime plus à rien, si ce n’est à faire baisser le niveau de revendication avec une déperdition d’énergie de syndicalistes dans des salons plutôt que dans la construction de solidarités et de résistances collectives. Le dialogue social, c’est le patronat qui impose son agenda, ses thèmes, son calendrier, son idéologie… Avec pour conséquences concrètes des cadeaux insensés du pouvoir, comme les milliards d’euros du CICE. On s’est fait assez arnaquer. Il faut revenir à une politique de classe du syndicalisme en s’appuyant sur des modes d’action et des pratiques pensées collectivement. Cela entraînera certainement des recompositions syndicales. Le second impératif est d’en finir avec le débouché politique institutionnel des luttes : on ne va pas rejouer 1981, qui clôt le cycle de 1968, avec des luttes se coupant elles-mêmes les ailes en attendant l’action de futurs et bien improbables « camarades ministres ». Le projet de transformation sociale, c’est au mouvement social de l’incarner. De la Grèce de Tsípras au Venezuela de Chávez, on le voit : dans les institutions, ça finit en cul de sac.
Vous avez vous-même noté les difficultés d’organisation du monde syndical en tant qu’acteur d’« On bloque tout », en 2016, qui a passé le relais au « Front social » un an plus tard. Quel bilan dressez-vous ?
Dans un numéro des Utopiques, j’ai justement essayé de faire un bilan d’« On bloque tout ». Notre volonté, c’était d’impulser du débat d’un point de vue stratégique, pour qu’il pénètre dans les structures syndicales de base — une sorte d’intersyndicale nationale horizontale qui répond aux besoins concrets des salariés. La revue Les Utopiques s’ouvre d’ailleurs aux contributions de syndicalistes d’horizons divers. Le « Front social » a une démarche un peu différente, sans doute plus activiste et mouvementiste. Peut-être qu’il faudrait chercher à avoir une nouvelle démarche, un « mix » des deux. Je suis convaincu que ce dépassement stratégique qui bousculerait le syndicalisme n’est possible qu’à travers ce type d’espace de discussions, notamment intersyndicaux afin d’élaborer des stratégies syndicales sur les objectifs et les modalités de la grève. Il faut un socle commun de débats et pratiques entre les syndicalistes de luttes, qu’ils ou elles soient à la CGT, à Solidaires, à la CNT-SO, à FO ou la FSU… Ailleurs, même !

« Une nouvelle fois, le dogme du mouvement social indépendant de la politique
a montré sa limite », a écrit Jean-Luc Mélenchon en octobre 2017. Doit-on abolir la Charte d’Amiens ?
Ce serait quand même difficile ! Peut-on abolir la Déclaration des droits de l’Homme ? Non, ce n’est pas sérieux. (rires) Cette charte n’est pas une bible que chaque syndicaliste correctement formé aurait sur sa table de nuit ; elle indique par contre une démarche stratégique d’indépendance et d’autonomie des mouvement sociaux et syndicaux vis-à-vis des débouchés politiques institutionnels, des partis, certes, mais aussi vis-à-vis de l’État lui-même. Ce texte est une réponse aux dérives de l’actuel dialogue social de type CFDT, où Laurent Berger préfère le dialogue perpétuel plutôt que le rapport de force. Edmond Maire, qui était le secrétaire confédéral qui a imposé l’évolution droitière de la CFDT, disait avoir réussi à instaurer « l’économie de la grève », c’est-à-dire qu’on ne va plus la faire… (rires) La Charte d’Amiens répond à cela en affirmant que sur le terrain social, il ne faut rien attendre de l’État, des institutions, des partis qui cherchent à s’y inscrire… Il ne faut agir, en définitive, que là où le rapport de force avec le capital s’exerce : le travail. Cela n’empêche pas que les partis et les organisations politiques puissent être des partenaires sur d’autres fronts de luttes, comme les libertés publiques fondamentales, les luttes antiracistes, féministes, écologiques… C’est même essentiel. Solidaires s’est positionné contre l’instauration de l’état d’urgence en faisant front commun avec des organisations politiques. Mais chercher un « pacte gouvernemental » du type « programme commun », ce n’est pas la troisième voie entre l’autonomie du mouvement social et le modèle social de l’hégémonie politique sur le mouvement ; c’est la concrétisation du second.
« Sur le terrain social, il ne faut rien attendre de l’État, des institutions, des partis qui cherchent à s’y inscrire. »
Est-ce qu’on a vraiment envie d’un retour à une situation d’après Seconde Guerre mondiale, avec une CGT tellement liée au PCF, quasi organiquement, qu’elle en devient uniquement une courroie de transmission ? Dans les années 1970, la CFDT a cherché à imaginer ce qu’elle appelle une « autonomie engagée » : elle est autonome mais elle est engagée aux côtés du Parti socialiste pour un vrai gouvernement de gauche « anti-autoritaire » (soi-disant) et non-stalinien. Cette position ne résista pas à la défaite de la gauche aux législatives de 1978 et à la frénésie de normalisation et d’intégration de la bureaucratie CFDT. Ce sera, par « réalisme », le lancement du « recentrage » sur la négociation avec les pouvoirs d’État et le patronat, en gommant la lutte des classes. Maintenant, cette centrale promeut le dialogue social dans une logique libérale qui est antinomique avec la Chartes d’Amiens. Pour FO, l’autonomie, c’est tout simplement ne pas faire de politique. Du tout. Quitte à faire l’impasse sur les libertés publiques ou la lutte contre l’extrême droite. Ces exemples montrent les dangers qu’il peut y avoir à négliger la démarche que propose effectivement la Charte d’Amiens. Remettre en cause la « double besogne, quotidienne et d’avenir », c’est nier la pertinence, l’intérêt, la vocation même de l’action syndicale qui est de prendre pleinement part à la transformation sociale. C’est sur la base des antagonismes de classe qu’il faut enclencher cette transformation pour produire autrement les activités, les services, les biens matériels — abolir le capitalisme en somme.