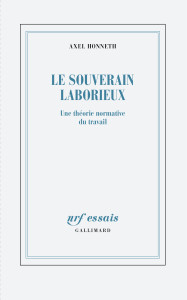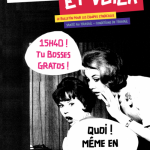Suite à l’article de Jean-Marie Pernot (« Propositions pour le dernier quart d’heure? » lire : http://syndicollectif.fr/?p=26011) nous avons reçu (par Claude Debons) cette contribution de Joêl Decaillon, ancien secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats (CES) et ancien dirigeant CGT, Christian Dellacherie, ancien membre du CESE pour la CGT, et Edouard Martin, responsable CFDT Arcellor-Mittal. Nous les remercions. Le débat va continuer.
- Télécharger l’article :Decaillon-Copie de AntiTina version Debons 17 07 25
Est sans doute venue, l’heure d’une stratégie syndicale unitaire, pour l’action et dans la négociation
Un projet politique démocratique s’emparant des tensions écologiques et sociales pour les résoudre simultanément, doit définir un horizon et une méthodologie.
Chaque séquence d’une transition « juste » nécessite de programmer l’enchaînement des actions concrètes pour y parvenir. La conception, l’évaluation de chaque programme, le suivi de son exécution, ne peuvent être menées que dans le cadre de processus de négociation coordonnés à plusieurs niveaux et dans la durée. Cela n’a rien d’évident. Il faut traiter un grand nombre de cas complexes de mobilité sociale, associant mutations et formations, selon des logiques à la fois territoriales et industrielles : le tout mené dans une société fragilisée par les inégalités sociales, notamment par l’insuffisance du parc de logements, la sous-capacité des services publics pour assurer un maillage du territoire, l’énorme défi du déplacement de travail avec le poids du coût d’utilisation de la voiture particulière. Toutes ces questions, pour être traitées de manière cohérente, supposent des politiques négociées en s’appuyant sur les organisations sociales qui ont vocation à s’inscrire dans une telle démarche.
Au premier rang de celles-ci se trouvent les organisations syndicales. Elles sont potentiellement à la jonction de deux axes majeurs des transformations à opérer : la réingénierie des processus industriels avec un développement de nouveaux savoir-faire, et les formations qui permettent de les acquérir ; la remise à plat des dispositifs d’aides aux entreprises, afin que l’effort soutenu d’investissement, à la fois dans la réduction systémique de leur impact environnemental et le développement de compétences individuelles et collectives reconnues, s’intègre dans des politiques industrielles structurées autour de filières et ou de territoires. Les organisations syndicales ont démontré au printemps 2023 leur capacité à s’unir et leur lucidité sur le potentiel politique du mouvement social, ce qui a libéré des énergies insoupçonnées sur l’ensemble du territoire. Une grande capacité de convergence existe, en recherchant activement le soutien et la coopération de toutes les organisations qui ont compris la nécessité politique d’une jonction démocratiquement pilotée entre les dimensions écologiques et sociales de la grande transformation à l’ordre du jour. Mais si l’envergure et la cohérence d’un projet proclamant une vision de l’intérêt général ne devaient pas être au niveau du défi posé, la tentation d’un repli sur des lignes de défense professionnelle, voire catégorielle, prendrait « naturellement » le dessus, sans être, pour autant, en capacité de contrer l’avènement et les ravages d’une dérive populiste autoritaire.
 Ci-contre : Christian Dellacherie (CESE)
Ci-contre : Christian Dellacherie (CESE)
Par le passé les luttes syndicales ont été décisives pour façonner notre « modèle » social, de la journée de 8 heures aux congés payés et à la Sécurité sociale.
Cette réalité des « avancées » sociales a transformé la condition des salariés sans « abolir le salariat (et le patronat !) », revendication qui figurait dans l’article 1 des statuts de la CGT jusqu’au congrès de 1995. La défense des « acquis » reste un pan essentiel de l’activité syndicale. Mais s’y cantonner (ou s’y enfermer), peut se révéler être un piège : une attitude « conservatrice » peut conduire à certaines formes de rigidité ou d’étroitesse corporatiste. L’appartenance à une « corporation » a toujours été un facteur premier d’unité, reposant sur des bases professionnelles et de proximité au sein de collectifs de travail. Toutefois, s’il ne s’accompagne pas d’une prise en compte de la complexité du système productif et de ses « chaînes de valeur », dans ses dimensions techniques, spatiales et sociales, le « corporatisme » est susceptible de limiter le champ d’intervention de l’action syndicale et de restreindre son efficacité. L’éclatement du salariat et la tendance au confinement institutionnel des « partenaires sociaux », au niveau de l’entreprise, source de myopie (ou de déni) sur les conditions et les perspectives nouvelles imposées par « l’environnement » au sens le plus large du terme (sociétal, écologique, politique, géopolitique), n’ont cessé de se renforcer. Ils posent le grand défi de la solidarité[1], tant au niveau de notre pays, qu’au niveau européen et à l’échelle du monde.
Comment le mouvement syndical français pourrait-il de nouveau contribuer à nourrir un imaginaire mobilisateur, à partir de son activité revendicative et de sa capacité à matérialiser des rapports de force ?
 Ci-contre : Edouard Martin en 2014 (par Claude Truong-Ngoc)
Ci-contre : Edouard Martin en 2014 (par Claude Truong-Ngoc)
Un premier obstacle réside dans son éparpillement. L’évolution du système de représentativité syndicale (qui visait pourtant à y remédier !), a finalement conduit à installer une concurrence exacerbée, se soldant par une grande faiblesse. Cette situation est quelque peu schizophrénique, tant elle est antinomique à l’objectif vital de la recherche de l’unité syndicale. Il est impératif de la surmonter, car elle dépossède le mouvement syndical de sa capacité d’initiative et de contrôle dans tous les processus de négociation, quel que soit leur niveau. La phase de la négociation est une partie intégrante de l’action syndicale, et l’unité d’action un des principaux gages de son efficacité. Dans l’intérêt des salariés et pour qu’ils continuent à leur accorder leur confiance, les organisations syndicales doivent se convaincre de la nécessité, préalablement à toute négociation, d’élaborer un ensemble de références constituant l’ossature d’un « ordre du jour » partagé permettant de créer un rapport de force pour conclure des « accords de méthode »[2]. Il n’y a pas de meilleure voie pour faire pièce à celui du patronat, que celui-ci sera toujours en mesure d’imposer, tant qu’il pourra profiter de la dispersion syndicale.
Les bases d’une alternative démocratique
Axel Honneth[3] attire l’attention sur « le lien très étroit qui existe incontestablement entre l’organisation du travail social et les conditions de participation démocratique ». Il définit cinq conditions permettant à tout individu de participer à ce qu’il appelle la « formation démocratique de la volonté ».
La première condition est sine qua non, c’est la sortie de l’insécurité économique, celle qui empêche pratiquement toute projection vers l’avenir, qu’il soit personnel ou politique.
Voilà pourquoi, comme on l’a vu précédemment, le champ de la défense des salariés en situation précaire est primordial. « Leur » précarité est à la fois un poids insupportable pour eux et une menace objective et ressentie massivement par beaucoup d’autres, ceux qui la côtoient et craignent de devoir un jour la connaître. C’est le champ revendicatif qui exige le plus l’émergence de nouvelles formes de lutte, d’organisation et de solidarité, d’autant plus que les forces syndicales sont concentrées dans des secteurs où des luttes historiques ont permis à certaines « corporations » d’échapper à cette précarité, parfois en la cantonnant dans le cadre de différentes formes de sous-traitance. Les syndicats sont malheureusement souvent absents là où les conditions d’exercice du travail sont les plus dégradées[4].
La sortie de l’insécurité économique n’est pas suffisante pour accéder à l’émancipation démocratique, elle doit s’accompagner de l’existence d’une ressource de « temps disponible ».
Cette deuxième condition est liée à la première pour les catégories à faible revenu. Cependant, elle vaut tout autant pour d’autres groupes relativement affranchis de la contrainte matérielle, mais soumis à une sollicitation en temps exagérée. Cette notion de temps disponible doit être comprise de façon quantitative (temps de travail et de transport auxquels s’ajoutent les temps contraints requis par les tâches domestiques) et qualitatives (hors temps de récupération majorés par le stress ou la charge mentale liés à l’activité professionnelle). Une partie de ce temps doit aussi être libéré et mobilisé sur le lieu de travail. La participation démocratique dans la « cité » est actuellement fortement obérée par son absence dans « l’entreprise », réalité socio-économique dont le fonctionnement requiert, pourtant, une dynamique collective. Il est légitime de (re)donner la parole à ce collectif sur son lieu d’action : sans cette contrepartie, la subordination du salarié constitue une amputation du citoyen. Il faut instituer les conditions juridiques et pratiques de l’exercice de cette responsabilité collective nécessitant l’ouverture d’espaces et de temps de réunions confortables.
Le comité d’entreprise, devenu CSE, imaginé par le Conseil National de la Résistance, a été une étape essentielle dans ce sens.
Depuis, non seulement on n’est pas allé plus loin, mais on a même régressé par « ordonnances ». Sans même en tirer le bilan on a vidé de leur contenu les lois Auroux de 1982. Le plus rétrograde et finalement le plus absurde, a consisté dans la suppression des CHSCT[5] (Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) un lieu privilégié où se formait une expertise précieuse et irremplaçable dans l’échange « apprenant » entre des salariés motivés et des experts pluridisciplinaires du travail. Il s’est agi d’une négation des connexions étroites entre santé au travail et santé publique, sur une échelle très large allant de la pollution au burn-out ; des connexions tout aussi étroites entre santé au travail et protection de l’environnement, base évidente d’un lien à créer ou à renforcer entre les organisations syndicales et les ONG environnementales. Il aurait été intelligent et responsable d’approfondir la logique des lois Auroux en introduisant de nouveaux droits permettant l’expression et l’intervention des salariés, non seulement sur les conditions et l’organisation de leur travail, mais aussi et surtout sur le sens de leur travail[6]. 83 % des employés disent qu’ils souhaitent agir pour le climat dans le contexte de leur travail, mais… n’en ont pas le pouvoir : ils n’ont pas le pouvoir de se faire entendre sur des sujets-clés, alors qu’ils sont au cœur même de processus majeurs qui les conditionnent !
« La participation à l’espace public démocratique requiert aussi un certain degré d’estime de soi, un certain sentiment de sa propre valeur »[7].
Cette estime de soi doit se construire dans tous les lieux où se développe une « sociabilité » et se dispense une « culture ». Milieu familial et milieu social sont importants, mais peuvent constituer à la fois une ressource et un frein, compte tenu des inégalités sociales ou de circonstances défavorables. Vient ensuite l’école, dont le fonctionnement ne permet pas qu’elle contribue efficacement à rectifier la donne sociale[8], la conception de la formation initiale continuant à privilégier systématiquement la compétition qui distingue mais qui élimine, sans cultiver la coopération qui intègre et valorise. D’autres instances y participent comme l’activité associative sportive culturelle et à vocation sociale. Dans le cadre de l’entreprise, au sein du collectif de travail, l’estime de soi se construit et s’entretient dans une pratique de la coopération, c’est-à dire un rapport positif à l’interaction avec les autres. Elle dépend beaucoup de la nature du travail selon qu’il stimule les capacités créatrices propres à tout cerveau humain ou qu’il se résume à des tâches répétitives et monotones, finissant par déteindre sur l’habitus intellectuel et les rapports à l’environnement social. Il dépend également beaucoup de la qualité du management et de l’organisation de la formation continue. La tendance à la dégradation de la situation risque de s’accentuer et de concerner de plus en plus de professions, avec l’extension du « flicage digital » des salariés, style Amazon, et le développement « sauvage » de l’IA générative
L’entrée par la question du travail est sans aucun doute « un » moyen nécessaire « privilégié » pour parvenir à redonner du crédit à un désir d’émancipation s’ouvrant sur un nouvel horizon politique.
Comme l’indique Jean-Marie Pernot, « c’est un thème fédérateur qui permet d’ouvrir les portes du syndicalisme, à tous ceux qui ont quelque chose à dire de l’insatisfaction qu’ils ont à travailler comme ils le font : c’est redonner au travail syndical de base la responsabilité de produire les revendications adaptées, c’est créer une communauté de points de vue préalable à la constitution de communautés d’action collective pour changer le travail »[9]. La CFDT avait lancé en 2016 une grande enquête « Parlons travail »[10] destinée à recueillir des paroles « et faire émerger les véritables préoccupations de travailleurs ». Plus de 200 000 questionnaires étaient remontés démontrant la résonance de cette thématique dans le monde du travail. Mais la CFDT n’en a pas fait grand-chose. Pourquoi ? La CGT avait, de son côté, entamé à la fin des années 2000 une démarche dite « Travail et émancipation » qui avait permis un rapprochement très productif entre syndicalistes et chercheurs, et qui ne demandait qu’à déboucher sur une généralisation des démarches de type « recherche-action »[11] sur le travail. Ce chantier a été interrompu par la direction confédérale en 2019 après le 52ème congrès, sans aucune explication. Il n’est pas du tout sûr que cet abandon résulte d’une décision « politique ». Il est plus vraisemblable que la prise de conscience n’a concerné qu’une faible partie tant de l’ensemble du corps militant, absorbé par les difficultés au quotidien, que des appareils fédéraux qui n’ont pas considéré que cela s’inscrivait dans leurs priorités. Comme le dit en deux mots Fabien Gâche[12] (délégué central CGT du groupe Renault de 2008 à 2020) : ce qui venait à l’esprit des militants, c’était de dire : « Bon, aujourd’hui, c’est plutôt l’emploi qui doit nous motiver plutôt que de savoir le contenu du boulot, parce que là on risque de perdre le boulot, quoi ? ». C’est le même Fabien Gâche qui produit ce jugement lucide et solide sur l’activité syndicale : « (elle) ne se limite pas à la tournée syndicale pour recenser les dysfonctionnements, recueillir les avis des salariés pour les renvoyer à la direction dans les IRP, dit autrement, à demander à ceux qui créent les problèmes de les résoudre. L’activité et l’action syndicale ne sont pas réduites à la critique générale, à « convaincre » les travailleurs du bien-fondé de notre point de vue, de nos actions et de les amener à se joindre à nous, à nous soutenir. Il s’agit de sortir du constat, de la plainte, de la désolation pour ouvrir des perspectives construites avec les salariés eux-mêmes »[13]. Donnons la parole à Franck Daout[14], un autre ancien délégué central du groupe Renault, de la CFDT cette fois. Il fait un constat similaire sur la prégnance de la question de l’emploi sur les militants : « historiquement, cet abandon relatif du travail concret au profit de l’emploi s’explique par de longues années de chômage de masse, qui a longtemps dominé les priorités des partenaires sociaux ; il était logique que les syndicats se focalisent sur la défense des postes. D’autre part, les entreprises ont investi le champ des compétences et de la formation, au détriment d’une réflexion plus approfondie sur le contenu concret du travail. Dans de nombreux accords signés par les partenaires sociaux, on parle ainsi de « commissions emploi-formation », mais rarement d’instances centrées sur la qualité du travail ou sur la manière de réaliser les tâches ». Après avoir rappelé l’évolution de la convention collective de la métallurgie obtenue au bout de huit ans de négociation, il porte un jugement positif sur son contenu mais mitigé sur sa mise en pratique : « un texte ne peut pas changer les organisations tout seul, il faut aussi un changement culturel : cesser de considérer les salariés comme de simples exécutants ou comme des « porteurs d’indicateurs », et redécouvrir la richesse du travail concret, son potentiel d’innovation et de coopération. Le dialogue professionnel est justement un outil pour impliquer davantage les salariés, rendre les managers plus conscients des réalités de terrain, et mieux articuler ce qui se passe dans l’atelier ou le bureau avec la stratégie globale de l’entreprise. La convention collective offre un socle juridique et des principes directeurs. Mais naturellement, cela ne fonctionnera que si la direction générale accompagne ce mouvement, sans se limiter à une communication de façade ».
Le fait le plus surprenant qui ressort de ces deux témoignages, c’est que ces deux organisations se soient lancées à quelques années d’intervalle, sur cette piste revendicative stratégique sans se rendre compte (ou sans vouloir admettre ?) que, sur ce terrain, elles avaient eu l’opportunité de jouer la coopération dans l’émulation, mais ne l’avaient pas saisie. Chacun reconnaît que la dislocation des collectifs de travail, produite ou aggravée par la fragmentation salariale, appelle à la recherche active de l’unité. Celle-ci reste trop souvent au stade d’un enjeu tactique conjoncturel : elle n’est pas considérée comme un objectif stratégique mobilisateur permanent, nécessaire à l’établissement du rapport de forces qui permettra l’aboutissement des revendications.
Les uns et les autres gagneraient à repousser l’idée insufflée par la culture « identitaire » des différences, selon laquelle « rien n’est possible ensemble, alors qu’en réalité, rien n’est possible tout seul »[15].
L’extension des sous-traitances en cascades entraîne la pression concurrentielle sur les salaires, l’insuffisance des formations et des politiques de prévention.
Mettre l’accent sur la part des dérèglements du travail dans le recul des aspirations émancipatrices est un objectif primordial, mais il n’est pas le seul. « Le véritable lieu de production des normes en matière de conditions d’emploi (salaires, conditions de travail, statut d’emploi), est moins déterminé par l’appartenance à une branche que par la place occupée dans la chaîne de valeur »[16]. C’est la raison pour laquelle, en Allemagne, IG METALL s’est engagé, il y a quelque temps, dans une modification de la « négociation tarifaire », prônant l’inclusion de l’ensemble des travailleurs impliqués le long d’une chaîne de valeur. Le principe de solidarité était a priori partagé, mais sa réalisation en termes de négociation s’est révélée beaucoup plus difficile. Le premier acte en a été l’inclusion des intérimaires, objet de très nombreux débats dans les comités d’établissement. Le second visait l’inclusion des chercheurs : il fut encore plus compliqué. Ceux-ci étaient d’accord sur le principe, mais leur attachement à leur spécificité (pour ne pas dire leur corporatisme…) allait à l’encontre de cette vision. Après bien des débats internes assez houleux (et ils ne sont pas terminés…), ils sont parvenus à une solution. Les débats mériteraient d’être ouverts pour faire prévaloir une démarche analogue en France, posant comme priorité, de viser le plus possible l’inclusion de l’ensemble des travailleurs associé à chaque processus de production de biens et de services.
Les syndicats français et allemands ont conclu récemment un accord de coopération pour la défense de la démocratie et contre l’extrême droite. On peut imaginer qu’une telle coopération gagnerait à englober une réflexion commune sur « le lien très étroit qui existe (…) entre l’organisation du travail social et les conditions de participation démocratique », tel que l’a mis en lumière Axel Honneth.
Christiane Benner, présidente d’IG Metall depuis fin 2023, a entrepris de redéfinir le rôle du syndicat, en l’élargissant. Elle prend davantage en compte la nouvelle économie, pour se concentrer sur des enjeux industriels mondiaux, en soutien du site de production et de la « souveraineté » européenne. Elle réclame une politique industrielle active, une obligation de « contenu local » pour les groupes étrangers qui veulent vendre en Europe, et la défense des usines. Elle plaide pour renforcement de la « démocratie en entreprise », qu’elle définit non comme un lieu de production, mais comme une institution sociale, où la codécision devrait être davantage ancrée. Depuis des décennies, l’industrie allemande évoque, « des emplois de production très bien payés et protégés, répartis sur le territoire, grâce à des produits vendus à forte marge dans le monde entier, fabriqués par des entreprises où un syndicat organise le partage de la valeur ajoutée, défend les emplois et les postes d’apprenti, dans une certaine idée de l’ascension sociale. Ce contre-pouvoir construit sur l’industrie représente un élément majeur du modèle social allemand »[17]. Peut-il survivre au choc économique en cours, particulièrement illustré par le « passage », sans doute irrésistible, de l’automobile thermique à l’automobile électrique ? Cette question qui se pose de façon cruciale en Allemagne (et celles, souvent analogues, qui se posent dans d’autres secteurs industriels), concerne en fait toute l’Union européenne.
Selon Alain Supiot, « le travail est quelque chose de plus grand que l’emploi (…). L’emploi est né de ce grand pacte, issu des luttes syndicales de l’ère industrielle, qui a consisté à échanger l’aliénation au travail, le renoncement à dire son mot sur la production, contre des limitations du temps de travail et de la sécurité physique et économique ».
Là où elle existe, on peut toucher du doigt les limites actuelles de la « codétermination ». Là où elle est inexistante ou « rudimentaire », on peut mesurer les ravages ou les impasses du pouvoir discrétionnaire de la strate supérieure du gouvernement d’entreprise. C’est un terrain sur lequel la réflexion et la coopération syndicale européenne devraient s’investir. Il s’agit d’étendre la sphère du droit social à la dimension sociétale de l’activité économique, au gré de la transformation de l’entreprise en un bien collectif[18]. Si l’on veut contraindre les groupes pharmaceutiques ou agroalimentaires, à produire en France ou en Europe, il faut reprendre la main sur des aspects décisifs de la réglementation. La traçabilité des chaînes de valeurs mondiales doit devenir obligatoire alors qu’elle n’est aujourd’hui, selon les règles européennes en vigueur, que déclarative[19]. Les commandes publiques des collectivités locales et de l’Etat peuvent favoriser la relocalisation, à condition de réviser les règles européennes qui régissent les marchés publics. L’expression « libre échange » travestit la réalité d’un processus extrêmement sophistiqué où l’accès aux marchés et la maîtrise de leur fonctionnement supposent de jongler avec les normes, tant pour les établir que pour les contourner. Ce jeu et ses règles sont beaucoup trop entre les mains des multinationales dont le poids devient souvent supérieur à celui des Etats[20] avec leur consentement : les accords de libre-échange de nouvelle génération visent à unifier les normes en les « simplifiant », et instaurent des tribunaux privés d’arbitrage subrogeant les organismes judiciaires publics indépendants, pour juger de la « supériorité » du droit au profit par rapport aux choix démocratiques des populations. Les nouveaux instruments numériques voient leur fonction « confinée » au marketing intrusif ou au contrôle social (gouvernance par les algorithmes). Pourtant l’utilisation de ces technologies pourrait dès maintenant permettre une meilleure connaissance, une meilleure traçabilité, une meilleure transparence des flux de matières, des cycles productifs et des chaînes de valeur.
Qui doit être dans la négociation, notamment au niveau de la production de normes aujourd’hui ?
Ne faut-il pas ouvrir une voie vers une inclusion plus large des ONG[21] ? L’imaginaire syndical d’aujourd’hui doit évoluer, par l’émergence de nouvelles formes de lutte et d’organisation, par un élargissement des contacts et des échanges avec d’autres groupes de réflexion et d’action, en mesurant notamment l’extrême importance des ONG dans l’engagement des jeunes générations, qu’elles soient sociales, « environnementales » ou culturelles. Cet élargissement est sans doute un axe à privilégier pour l’efficacité de la lutte revendicative elle-même, permettant, à chaque niveau territorial, de concrétiser un point de vue beaucoup plus large, visant l’intérêt général. Il suppose des formes de travail, faisant appel à des apports diversifiés, incorporant des expertises qui améliorent la maîtrise du mouvement syndical, sans pour autant lui imposer des conclusions « expertes » brûlant les étapes nécessaires du débat et de l’expérimentation démocratique. Il permet aussi d’envisager et de mettre en place une autre conception des échanges internationaux Nord Sud, s’agissant, par exemple, de l’accès et de l’usage des terres rares aux fins d’une utilisation technologique partagée.
Joêl Decaillon, Christian Dellacherie, Edouard Martin.
Notes :
[1] Louis Viannet, exprimait très clairement cette nécessité de solidarité et d’unité : « Réfléchir aux éléments de solidarité qui doivent se construire dans un même lieu de travail, entre ceux qui ont un statut ou sont couverts par une convention collective, ou même tout simplement un emploi à durée déterminée, et les précaires corvéables et malléables à merci (…) Loin de moi de préconiser un comportement d’assistanat, mais de concevoir au contraire, une solidarité de lutte ».
[2] Accord conclu et négocié entre un employeur ou des représentants d’employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés afin de définir en amont la méthode de négociation (articles L1233-21 et suivants du code du travail).
[3] Axel Honneth, « Le Souverain laborieux », Gallimard 2024
[4] Là où ils sont présents, on les trouve parfois démunis comme l’ont montré quelques cas comme France Telecom ou encore la sécurité sur les sites nucléaire où la forte présence syndicale n’a en rien protégé l’exposition aux risques des opérateurs de la sous-traitance. (voir Jean-Marie Pernot, « Propositions pour le dernier quart d’heure »)
[5] L’absence d’une réaction unitaire, notamment des deux plus grandes confédérations syndicales, face à cette suppression est plutôt consternante. Elle corrobore cette incapacité relative de la prise en compte revendicative concrète de la question du travail (déjà présente dans le caractère subalterne implicitement attribué au CHSCT par rapport au CE), de son sens, de ses potentialités émancipatrices, de la dimension subversive de (re)conquête de la citoyenneté qu’elle contient.
[6] Ce sentiment est largement partagé comme en témoigne l’enquête menée par Johanna Barasz sur le milieu enseignant, pour le compte du Haut-Commissariat au plan et à la stratégie : « Les enseignants adorent leur métier, 92 % d’entre eux disent ne pas regretter leur choix. Mais ce qu’ils veulent avant tout, c’est avoir les moyens de bien le faire. Or, ils ont de moins en moins l’impression de pouvoir remplir leur mission auprès des élèves en raison de la dégradation perçue des conditions de travail et d’un manque de moyens. (..)Les relations dégradées avec leur hiérarchie administrative, le manque de reconnaissance ou encore la succession des réformes, (..)alimentent leur malaise. Tout cela nourrit un profond sentiment de perte de sens qui pèse lourdement sur la profession ». Il s’agit bien d’un thème universel justifiant une coopération syndicale interprofessionnelle.
[7] Axel Honneth, « Le Souverain laborieux », Gallimard 2024
[8] « L’école hérite d’inégalités sociales et familiales, mais produit à chaque étape de la scolarité des inégalités de natures différentes qui se cumulent et se renforcent. L’école française est aussi marquée par des inégalités scolaires d’origine migratoire malgré un fort investissement dans l’éducation des familles issues de l’immigration (recours aux cours privés, fortes aspirations des familles dans les vœux d’orientation, etc.). Au total, ces fortes inégalités à l’école placent la France en tête des pays de l’OCDE pour le caractère socialement reproductif de son école ». Rapport du Cnesco (Centre national d’étude des systèmes scolaires qui analyse et accompagne des politiques et pratiques éducatives). Le Cnesco est le fruit d’un partenariat entre le ministère chargé de l’éducation nationale et le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), auquel il est rattaché, au sein du laboratoire Formation et apprentissages professionnels (Foap), depuis le 1er septembre 2019.
[9] Jean-Marie Pernot, Propositions pour le dernier quart d’heure
[10] ibid.
[11] La recherche-action (ou recherche-intervention, ou encore recherche-expérimentation) est une démarche et une méthode de recherche scientifique qui vise à mener en parallèle et de manière intriquée l’acquisition de connaissances scientifiques et des actions concrètes et transformatrices sur le terrain. Voir sur ce sujet l’entretien de Fabien Gâche, délégué central CGT du groupe Renault de 2008 à 2020, avec Sabine Fortino et Lucie Goussard, dans Chroniques du travail « Redynamiser le syndicalisme par une démarche centrée sur le travail réel. De quelques enseignements des recherches-actions conduites par la CGT »
[12] Cf son entretien en décembre 2024 avec Sabine Fortino et Lucie Goussard, dans Chroniques du travail « Redynamiser le syndicalisme par une démarche centrée sur le travail réel. De quelques enseignements des recherches-actions conduites par la CGT »
[13] ibid.
[14] Voir Economie politique n° 105 de février 2025
[15] Jean-Marie Pernot, Le syndicalisme d’après Ce qui ne peut plus durer octobre 2022
[16] Ibid.
[17] Voir La désindustrialisation en Allemagne, un bouleversement historique pour les syndicats, de Cécile Boutelet publiée dans le Monde du 15 juin 2025
[18] La loi Pacte effectue un premier pas beaucoup trop timide en ce sens…
[19] Et par un organisme privé ! voir l’interview de El Mouhoub Mouhoud dans Alternatives économiques n° 402
[20] Des critiques ont été prononcées contre l’OMS en raison des relations de dépendance qu’elle aurait notamment vis-à-vis de la Chine. Il ne faudrait pas oublier qu’à travers les partenariats public-privé, les grands groupes pharmaceutiques (et BillGates !) ont acquis une influence prépondérante au sein de cette organisation, risquant de se renforcer avec le retrait financier des USA.
[21] Cette question se pose y compris au niveau de l’OIT (Organisation internationale du travail)