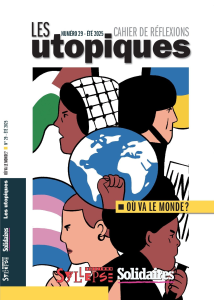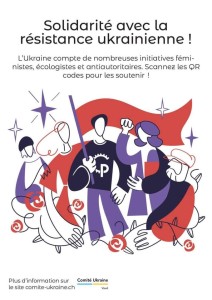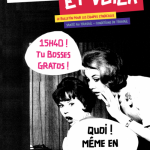Le numéro 29 (été 2025) de la revue Les Utopiques, Cahier de réflexions de l’Union syndicale Solidaires s’intitule : « Où va le monde ? » S’il est un débat difficile à aborder dans « le monde » syndical, mais aussi dans les mouvements sociaux variés, c’est bien celui-là. L’éditorial de la revue le précise sous cette formule : « Nous ne définissons pas ici une ligne à suivre, nous voulons fournir des outils pour la formation, les débats, les actions syndicales ». C’est déjà une courageuse idée que de montrer une diversité d’approches, plutôt que faire l’autruche. Il faut le saluer.
- Sommaire (voir plus bas en lecture directe): Les utopiques 29 – Sommaire
Guerre, paix… fascismes
Les Utopiques ouvrent le débat
Jean-Claude Mamet
Avant l’arrivée officialisée de Trump au pouvoir en ce début d’année, il y avait parfois des difficultés à unir dans une compréhension commune les collectifs militants actifs sur la Palestine et ceux mobilisés sur l’Ukraine. Avec Trump et la réorganisation violente du monde à grande vitesse, on ne peut pas éviter un regard d’ensemble et si possible une cohérence de nos actions. Nous sommes au pied du mur.
Un des défis est le réarmement des états en Europe. Nous savions que la France vendait des engins de mort à qui mieux mieux (3ème pays au monde), mais ce n’était pas destiné à des guerres à nos portes. Dès lors que les chefs d’état (surtout les trois « grands » : France, Allemagne, Grande Bretagne) éveillent leurs opinions publiques à des éventuelles participations à des théâtres de guerre en Europe, tout le monde doit se positionner : quel est le but ? quelle guerre « juste » ? Être possiblement actifs militairement en Ukraine et laisser faire à Gaza ? Insupportable. Idem sur les dépenses d’armement sans compter. Plus 6 milliards en plus en France dans le budget militaire 2026-27 alors qu’on veut en économiser 43 milliards en tapant sur les droits sociaux et les services publics ; objectif 100 milliards pour l’armée annoncés en Allemagne même avant même l’arrivée de Merz aux affaires ; + 3,5 % de PIB en dépenses militaires dans les pays européens de l’OTAN (et vers les 5%) alors que la barre de 3% de déficit ne doit pas être dépassée. Scandale.
La paix? Quelle paix?
Dans cette situation, voici quelques extraits de positionnements qui posent question, dans cette revue ou d’autres sollicitations :
- Le premier article de ce numéro des Utopiques (par Ophélie Gath, membre du secrétariat national de l’Union syndicale Solidaires) se conclut par la défense des dépenses sociales et de services publics (ce qui va de soi), mais après avoir expliqué : « L’Union syndicale Solidaires est viscéralement attachée à la paix et estime que les peuples n’ont pas à payer …les conflits qui opposent surtout les puissants ».
- Je me suis trouvé sollicité (avec d’autres) pour répondre à une proposition du Collectif pour un pôle public financier, où participent des syndicats, la Convergence de défense des services publics, l’association syndicale Information et défense des consommateurs (INDECOSA) CGT pour signer en avril 2025 un appel susceptible de se transformer en manifestation. Cet appel expliquait :
« …. Nous appelons à la mise en place d’un très large débat national en faveur d’un vivre ensemble qui prépare une paix juste et durable et ne vienne pas alimenter les prochaines guerres mais au contraire concoure au développement de la coopération entre les peuples. Par cela nous entendons privilégier une économie qui ne soit pas une « économie de guerre » susceptible d’alimenter une « course aux armements …Etc. »
Je n’ai pas soutenu ce texte pour ce passage. Car il reprenait le langage classique sur les dépenses d’armement et évitait d’aborder précisément la nouvelle situation. Se prononcer pour « une paix juste et durable », qui peut être contre ?
- De son côté, le Mouvement de la paix, qui agit depuis 1948 « contre la production et les transferts d’armements, pour la réduction des budgets militaires» exhorte également à signer une pétition à partir d’une quasi-évidence :
« Aucune de nos différences de convictions, d’appartenances ou de sensibilités philosophique, politique, religieuse, syndicale ou autre ne doit faire obstacle à l’expression de notre conviction que pour son avenir, l’humanité n’a d’autre chemin que la construction de la paix à travers le développement de la coopération et l’amitié entre les peuples.
Pétition : CONDAMNATION DE L’ATTAQUE MILITAIRE DE LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
LA GUERRE N’EST JAMAIS LA SOLUTION, OUI A UNE SOLUTION POLITIQUE NEGOCIEE. »
Négociation ? bien sûr. Mais on fait comment quand la guerre fait rage, qu’il y a un agresseur et un agressé, une « attaque militaire » comme le reconnait le texte ? On fait comment en Palestine quand l’attaque terroriste et criminelle du Hamas le 7 octobre 2023 débouche sur un processus génocidaire à Gaza et l’utilisation de l’arme de la famine pour anéantir le droit palestinien à un Etat ? Et sous la bénédiction des Etats-Unis dont le président rêve du prix Nobel de la paix pour défendre une riviera pacifique et touristique à Gaza, après l’avoir purifié de son peuple ?
En quelques mois, c’est la force brute qui régit les rapports de force intercontinentaux et même entre pays « alliés ». Le « doux commerce » et la « mondialisation heureuse » (violente aussi sous la forme du néolibéralisme et sa capacité à dissoudre les rapports humains remplacés par des valeurs financières) se sont volatilisés.
- Les Soulèvements de la Terre ont raison de dénoncer dans leur contribution que le « business» guerrier est très « lucratif » et que « ce sont les mêmes entreprises qui fabriquent les armes de guerres et celles du maintien de l’ordre » (dans les manifestations écologistes ou en Kanaky). « Guerre à la guerre » écrivait Jean Jaurès avant 1914, cité par les Soulèvements de la Terre, mais le contexte était fort différent. Aucune guerre, aucune violence ne ressemble complètement à une autre, et l’article de Brendan Chabannes (de Solidaires 80) sur les Etats-Unis, la Russie, alliés de fait contre l’Ukraine, analyse minutieusement l’historique de ces fascismes d’un nouveau type, très différents de ceux du 20ème siècle.
- Aujourd’hui, ce qui est sûr, c’est que « les monstres sont lâchés» explique Nada Cladera (de SUD éducation), en dénonçant (page 30) la « connivence » entre « les néofascistes des Etats -Unis et ceux du monde entier ».
- Après la phase mondialiste expansive, on assiste un peu partout à une « reterritorialisation» des puissances destructrices du capitalisme (lire sur ce concept : Deleuze, Guattari-1972- Frédéric Rambeau-2023) qui n’est pas sans rappeler les systèmes de violence ayant permis l’éclosion du capital mondial. Or, contre la « territorialisation » fasciste au 20ème siècle et son explosion rapide dans la 2ème Guerre mondiale, les diplomaties pacifiques ont échoué (conférences pour la paix, Munich 1938). Les forces de résistance ont donc pris les armes, et se sont retrouvées en front commun avec des états souvent peu recommandables, mais libéraux (et même avec l’Etat stalinien, dont le système de brutalité était encore différent et pernicieux, à tel point que de nos jours il nourrit encore à gauche des ambiguïtés « campistes »).
- Pour illustrer ce nouvel état du monde capitaliste, citons un grand article de Gérard Gourguechon (Solidaires Finances publiques, Union nationale des retraité-es de Solidaires, et ancien porte-parole de Solidaires). Cet article (que l’on peut relire ici : http://syndicollectif.fr/?p=25941) n’est qu’en partie reproduit dans ce numéro des Utopiques et c’est dommage (nous y reviendrons). Sous l’intitulé d’un « retour affiché de l’impérialisme territorial [je souligne] américain », il poursuit :
« C’est certainement sous cet angle « économiste » qu’il faut comprendre la politique impérialiste et d’accaparement exprimée par Trump à l’égard des richesses minières du Canada, du Groenland et même de l’Ukraine qui serait ainsi « taxée » pour rembourser ce que les USA viennent de lui envoyer pour mener « sa guerre » contre Poutine. La conséquence, c’est aussi la volonté d’exclure la Chine du canal de Panama : s’approprier de nouvelles terres, de nouveaux territoires, un nouvel « espace vital » considéré comme indispensable par cette politique visant à maintenir et renforcer la domination des USA et la prospérité des Américains. Pour annoncer que « L’Amérique allait retrouver sa grandeur », Donald Trump, plusieurs fois, a fait référence à l’un de ses prédécesseurs, le Président McKinley, président de 1897 à 1901. C’est avec lui que l’impérialisme territorial américain s’est exprimé ouvertement. Mais cet expansionnisme avait commencé dès le début de « l’histoire américaine », avec la « conquête de l’Ouest » et le massacre de 95% de la population autochtone ».
Ainsi ce n’est pas le fascisme « années 30 » qui se répète, mais les oscillations entre conquête territoriale violente et phase mondialisée sans limite. Cette description a l’avantage de monter en généralité dans la compréhension de la barbarie des mondes.
L’enjeu d’une Europe résistante
On sait que Trump aime bien les puissants, même quand ils sont concurrents. Trump, Poutine, Netanyahou, et même Xi Jinping interagissent entre eux comme s’ils se partageaient des zones de contrôle du globe. L’échelle des rapports de force est continentale, plus que jamais. C’était déjà le cas, pour justifier l’horizon européen des luttes, pour des politiques de bifurcation écologique efficace ou pour résister durablement au démantèlement des droits sociaux laminés par les machines néolibérales. L’écologie appliquée demande certes un ancrage territorialisé, associant humains et chaines de vie. Agir local, penser global : la visée est bien internationaliste. L’Europe est la dimension appropriée, à condition bien sûr de se réformer radicalement.
 à gauche: jeunes mobilisés contre le gouvernement d’Ukraine (juillet 2025)
à gauche: jeunes mobilisés contre le gouvernement d’Ukraine (juillet 2025)
Les ukrainien-nes (y compris les jeunes mobilisés en juillet 2025 face à leur propre président acculé par Trump et le marché mondial des ressources minières) ont résisté à Poutine parce qu’ils/elles étaient une société, un agir commun et visant l’Europe. C’est le point fort de leur première « victoire » : tenir trois années de guerre, alors que l’asymétrie avec la vaste Russie est énorme. Ils/elles demandent des armes, il faut les leur donner, donc les produire. S’ils ont besoin d’une force d’interposition, il faut être présent, par des détachements européens ou plurinationaux. C’est pourquoi l’Ukraine citoyenne veut s’appuyer sur l’Europe comme cadre commun, même avec sans doute des illusions.
 à gauche : Manifs syndicales contre Trump aux US
à gauche : Manifs syndicales contre Trump aux US
- Aussi, on ne peut qu’être d’accord avec Verveine Angeli (militante de SUD PTT, ex-membre du secrétariat de Solidaires, membre d’ATTAC) quand elle explique (page 66) que pour aider l’Ukraine, « l’Europe est une réalité géographique, historique, et que le rapport de proximité, la mémoire collective des évènements dramatiques et des guerres sont nécessairement plus présents». Il en irait de même avec la Géorgie, les autres peuples de Russie et les citoyen-nes Russes entrant en résistance et autorisant ainsi des liens concrets et collectifs. Des liens sont possibles avec le syndicalisme ukrainien (article de Patrick Le Tréhondat, page 84), mais aussi avec le syndicalisme étatsunien décrit dans l’article passionnant de Dan La Botz, chauffeur de camion (lire son article ici : http://syndicollectif.fr/?p=26396). Verveine Angeli poursuit en énumérant les attitudes critiques face aux dépenses militaires accrues. Elle fait la part entre la classique opposition à « une austérité supplémentaire », qu’il faut combattre, mais en abandonnant une vision « datée » et détachée de toute compréhension nouvelle « des évènements actuels ». Comme s’il n’y avait, ajoute-t-elle, « qu’un seul impérialisme menaçant » (les USA). Elle termine par des propositions de « refonte du complexe militaro-industriel français », la « nationalisation » des industries d’armement, et la « consolidation des budgets des pays européens », qui constituerait de fait « le plus gros budget militaire du monde » si l’Europe voulait vraiment coordonner ses moyens (ce que propose aussi l’économiste Thomas Piketty dans ses chroniques au Monde). Autrement dit si l’Europe assumait d’être une société plurielle et solidaire, et pas une kyrielle d’identités nationales, ainsi menacées de tomber très vite dans l’escarcelle des extrêmes-droites nationalistes.
Pour la paix « comme tout le monde » ? (questionne Christian Mahieux)
Christian Mahieux (ci-contre), de SUD Rail, ex-membre du secrétariat national de Solidaires, animateur de la revue Les Utopiques (et des éditions Syllepse) questionne un article de la revue Cerises la coopérative. On y lit en effet ceci : « Sous la pression des Américains et de la menace russe, les classes dirigeantes sonnent l’alarme et appellent à un réarmement généralisé ». « Cela me parait partiellement erroné » commente Christian Mahieux. Il met en cause le terme « pression » ainsi que la « menace » russe, alors que la Russie fait plus que menacer : elle envahit un pays.
Il s’en prend à un discours répétitif « pour la paix » entendu de tous côtés. Il en dénonce « l’hypocrisie » possible. Certes, l’idéologie du « militarisme » doit être combattue, d’autant qu’elle sert de prétexte pour abattre d’abord les droits sociaux et orienter les investissements vers des états forts. Comme cela se produit par exemple autour du trio France/Grande Bretagne/Allemagne, sans que l’Union européenne (UE) fasse des pas en avant comme civilisation ouverte au monde. Bien au contraire avec les politiques migratoires toujours plus agressives ou les reculs écologiques. La reconnaissance positive de l’Etat de Palestine par la France, si elle s’étendait à ce trio, serait certes très importante pour une « Europe de paix », surtout si cela induisait aussi la rupture des liens commerciaux et militaires avec l’Etat d’Israël.
Il fut un temps, au début des années 2000, où l’hypothèse d’une force onusienne d’interposition entre Israël et la Palestine (Cisjordanie) avait été défendue (Jean-Paul Chagnollaud et Bernard Ravenel, été 2001). Ne faudrait-il pas la proposer pour protéger les convois humanitaires à Gaza ? Le Mouvement de la paix le disait peu après 7 octobre 2023 : cessez-le feu et « mise en place d’une force d’interposition, sous l’égide de l’ONU ».
Christian Mahieux cite le Réseau européen de solidarité avec l’Ukraine, montrant qu’une orientation internationalement unifiée peut prévaloir pour les droits des peuples : « C’est l’impuissance de l’ONU et de la communauté internationale à faire respecter le droit international en Ukraine qui provoque et accélère ce réarmement. Impuissance qu’on retrouve tragiquement en Palestine ». De même : « C’est la guerre de Poutine qui a conduit à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN », et pas l’OTAN qui menacerait la Russie et déclencherait l’invasion de 2022. Il n’y a pas un, mais « des » impérialismes. Même si leurs logiques et intérêts sont différents, ils se donnent la main dans cette phase de chaos mondial.
L’article incomplet de Gérard Gourguechon
De très larges extraits de l’article de Gérard Gourguechon (cité plus haut) sont publiés dans ce numéro Les Utopiques N° 29. Mais ce qui est publié induit peut-être une interprétation incomplète de son papier, voire une erreur possible. A la décharge de la rédaction, il faut reconnaitre que ce papier aurait fait à lui seul une bonne partie d’un numéro entier des Utopiques (32 pages !). Néanmoins, il aurait peut-être été utile de laisser au lecteur la possibilité de lire ce qui suit. En effet la situation du monde aujourd’hui, dit Gérard Gourguechon, « interroge notre hiérarchie des valeurs » :
« Notre syndicalisme se prononce pour le renforcement, partout et dans tous les domaines, de la démocratie, de la justice sociale et environnementale, pour l’extension des libertés, contre tous les racismes et toutes les stigmatisations de toutes les minorités, pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et, bien entendu, pour la paix et contre la guerre. Nous avons déjà été fortement impactés par les attaques de la Russie de Poutine à l’égard de la population ukrainienne, par les atrocités du 7 octobre 2023 puis par les massacres à Gaza et les violences en Cisjordanie. Déjà nous avons vu qu’il n’est pas suffisant de dire seulement que nous sommes « pour la paix et contre la guerre » et qu’il faut aussi rappeler que nous sommes, aussi et en même temps, pour la démocratie, pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Nous savons que dire seulement, en avril 2025, « il faut faire la paix en Ukraine immédiatement », ça serait, de fait, reconnaître le droit du plus fort à décider du sort des plus faibles. Alors il faudrait reconnaître que la démocratie et le droit des peuples, ça passe après. Le droit des peuples, ça doit être vrai pour la Nouvelle- Calédonie – Kanaky, pour les Palestiniens et Palestiniennes, pour les Israéliens et Israéliennes, et aussi pour l’Ukraine… et pour la Russie ou la Biélorussie, ce qui passe par le soutien aux syndicalistes et autres défenseurs des libertés de ces pays. Dire aujourd’hui que la Russie a un droit de regard sur ce qu’il se passe en Ukraine, ce serait admettre que tous les pays ne sont pas aussi « égaux » que d’autres, et admettre le droit à des impérialismes de se développer, d’avoir leur « glacis de sécurité », leur « sphère d’influence », leur « espace vital », etc. Ce serait, toujours, être complice du droit du plus fort, ce serait renier des valeurs pour ne pas risquer de déplaire au plus fort ».
Je partage cette analyse publiée en avril 2025. Il faut reconnaitre qu’elle a du mal à être appréhendée franchement dans le syndicalisme, ou au-delà.
L’extrait de la réflexion de Gérard Gourguechon publié dans Les Utopiques, commence par cette interrogation : « comment on est arrivé là ». Est décrite une rétrospective de l’évolution du capitalisme et de l‘impérialisme depuis longtemps mais surtout depuis l’ordre néolibéral des 40 dernières années. Il explique « que la finance est en train d’absorber la société et c’est elle qui fait société ». Ou encore : « Les énormes multinationales deviennent un Etat dans l’Etat, puis elles sont l’Etat » (pages 28 et 29). Mais à mon avis cette description, très juste, ne doit pas pour autant être interprétée comme si le trumpisme était mécaniquement l’aboutissement logique du néolibéralisme. Le néolibéralisme détruit les sociétés, cela ne fait aucun doute. Il crée un habitus, une accoutumance pour le retour des archaïsmes rétrogrades et aux pulsions de force brute : la fascisation rampante. Mais le néolibéralisme mondialisé conduit aussi à une crise du capital qui s’asphyxie à tourner sur lui-même, sans toujours trouver son compte de valeur qui se valorise sans cesse. Pour conquérir un surplus de valeur, au détriment des autres (ce qui est la règle capitaliste) cela conduit à une remise en cause des hiérarchies d’états, lesquels n’ont évidemment jamais disparu. Il y a une certaine rupture de continuité, un repli territorialisé et un retour à la violence déchainée. Il y a Milei, Trump, etc. « Les monstres sont lâchés » (Nada Cladera). C’est ce qu’explique la première partie du texte de Gérard Gourguechon. Le débat reste ouvert sur cette interprétation.
Les contributions des autres responsables syndicaux (Boris Plazzi du bureau confédéral CGT, chargé des relations internationales, et Caroline Chevé, secrétaire générale FSU) décrivent le monde trumpien en « reconfiguration » (CGT), mais pesant aussi sur « les capacités de mobilisation » (FSU). Boris Plazzi se prononce « pour une défense basée sur le multilatéralisme et indépendante de l’OTAN, dont on demande la dissolution ». Mais quel pays devrait participer au « multilatéralisme » ? Caroline Chevée demande « le retrait des troupes russes » d’Ukraine, et « face à la guerre génocidaire à Gaza », exige du gouvernement français des « sanctions contre Israël tant que cet état ne se conforme pas au droit international ». Dans le monde actuel, sanctions et confrontations sont proches.
Faut-il un nouveau service militaire ?
La question est provocatrice en France, depuis que Chirac a supprimé « le service », valorisé l’armée de métier et à l’heure où Macron annonce vouloir remobiliser la jeunesse, au moins un jour par an pendant la « Journée de défense et de citoyenneté » (JDC) très cocorico.
 Ci-contre :Hanna Perekhoda, historienne ukrainienne
Ci-contre :Hanna Perekhoda, historienne ukrainienne
Cette question est bien posée dans un article (page 156) des Utopiques N° 29, signé Patrice Le Tréhondat (syndiqué à Solidaires 75) et Patrick Sylberstein (éditeur de Syllepse), article issu d’une revue (« Adresses. Internationalisme et démocratie » N°11). Les auteurs prennent appui sur Friedrich Engels appelant à « familiariser le peuple tout entier au maniement des armes » (dans Antidühring-1878). Mais au-delà, ils citent abondamment une chercheuse et historienne ukrainienne (Université de Lausanne) : Hanna Perekhoda, spécialiste du nationalisme dans le cadre de l’histoire de l’Empire russe et de l’Union soviétique. Elle pose la question de savoir si lorsqu’on critique et déplore la militarisation, nous sommes en capacité de « proposer des solutions aux menaces très réelles auxquelles nous sommes tous confrontés ». Et si « nous avons un programme très concret pour faire face à cette crise ». Elle aussi critique l’austérité car « elle renforcerait rapidement les forces antidémocratiques », « ce qu’espèrent Trump et Poutine ». Pour autant, il ne faut pas, reprennent les deux auteurs, « laisser les droites dominer le débat ». Ils posent ainsi « les questions du droit syndical aux armées, la fin de l’armée de métier ou encore la mise en place d’une réelle instruction militaire citoyenne ». En Ukraine, un syndicat de militaires LGBTGIA+ existe déjà, et « une association de soldates lutte pour les droits des femmes militaires ».
Alors faut-il se mettre à « l’écoute de l’école militaire ukrainienne » ? La grande variété et les problèmes posés par les théâtres de guerre, notamment asymétriques, dans le monde (Hamas…) invitent à la prudence, mais pas à refuser le débat.
Le 27 juillet 2025.
Sommaire
6 DOSSIER / QUAND L’ÉCONOMIE DE GUERRE SERT LES PARTISANS DE L’AUSTÉRITÉ,
VERSION BRUTALE / Ophélie Gath
12 DOSSIER / UNE AUTRE ÉCONOMIE POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE / Boris Plazzi
18 DOSSIER / FACE À LA DÉSTABILISATION DU MONDE : OPPOSER LE VISAGE
DE LA SOLIDARITÉ / Caroline Chevé
22 DOSSIER / DE TERRES EN GUERRE / Les Soulèvements de la Terre
30 DOSSIER / LES MONSTRES SONT LÂCHÉS / Nara Cladera
34 DOSSIER / SUR LE FASCISME : RUSSIE, ÉTATS-UNIS, UKRAINE… / Brendan Chabannes
DOSSIER / TRUMP, MUSK ET VANCE : UNE NOUVELLE PHASE DU CAPITALISME ?
Gérard Gourguechon
6 4 DOSSIER / QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA SITUATION ACTUELLE / Verveine Angeli
7 2 DOSSIER / « POUR LA PAIX », COMME TOUT LE MONDE ? / Christian Mahieux
8 0 DOSSIER / QUAND IL EST DÉJÀ TROP TARD POUR ARRÊTER LA GUERRE / Ignacy Jozwiak
8 4 DOSSIER / UKRAINE : SYNDICALISME EN TEMPS DE GUERRE / Patrick Le Trehondat
9 2 DOSSIER / LES SYNDICATS ET LES TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES AMÉRICAIN·ES FACE À L’ATTAQUE SAUVAGE DE TRUMP / Dan La Botz
1 0 2 DOSSIER / DIX SYNDICATS NATIONAUX APPELLENT À LA RÉSISTANCE ANTI-TRUMP
Natascha Elena Uhlmann
1 0 8 DOSSIER / HOMMAGE À LA RÉSISTANCE DES FEMMES SOUDANAISES / Alaa Busat
| 1 1 4 | DOSSIER / PALESTINE : QUE FAIRE ? / Linda Sehili |
| 1 2 6 | DOSSIER / RETOUR EN SYRIE / Joseph Daher |
| 1 4 0 | DOSSIER / DES EXTRÊMES DROITES TRÈS INTERNATIONALES / Nara Cladera |
| 1 5 0 | DOSSIER / FEMMES DANS LES CONFLITS ARMÉS ET LUTTE POUR L’ÉGALITÉ
EN MATIÈRE D’ARMEMENT / Mathilde Larrère |
| 1 5 6 | DOSSIER / AUX ARMES CITOYENS, VALMY 2.0 / Patrick Le Trehondat, Patrick Silberstein |
| 1 6 6 | DOSSIER / L’OPPOSITION AU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL :
UN TERRAIN DE LUTTES SYNDICALES / Bérengère Basset |
| 1 7 4 | DOSSIER / UN LIVRET MILITAIRE POUR L’INDUSTRIE DE L’ARMEMENT ? |
| Nicolas Galepides | |
| 1 7 6 | DOSSIER / RECOLONISATION DU MONDE ET LOGIQUES IMPÉRIALISTES |
| Saïd Bouamama, Bernard Dréano | |
| 1 8 8 | DOSSIER / L’AZERBAÏDJAN, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN ? / Bernard Dréano |
| 1 9 8 | DOSSIER / « DE LA GUERRE FROIDE À LA GUERRE VERTE » |
| Nara Cladera, Anna Recalde Miranda | |
| 1 2 8 | DOSSIER / DANS UN MONDE EN GUERRES, PAS DE PAIX SANS JUSTICE, SOLIDARITÉS ALTERMONDIALISTES / ATTAC-France |