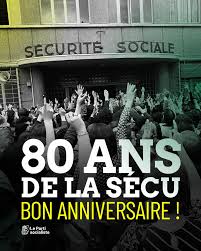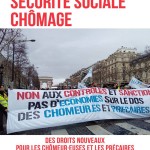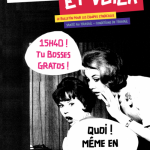En cette année 2025 des 80 ans de la Sécurité sociale historique (1945-46), il est bon de rappeler, comme le fait cette tribune initiée par la CGT, parue le 10 novembre dans le Nouvel Obs, que le financement par cotisation, qui est un salaire social, est celui qui donne un pouvoir immédiat sur la valeur économique créée par le travail dans le circuit capitaliste.
- Télécharger :Vive la cotisation sociale
En plein débat sur le financement de la Sécurité sociale, plusieurs économistes appellent, dans cette tribune initiée par la CGT, à fêter les 80 ans de la « Sécu » en défendant les cotisations sociales.
Notre Sécurité sociale, créée en 1945, à la sortie de l’ignominie de la Seconde Guerre mondiale, est la confluence du combat ouvrier et républicain. Depuis, nous cotisons en fonction de nos moyens pour en bénéficier selon nos besoins. Cette victoire collective, financée par le travail car lui seul crée la richesse, donc sur le salaire, permet à toutes et tous de bénéficier de la solidarité et d’échapper à la pauvreté.
La cotisation est du salaire. Les offensives contre cette partie socialisée du salaire commencent en distinguant artificiellement un brut « salarial » et « patronal » puis en cherchant à « alléger les charges », c’est-à-dire en fait à affaiblir les salaires en les exonérant des cotisations sociales. Derrière ce que certains appellent des charges pour demander à les alléger se trouve en réalité du salaire : en plus du salaire net pour le mois, le salaire brut pour les droits en cas de licenciement, accident, maladie, parentalité ou pour les retraites. D’où l’importance de connaître sa fiche de paie : chaque ligne a une signification. A travers les attaques contre les cotisations, c’est au salaire qu’on s’attaque, le brut aujourd’hui, le net demain.
Le salaire socialisé est la meilleure sécurité, avec des cotisations pour augmenter les protections et les pensions. La cotisation sociale, c’est aussi la carte Vitale quand d’autres préfèrent la carte bancaire pour faire leurs affaires. Lorsqu’on cotise à la Sécu, les frais de gestion sont de 3 %, le reste va dans les soins. Dans un monde d’assurances privées, tout sera fait pour couper sur les remboursements et conserver plus de 20 % de frais et de rendement aux actionnaires. C’est payer plus pour se faire soigner moins.
Le budget le moins endetté et le plus attaqué
Pour mieux attaquer la Sécu, on nous alarme en confondant les trois différents budgets :
Ceux de l’Etat et des collectivités territoriales, votés chaque année lors du projet de loi de Finances (PLF : recherche, écoles, justice…). Depuis 2017, l’endettement de l’Etat a augmenté de 1 000 milliards d’euros, en favorisant les grandes entreprises et les plus fortunés. Les collectivités territoriales sont faiblement endettées malgré d’énormes transferts de services publics non compensés par l’Etat, ce qui participe à leur dégradation.
Celui solide et solidaire de la Sécurité sociale a vu sa gestion principalement syndicale remplacée en 1967 par une gestion paritaire, et depuis son étatisation en 1996, il est voté par l’Assemblée nationale à travers le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). C’est le moins endetté et pourtant le plus attaqué. Au lieu d’élargir l’assiette des cotisations, c’est-à-dire soumettre à cotisations les revenus liés au travail comme l’intéressement, la participation, la PPV ou les dividendes, le financement de la Sécurité sociale passe des cotisations à l’impôt (CSG, CRDS et TVA), faisant payer aux salarié·es les cadeaux aux entreprises. Dans les années 1980, les cotisations finançaient 80 % de la protection sociale, c’est à peine la moitié aujourd’hui.
Des exonérations non compensées qui manquent à la protection sociale
S’ajoute le scandale des exonérations de cotisations sociales : plus les salaires sont bas et proches du smic, plus les exonérations de cotisations sont hautes. Les directions d’entreprises ont donc d’autant plus intérêt à maintenir des salaires faibles. Alors que les salaires ne sont pas indexés sur le smic et que la loi interdit même de le prévoir par accord collectif, ce qui permettrait au moins de ne pas perdre en niveau de vie, les exonérations de cotisation se retrouvent, elles, indexées sur le salaire minimum. L’empilement de dispositifs d’exonérations, concentrés entre le smic et le salaire médian, a compressé les salaires. Il faut sortir du cercle vicieux des exonérations de cotisations, qui incitent aux bas salaires, à la sous-traitance en cascade, au low-cost et participent à la désindustrialisation.
Si les exonérations sont majoritairement compensées par l’Etat, les près de 5 milliards qui ne le sont pas manquent à la protection sociale. La partie compensée, près de 80 milliards parmi les 211 milliards d’euros annuels d’aides publiques aux entreprises, constitue en fait une prise en charge par l’Etat d’une part des salaires du privé à la place de l’employeur (près du tiers pour les salaires au niveau du smic). C’est autant d’argent en moins pour les services publics qui sont dans une situation catastrophique. Et contrairement à ce qui est suggéré par la position qui consiste à les limiter au-delà d’un certain niveau de smic, ces exonérations sur les bas salaires n’ont pas été efficaces pour créer ni même sauvegarder des emplois.
Une société de progrès social et environnemental, qui répond aux défis d’avenir, est une société qui augmente la part du salaire socialisé dans son économie. Fêtons les 80 ans de conquête moderne qu’est la Sécurité sociale en défendant les cotisations. Pour défendre la cohésion sociale, ces choix démocratiques doivent être portés dans le débat public.
Premiers signataires :
Agathe Le Berder, direction confédérale de la CGT en charge des salaires ; Thomas Vacheron, direction confédérale de la CGT en charge des salaires ; Philippe Batifoulier, professeur à l’université Sorbonne-Paris-Nord ; Clément Carbonnier, professeur à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ; Maxime Combes, économiste à l’Observatoire des multinationales ; Nicolas Da Silva, maître de conférences à l’université Sorbonne-Paris-Nord ; Anne-Laure Delatte, directeur de recherche CNRS à l’université Paris-Dauphine-PSL ; Jean-Paul Domin, professeur à l’université de Reims-Champagne-Ardennes ; Victor Duchesne, maître de conférences à l’université Sorbonne-Paris-Nord ; Ariane Ghirardello, maîtresse de conférences à l’université Sorbonne-Paris-Nord ; Sabina Issehnane, maîtresse de conférences à l’université Paris-Cité ; Coralie Perez, ingénieur de recherche à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ; Corinne Perraudin, maîtresse de conférences à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ; Emmanuelle Puissant, maîtresse de conférences à l’université Grenoble-Alpes ; Muriel Pucci, présidente du comité scientifique du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; Gilles Raveaud, maître de conférences en économie, université Paris-8 Saint-Denis ; Henri Sterdyniak, économiste, Les Economistes atterrés ; Julie Valentin, maîtresse de conférences à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.