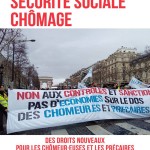Stéphen Bouquin est décédé le 21 janvier 2025, très tôt dans sa vie. Il avait fondé et animait la revue Les Mondes du travail. J’en avais republié des articles qu’il m’avait suggérés ou avec son autorisation. Il m’avait enseigné des méthodes de pratique sociologique alors que, étant salarié, je refaisais quelques études à l’Université Paris 8. Son travail a été immense. Il était d’une exigence forçant l’admiration lorsqu’il étudiait une lutte, quelque part dans le monde, ou encore des syndicalistes à l’oeuvre, ou des travailleurs et travailleuses en résistance, en action, et façonnant ainsi « la classe » pour elle-même et son auto-émancipation. Je l’avais soutenu et un peu aidé pour une prise de position publique de syndicalistes et d’autres « personnalités », au moment de la lutte des travailleurs-euses de Renault Vilvorde (actions coordonnées en Belgique et en France), au tout début du gouvernement Jospin en 1997, lequel cédait déjà aux exigences brutales de l’Europe néolibérale. Stephen nous a apporté des convictions fortes, des manières d’écrire et d’agir exigeantes et rigoureuses.
Jean-Claude Mamet.
Articles des Mondes du travail publiés dans Syndicollectif :
- Sur le mouvement social 2019-2020 en France : http://syndicollectif.fr/?p=11768
- sur le travail et la pandémie COVID 19 : http://syndicollectif.fr/?p=16076
- Sur la mobilisation de 2023 en France (un dossier) : http://syndicollectif.fr/?p=22231
- Présentation : « Les Mondes du Travail « est une revue éditée par l’association du même nom. Elle développe une orientation critique à l’égard des réalités contemporaines du travail, en lien avec le hors-travail et la structuration sociale en général.
Les Mondes du Travail est une revue interdisciplinaire et s’adresse autant au monde de la recherche et de l’enseignement qu’à celui des acteurs sociaux« . - Coordination de la rédaction : Sophie Béroud, Jérôme Pélisse, Stephen Bouquin
Ci-dessous, dans Contretemps (en ligne) l’accès à l’hommage rendu par Alexander Neumann, professeur à Paris-8. Notamment des extraits sur son approche syndicale.

Stephen Bouquin (1968-2025) : une œuvre en forme de peinture moderne
Il fait penser en cela à Ernest Mandel, qui a grandi comme lui à Anvers et qui est aussi mort à Bruxelles, ou encore à Pierre Naville qui a donné son nom à un centre de recherche un temps dirigé par Stephen Bouquin.
[…].
Il était professeur en sociologie, mais se présentait comme historien de formation, sociologue de métier et scientifique militant. Lors de sa soutenance de thèse de science politique à Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis, certains professeurs avaient comparé ses recherches (sur les résistances ouvrières dans le secteur automobile) à un travail artisanal, exécuté par un solide compagnon[1]. Pareille caractérisation passe complètement à côté du sujet, celui de la résistance dans le travail industriel moderne, en même temps qu’elle rate le style intellectuel de Stephen.Dans sa thèse, Stephen n’a eu aucun mal à transposer cette problématique à l’industrie automobile française (après 1968) et à son patronat autoritaire. La limite de cette approche, qui a le mérite de nommer le travail ouvrier et surtout la résistance sociale, est qu’elle explore à peine l’organisation étatique et mondiale du marché, donc la division sociale du travail à une échelle globale. De son côté, Naville avait souligné dès les années 1960, que la rationalisation du travail et l’automatisation de la production mène à un « automatisme social », c’est à dire un alignement de toute la société sur ces normes de production, qui se poursuit à travers l’informatisation, les services, la formation et les administrations.
[…]
Stephen était suffisamment curieux et ouvert d’esprit pour voir que le modèle initial ne pouvait être actualisé sans problème, mais il pensait toujours que les noyaux militants de travailleurs syndiqués (selon le modèle des entreprises industrielles) pouvaient entrainer et politiser de larges secteurs de la société lors de mouvements sociaux plus amples. Cet effet existe certainement, mais ce modèle n’explique ni le rôle déclencheur du mouvement étudiant en 68, ni celui des sans-papiers, ni celui des travailleurs périphériques qui ont été au cœur du mouvement des Gilets jaunes. En saluant la récente « gilet-jaunisation » d’une partie du mouvement syndical, Stephen s’est peut être douté que cette expression décrit l’exact contraire du modèle originaire de Braverman (2). Le rapport entre le travail et la politique est un nœud de contradictions. La CGT ou le féminisme égalitaire peuvent en témoigner. La même réflexion concerne l’écologie, ou encore la « créolisation », ce concept d’Edouard Glissant, auteur issu du mouvement surréaliste, tout comme Naville.
Stephen, par connaissance, par conviction et par expérience familiale savait que le racisme est un poison mortel, et il abordait en cours le problème de la racialisation (dont il rendait le terme correctement à partir du débat anglophone) devant un public d’étudiant.e.s de banlieue, à Evry. Cependant, la créolisation, qui peut être vue comme l’opposé de la racialisation, est un processus culturel global, impliquant des formes de résistance qui se nouent au départ dans l’esclavage et les plantations, et non pas dans le travail industriel ou l’entreprise américaine. Stephen était intervenu aussi bien dans les mouvements kurdes, flamands, francophones, américains, et s’intéressait à tout ce qui agitait l’Afrique, la Russie et l’Asie.
Ces dernières années, nos discussions sociologiques s’étaient intensifiées, au vu de l’éclosion de nouvelles perspectives et de la déréliction d’anciennes certitudes. Il m’avait demandé d’écrire un article à quatre mains sur la relation du travail à l’écologie politique, pour sa revue Les mondes du travail – qui entend toujours partir de « la centralité du travail » comme son nom l’indique. L’échange a commencé autour d’un verre, s’est poursuivi par un cadavre exquis textuel (pour user d’une expression des surréalistes), dans un bel élan créatif, mais s’est heurté au fait que la revue attendait un format court. Stephen visait plutôt un livre, au fil des échanges, et pour finir nous avons publié deux bouts séparés, lui dans sa propre revue, et moi dans Contretemps[3]. Mis côte à côte, les deux textes peuvent encore se lire comme un dialogue.
En 2023, Stephen est revenu à son ancienne fac, Paris 8, pour discuter mon livre La révolution et nous[4] dans le cadre d’un séminaire intitulé « La révolution et vous ? ». L’échange était très amical et stimulant, il a montré encore une fois toute sa culture encyclopédique en déclinant la question posée à partir d’un éventail de sociologies critiques du 20e siècle. Il est apparu qu’il cherchait surtout à reconsidérer les manières de créer le « nous », le collectif, davantage qu’à explorer la dimension politique de la « révolution » (depuis 1789). Pourtant, la politique l’a animé depuis son enfance. Sa mère m’avait raconté un jour, de manière touchante, que le premier texte politique rédigé Stephen, alors écolier, était une lettre adressée au président François Mitterrand, pour lui demander de prendre au sérieux le risque d’une guerre nucléaire. Un intellectuel en état d’alerte, déjà, dont l’exigence critique reste présente.«
Le 21 janvier 2025.
Alexander Neumann est professeur à Paris 8.
Notes
[1] La thèse a été éditée sous forme de livre : La valse des écrous. Travail, capital et action collective dans l’industrie automobile, Paris, Syllepse, 2006.
[2] Harry Braverman, Travail et capitalisme monopoliste, Paris, Editions sociales, 2023.
[3] Stephen Bouquin. « Pour éviter le désastre : défendre le “ travail vivant ” et le bien commun », Les
Mondes du travail, 2023, n° 29, p. 23-38 ;
[4] Alexander Neumann, La révolution et nous. La théorie critique de 1789 à nos jours, Paris, La Brèche, 2022 (épuisé).