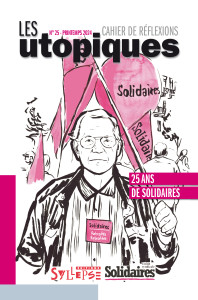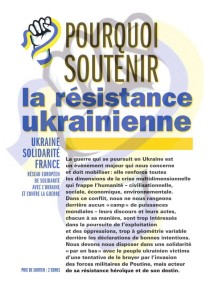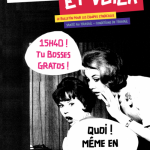Gérard Gourguechon, ancien porte-parole de l’Union syndicale Solidaires, publie cette contribution au débat sur l’attitude syndicale face « à la nouvelle phase du capitalisme » avec l’arrivée de Trump (and co) au pouvoir. Il prend à bras le corps le débat sur les dépenses militaires, la paix et le pacifisme, la solidarité avec l’Ukraine et les peuples opprimés. Une réflexion très complète, un peu longue, mais pertinente et nécessaire.
- Télécharger le document : Gérard G-Trump, Musk, Vance… 2025 04 18
Trump, Musk et Vance au pouvoir, une nouvelle phase du capitalisme ?
Sommaire :
- – Un bouleversement mondial et un désarroi de chacune et de chacun
- – La soudaineté et la brutalité de ce bouleversement déstabilisent nombre d’États.
- – Le renversement des alliances provoque de grands désarrois dans toutes les têtes.
- – Le syndicalisme doit débattre de cette nouvelle situation
- – Ceci va avoir des conséquences sur notre environnement économique et budgétaire
- – On va nous faire croire que cela percute nos nos revendications.
- – Ceci interroge notre hiérarchie des valeurs
- – Mettre des mots sur les choses
- – Donald Trump, ou la peur du déclassement.
- – Les États-Unis spoliés par le reste du monde
- – Le retour affiché de l’impérialisme territorial américain.
- – Un électorat Trumpiste majoritairement réactionnaire.
- – La liberté d’expression en exergue, en fait, la liberté des plus forts qui doit tout dominer
- – Des « libertariens » au pouvoir
- – La convergence des intérêts de la pétrochimie et des nouvelles technologies
- – Un gouvernement contre les sciences
- – La loi du plus riche et du plus fort contre la démocratie et contre les démocraties.
- – La prééminence du droit de propriété sur tous les autres droits dans les régimes capitalistes aboutit logiquement à la domination, in fine, des plus riches.
- – Quand le plus riche devient le plus fort
- – Le pouvoir personnel met aussi en cause les systèmes démocratiques.
- – La loi des plus forts contre les démocraties.
- – Comment on en arrive là.
- – Là où on en arrive, c’est à la domination illimitée de la 2- Le dépassement des lois antitrust.
- – La libéralisation de la finance avec Reagan
- – Les règles du financement des partis politiques
- – Les pouvoirs des fondations
- – L’extrême-droitisation progressive
- – En France aussi.
- – L’incapacité des gauches à faire vivre une alternative
- – Les gauches ont participé à la libéralisation de la finance
- – Les gauches n’ont ensuite plus de prises pour présenter et porter une politique alternative
- – Quels après possibles ?
- – Aux États-Unis, une résistance contre Trump anesthésiée.
- – Des lendemains imprévisibles où tout est possible
- – Et nous là-dedans ?
- – La lutte de classe continue
- – La Charte d’Amiens aussi.
I – Un bouleversement mondial et un désarroi de chacune et de chacun.
Depuis l’investiture de Trump le 20 janvier 2025, chaque jour qui passe nous montre que nous n’assistons pas seulement à l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir dans un pays « en plus », après la Hongrie, l’Italie, Israël, l’Argentine, etc. C’est l’extrême-droite au pouvoir dans le pays le plus riche de la planète, le plus armé, le plus dominant, avec son économie, ses multinationales, sa technologie, sa monnaie, etc. Nous voyons que ceci renforce partout les conservatismes réactionnaires et autoritaires et qu’à partir de cet impérialisme maintenant dans les mains de l’extrême-droite, c’est un nouvel élargissement des idées d’extrême-droite qui s’installe partout dans le monde. Et nous sentons que tout ceci va bien au-delà de ce que nous avions coutume d’appeler « l’extrême-droite ». Nous sommes aussi face à ce qui voudrait être une « révolution culturelle » mondiale mettant en cause les démocraties « classiques » et tout ce que nous pensions définitivement acquis nous venant du siècle des Lumières. Ceci dit, pour les peuples d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale par exemple, le fait que les États- Unis apparaissent comme un État ouvertement impérialiste et soutenant activement des régimes d’extrême droite n’est pas une nouveauté, loin de là.
- – La soudaineté et la brutalité de ce bouleversement déstabilisent nombre d’États. L’une des conséquences les plus visibles et les plus violentes, c’est le renversement des alliances avec, le 24 janvier 2025, les États-Unis qui votent à l’ONU aux côtés de la Corée du Nord, de la Russie, de la Chine, de la Biélorussie, du Nicaragua, et d’Israël contre un texte condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. C’est le Président de l’Ukraine humilié en direct devant les caméras du monde entier dans le « bureau ovale » de la Maison Blanche et qui, d’agressé devient le pays agresseur responsable de cette guerre déclenchée par l’invasion et l’occupation de son territoire ! À voir tout ceci, tous les pays anciens alliés des États-Unis et dont la sûreté militaire dépendait en très grande partie du « bouclier américain » s’affolent à juste La majorité des pays européens, dont une partie est très proche géographiquement de l’empire russe en reconstruction, prennent peur, se rapprochent, et décident de s’organiser indépendamment du « grand frère américain ». Le Canada, qui refuse de devenir le 51e état des États-Unis, se rapproche de l’Europe. L’Australie et le Japon s’interrogent sur ce que ferait Trump en cas de visées chinoises sur certaines zones de l’océan Pacifique.
- – Le renversement des alliances provoque de grands désarrois dans toutes les têtes. Celles et ceux qui voyaient dans Poutine l’héritier de la « grande Russie rouge » opposée à l’ogre capitaliste représenté par les USA (sans revenir ici sur ce qu’était vraiment ce qu’on nomma, mal, « le socialisme réel »), constatent que, désormais, la Russie et les USA, ça marche ensemble. Celles et ceux qui se tenaient au chaud aux côtés d’une des plus vieilles et des plus grandes « démocraties du monde » face aux méchants communistes, puis aux méchants russes, constatent que leur ami protecteur se dérobe. Celles et ceux qui choisissaient Moscou du fait de leur détestation du capitalisme américain impérialiste voient les États-Unis de Trump pactiser avec la Russie de Poutine : c’est à n’y rien comprendre, pour celles et ceux qui, s’affranchissant de toute analyse matérialiste, pensaient devoir choisir un camp parmi les États. Nous pourrions multiplier les exemples pour éclairer sur le désarroi qui s’installe dans les têtes. Les certitudes deviennent incertaines, et il faut tout interroger. Certes, ce n’est pas la première fois qu’une grande puissance impérialiste forge soudainement une alliance avec un adversaire de longue date. Nous avons l’antécédent du pacte Hitler-Staline de 1939 qui a vu l’alliance entre l’Allemagne nazie et la Russie stalinienne sur le dos de la En 1939/1940 aussi, ce basculement des alliances a conduit à des déstabilisations géopolitiques et à des désarrois individuels. Des gens de gauche l’ont soutenu au nom de l’opposition à l’impérialisme américain, d’autres l’ont dénoncé comme une trahison des principes du communisme. Aujourd’hui, des opposants à l’autodétermination de l’Ukraine sont rejoints par les Républicains d’extrême-droite.
II – Le syndicalisme doit débattre de cette nouvelle situation.
- – Ceci va avoir des conséquences sur notre environnement économique et budgétaire notamment. Très concrètement, ne serait-ce qu’avec l’instauration de nouveaux droits de douane entre pays où les marchandises et les services circulaient plus ou moins totalement librement, l’environnement économique va se trouver sensiblement modifié. Des entreprises installées en France et fortement exportatrices vont perdre des débouchés commerciaux, ce qui conduira à des problèmes d’emplois dans ces secteurs d’activité. Les importations consommées en France seront certainement, à terme, elles aussi taxées quand elles proviendront de pays « agressifs », ce qui conduira à une augmentation de leur coût pour les acheteurs et consommateurs en France, ou bien ces produits seront logiquement boycottés. En tout état de cause, ces nouvelles relations commerciales internationales vont modifier des habitudes de consommation et parfois des modes de production (quand il faudra se rendre « autonomes » par apport à certains pays fournisseurs). Partout, la concurrence commerciale va de plus en plus ressembler à une guerre commerciale. Et cette guerre commerciale va souvent se traduire par une volonté des gouvernants, partout au service du capital, de réduire encore les impôts qui peuvent toucher les entreprises au motif de rendre notre territoire attractif aux « investisseurs », et de supprimer les « normes » sociales, sanitaires, environnementales qui demeurent encore et qui ont pu résister à des décennies d’attaques du néo-libéralisme financier. Parallèlement, dans nombre de pays soudainement « abandonnés » par les États-Unis, le débat a déjà lieu sur l’opportunité d’augmenter les dépenses affectées au budget de la défense et, en cascade, le débat sur la façon de financer ces dépenses supplémentaires. Déjà Emmanuel Macron, lors de son allocution télévisée prononcée le mercredi 5 mars 2025 à 20 heures, donnait le ton : « Nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables, sans que les impôts soient augmentés. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage ». Il nous confirme que, pendant la guerre, la lutte de classe continue et qu’il est toujours le président des riches, notamment des multinationales de l’armement dont les actions explosent déjà. Tout ceci montre que ce nouvel environnement va bouleverser, au minimum, la vie économique et sociale du salariat.
- – On va nous faire croire que cela percute nos revendications. Nous le savons, et nous avons encore pu le constater lors de la crise financière de 2007/2008, le capitalisme cherche toujours à faire payer le financement de ses crises par les apporteurs de travail sans jamais remettre en cause les profits du capital. Après la crise financière de 2008, la dette privée des banques qui avaient spéculé pendant des années sur des produits toxiques a été transformée en endettement public des États et a été finalement mise à la charge des contribuables, ce qui a le plus souvent épargné ces banques et les plus riches de la planète qui parviennent facilement à « éviter l’impôt » par leur recours, notamment, aux paradis fiscaux et aux législations fiscales favorables. Les tensions géopolitiques nouvelles vont entraîner des coûts budgétaires supplémentaires importants, et les gouvernants au service des intérêts du capital vont chercher à profiter de cette situation pour encore maximiser les profits et faire supporter les coûts supplémentaires par les couches populaires et les classes moyennes. De nouvelles tensions sociales sont donc à craindre, avec de nouvelles attaques sur les conditions de travail, sur la durée du travail, sur le niveau des salaires et des retraites, sur le financement de la sécurité sociale, sur ce qu’il reste des services publics, sur les régulations encore en place qui viennent un peu contraindre les investissements. Gilbert Cette, le président du Conseil d’Orientation des Retraites (COR), choisit récemment par Macron, a bien compris la voix de son maître en déclarant que les choix budgétaires nouveaux qui vont s’imposer à la France nous obligent à travailler plus, c’est-à-dire qu’il faut encore reculer l’âge de départ en retraite et mettre fin aux 35 heures. Demain, on nous dira qu’il est indécent de mettre en avant des revendications sociales « alors que le pays est en guerre » !
- – Ceci interroge notre hiérarchie des valeurs. Notre syndicalisme se prononce pour le renforcement, partout et dans tous les domaines, de la démocratie, de la justice sociale et environnementale, pour l’extension des libertés, contre tous les racismes et toutes les stigmatisations de toutes les minorités, pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et, bien entendu, pour la paix et contre la Nous avons déjà été fortement impactés par les attaques de la Russie de Poutine à l’égard de la population ukrainienne, par les atrocités du 7 octobre 2023 puis par les massacres à Gaza et les violences en Cisjordanie. Déjà nous avons vu qu’il n’est pas suffisant de dire seulement que nous sommes « pour la paix et contre la guerre » et qu’il faut aussi rappeler que nous sommes, aussi et en même temps, pour la démocratie, pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Nous savons que dire seulement, en avril 2025, « il faut faire la paix en Ukraine immédiatement », ça serait, de fait, reconnaître le droit du plus fort à décider du sort des plus faibles. Alors il faudrait reconnaître que la démocratie et le droit des peuples, ça passe après. Le droit des peuples, ça doit être vrai pour la Nouvelle- Calédonie – Kanaky, pour les Palestiniens et Palestiniennes, pour les Israéliens et Israéliennes, et aussi pour l’Ukraine… et pour la Russie ou la Biélorussie, ce qui passe par le soutien aux syndicalistes et autres défenseurs des libertés de ces pays. Dire aujourd’hui que la Russie a un droit de regard sur ce qu’il se passe en Ukraine, ce serait admettre que tous les pays ne sont pas aussi « égaux » que d’autres, et admettre le droit à des impérialismes de se développer, d’avoir leur « glacis de sécurité », leur « sphère d’influence », leur « espace vital », etc. Ce serait, toujours, être complice du droit du plus fort, ce serait renier des valeurs pour ne pas risquer de déplaire au plus fort. De même, justifier l’agression russe en Ukraine en rappelant qu’au cours de son histoire, l’Ukraine a été réunie à la Grande Russie, ce serait partager l’idée que la France veuille « récupérer » l’Algérie au motif que l’Algérie a été française. Avec le retrait des États-Unis de « L’Alliance Atlantique », les questions que nous devons nous poser atteignent un cran supplémentaire. Il ne s’agit plus seulement de savoir si la France doit aider militairement l’Ukraine pour qu’elle réponde à l’agression qui lui est faite et pour que le droit de l’agresseur ne triomphe pas. Désormais, il s’agit de savoir si notre pays doit se donner les moyens, pour aujourd’hui et pour demain, de se défendre contre un éventuel agresseur. Le droit du peuple français à disposer de lui-même, ça veut peut-être dire que le peuple français doit être maître de sa défense, laquelle ne peut reposer sur l’espoir qu’il ne sera jamais agressé, ou sur l’espérance, qu’en cas d’agression, il sera secouru par un autre puissant pays. Le pacifisme, ça ne peut pas être la complaisance à l’égard de la force, voire la soumission au plus fort. Cette nouvelle situation nous oblige aussi à penser autrement à la question du nucléaire et à celle de l’armement ; mais aussi à relancer des débats autour de la notion de « défense collective », sur ce que ça signifie lorsqu’on comprend celle-ci comme la défense du peuple, pas celle « de la Nation » abstraite, mythifiée, et aux mains de nos adversaires de classe. Tout ceci se complique, d’où la nécessité d’en débattre syndicalement.
En faisant ceci, en menant cette réflexion, collectivement, au sein de notre organisation syndicale, nous ne faisons pas de la politique au sens « politique partidaire ». Nous ne nous mettons pas sur la position d’un tel ou d’une telle, de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, de François Ruffin, de Marine Tondelier ou d’Emmanuel Macron. Nous essayons d’avoir notre propre positionnement, après débats démocratiques, sur des questions essentielles qui nous concernent et vont nous concerner en tant que classe sociale, ce qui est le rôle du syndicalisme. C’est essayer de pratiquer un syndicalisme indépendant et autonome.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ENCART – Pour essayer de s’y retrouver dans ce que nous pouvons croire comme des oppositions entre nos valeurs, en l’occurrence ici, notre rejet de la guerre, notre opposition à la violence (encore que, dans les rapports sociaux, nous savons qu’il faut un « rapport de force »), voire un attrait pour un certain pacifisme, et notre aspiration à la justice, aux libertés individuelles, au droit des peuples à décider de leur avenir, nous pouvons relire ce qu’écrivait Blaise Pascal, vers 1660 : « Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu’il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force et pour cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste. La justice est sujette à dispute. La force est très reconnaissable et sans dispute. Ainsi, on n’a pu donner la force à la justice, parce que la force a contredit la justice et a dit qu’elle était injuste et a dit que c’était elle qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste soit fort, on a fait que ce qui est fort fût juste ». Ça veut certainement dire qu’aujourd’hui, une paix injuste imposée à l’Ukraine du fait du rapport de force où domine l’agresseur, par ailleurs fortement aidé par de nouveaux complices, ça ne serait pas la paix, ça serait incompatible avec l’idée de pacifisme, ça serait une suspension momentanée de l’état de guerre maintenant des rancunes et des humiliations annonciatrices de prochains conflits. Blaise Pascal précise : « Ne pouvant faire qu’il soit force d’obéir à la justice, on a fait qu’il soit juste d’obéir à la force. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force, afin que la justice et la force fussent ensemble et que la paix fût, qui est le souverain bien ». C’est bien là où nous en sommes : pour avoir « la paix », il faudrait justifier la force, lui donner « raison », et tant pis pour la justice qui passerait à la trappe.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
- – Mettre des mots sur les choses. Essayer de débattre de ces questions, ce n’est pas facile, notamment dans une organisation syndicale, où ce n’est pas le genre de débat qui est le plus habituel. Mais la difficulté du débat ne nous autorise pas à nous en soustraire. Ce sont des questions que se posent nos adhérentes et nos adhérents, ce sont des interrogations légitimes qui peuvent être source d’angoisse. Dans un tel cas, le moins mal, c’est de prendre en charge collectivement cette Nous savons qu’en mettant des mots sur les choses, celles- ci perdent de leur puissance dévastatrice. Il nous faut éviter les « explications » qui n’en seraient pas, et, surtout, qui ne règleraient rien, du genre « ce sont tous des cinglés », ou « ils vont finir par se tirer dessus entre eux ». Dire que ce sont « tous des cinglés » ça ne règle rien, et ça complique même les choses si on imagine que la dissuasion nucléaire est aux mains de cinglés. Pour que la dissuasion dissuade, il faut que ça se fasse entre des personnes rationnelles.
Au contraire, il nous faut essayer de comprendre et de caractériser la période qui s’est ouverte avec cette survenue brutale et qui déstabilise déjà nombre de pays et de régions sur les cinq continents. Quand on ne sait pas, quand on est perdu, en parler avec d’autres est déjà une aide. Le syndicat peut être cet outil que nous avons collectivement pour nous aider à comprendre.
Pour essayer de faire vivre la réflexion, on peut interroger cette nouvelle situation en l’abordant par plusieurs approches.
III – Donald Trump, ou la peur du déclassement.
- – Les États-Unis spoliés par le reste du monde. Un fil directeur semble avoir conduit Donald Trump durant toute sa campagne électorale et lui a permis de gagner1, parvenant à convaincre nombre d’électeurs et d’électrices : celui de la crainte de la perte de l’hégémonie des États- Unis sur le monde, laquelle hégémonie se répercute ensuite sur le niveau de vie de chaque citoyenne et de chaque citoyen des USA. Le slogan Make America Great Again (MAGA) (qui pourrait aussi être traduit « USA über alles ») a été compris comme le discours populiste d’une promesse de retour à un âge d’or passé et mythifié. C’est donc aussi, peut-être, la mesure de la peur d’une puissance ayant le sentiment d’être en perte de vitesse, estimant que, pendant des décennies, trop d’autres pays ont vécu et prospéré comme des sangsues au détriment des USA. C’est sur cette base que l’extrême droite réussit à prospérer dans bien d’autres pays dans le monde, y compris en France (avec le discours sur « les étrangers qui viennent bénéficier des droits sociaux en France », etc.). Trump n’a cessé de répéter qu’il fallait que cette situation qu’il dit réelle, maintenant, c’est terminé. Il y a dans cette aspiration une volonté de retrouver une totale indépendance financière, alors que le pays, vu du reste de la planète, paraît plutôt bien installé, particulièrement du fait de la prééminence du dollar comme première monnaie internationale. Cette aspiration va avoir des conséquences très dures sur les choix budgétaires : il faut continuer de baisser les impôts et continuer de maîtriser le déficit budgétaire par une baisse plus importante des dépenses publiques. Il faut réduire la dette publique et en réduire le coût car le financement étranger de ce déficit rend les USA dépendants de l’épargne étrangère : si les Chinois, les Japonais et les Britanniques, les trois premiers créanciers de la dette publique américaine, décidaient de placer leur épargne ailleurs, ce serait dangereux pour les Il faut donc que le dollar continue d’être la première monnaie mondiale.
La mentalité d’assiégés portée par les MAGA les conduit aussi à vouloir réduire également toute forme de dépendance commerciale. Chaque dollar d’importation est considéré comme un dollar perdu, il faut donc produire plus aux USA, importer de moins en moins et exporter de plus en plus. Chaque importation est vue comme une subvention payée à l’étranger qui conduit en plus à une diminution d’emplois dans le pays. Les menaces lancées par Trump sur presque tout le reste du monde avec son recours à des droits de douane servent à « rééquilibrer » les déficits commerciaux actuels. Par contre, s’ils entrent effectivement en application, ceci aura un effet inflationniste important sur les prix pour les consommateurs à l’intérieur des USA, ce qui rendra la vie au quotidien difficile pour nombre de citoyennes et de citoyens, dont probablement nombre d’électeurs et d’électrices de Trump.
- – Le retour affiché de l’impérialisme territorial américain. C’est certainement sous cet angle « économiste » qu’il faut comprendre la politique impérialiste et d’accaparement exprimée par Trump à l’égard des richesses minières du Canada, du Groenland et même de l’Ukraine qui serait ainsi « taxée » pour rembourser ce que les USA viennent de lui envoyer pour mener « sa guerre » contre Poutine. La conséquence, c’est aussi la volonté d’exclure la Chine du canal de Panama : s’approprier de nouvelles terres, de nouveaux territoires, un nouvel « espace vital » considéré comme indispensable par cette politique visant à maintenir et renforcer la domination des USA et la prospérité des Américains. Pour annoncer que « L’Amérique allait retrouver sa grandeur », Donald Trump, plusieurs fois, a fait référence à l’un de ses prédécesseurs, le Président McKinley, président de 1897 à 1901. C’est avec lui que l’impérialisme territorial américain s’est exprimé ouvertement. Mais cet expansionnisme avait commencé dès le début de « l’histoire américaine », avec la « conquête de l’Ouest » et le massacre de 95% de la population autochtone. En 1867, les États-Unis achètent l’Alaska à la Russie. Puis l’expansionnisme se fait dans deux directions, dans le Pacifique (Midway, puis Pearl Harbor, puis la totalité de Hawaï en 1898, et aussi une partie des Samoa, et encore l’île de Guam puis l’ensemble des Mariannes) et vers l’Amérique centrale et les Caraïbes. La guerre hispano-américaine menée en 1898 par McKinley va marquer le renforcement de cet expansionnisme américain. À l’issue de cette guerre, l’Espagne cède aux États-Unis : Porto Rico dans les Antilles et les Philippines à l’est de la Mer de Chine méridionale, cependant que Cuba est sous la protection des États-Unis et que le Panama est placé sous contrôle des États-Unis. Les similitudes avec l’époque actuelle sont multiples. Déjà, il y avait une grande connivence et une grande convergence d’intérêts entre les milieux d’affaires et la présidence. Des entreprises et des fortunes colossales se bâtissent au cours du dernier quart du XIXe siècle, pendant que les États-Unis sont en train de devenir la première puissance industrielle : dans le pétrole (Rockefeller), l’acier (Carnegie), les chemins de fer (Vanderbilt, Morgan), la banque (Morgan), l’électricité (Edison). McKinley est plus particulièrement lié au potentat du charbon, du fer et de l’acier Marcus Hanna. McKinley ne va pas faire appliquer la loi antitrust pourtant votée en 1890 et qui est allègrement contournée par les industriels qui constituent des holdings. McKinley, c’est aussi un renforcement du protectionnisme, avec l’augmentation des « tariffs », des droits de douane, qui iront jusqu’à représenter plus de 40% des recettes de l’État fédéral. Tout ceci ressemble à une partie de ce que nous voyons se développer en ce début d’année 2025 aux États-Unis.
IV– Un électorat trumpiste majoritairement réactionnaire.
Malgré son comportement individuel fort peu « exemplaire », Trump a su attirer vers lui les votes d’une grande majorité des évangéliques. Les évangéliques représentent plus de 30% de l’électorat aux États-Unis et constituent la principale base politique de Donald Trump. Les évangéliques sont des protestants qui se distinguent des églises protestantes historiques (calvinistes et luthériennes) dans leur rapport à la Bible dont ils font une interprétation plus littérale. C’est ainsi que certains groupes évangéliques rejettent les théories de l’évolution et estiment que la terre a été créée il y a quelques dizaines de milliers d’années, comme il est écrit dans l’Ancien testament. Aujourd’hui, ils et elles seraient environ 92 millions aux États- Unis sur une population totale de 310 millions d’habitants (source : Center for the Study of Global Christianity). Plus de 70% d’entre eux et elles sont des blanc⸳hes, et sont souvent très pratiquant⸳es. Lors des dernières élections qui ont porté Trump au pouvoir, 81% des évangéliques blanc⸳hes qui ont voté ont voté pour Trump. Ils et elles ont voté pour son programme : l’opposition à l’avortement, le maintien de signes religieux chrétiens dans l’espace public, la défense de la famille traditionnelle, la lutte contre les droits des personnes homosexuelles et une hostilité dirigée contre les personnes transgenres. Donald Trump et certains pasteurs ou certaines communautés évangéliques ont par ailleurs un point commun : leurs rapports à la raison, à la science, aux faits reconnus sont souvent très problématiques. Par ailleurs, quand, le 24 juin 2022, la Cour suprême mettait fin à l’arrêt Roe Vs Wade de 1973 qui garantissait le droit d’avorter sur tout le territoire, chaque État devenait libre d’interdire ou d’autoriser l’I.V.G. Et ceci a été possible car Trump avait nommé des juges très conservateurs, comme Madame Amy Barret, à la Cour suprême. Cette révocation a accéléré l’enthousiasme des évangéliques dans leur soutien à Trump. La religiosité des États-Unis est encore très importante et pèse beaucoup lors des élections politiques. Le monde catholique a ses intégrismes particulièrement intransigeants qui veulent imposer leur mode de vie à toute la société. Le monde protestant aussi, et d’autres religions également. Le respect du droit à la religion n’interdit pas de dénoncer les obscurantismes, et cela pour toutes les régions du monde.
V – La liberté d’expression en exergue, en fait, la liberté des plus forts qui doit tout dominer.
Avec l’extrême médiatisation de Trump, nous sommes nombreux et nombreuses à avoir découvert une nouvelle façon de mentir « franchement » à tout le monde. Nous savions déjà
« qu’on ne nous dit pas tout », voire que des gouvernements nous mentent. Mais la façon dont procèdent ces idéologues « nouveau style », là, c’est au-delà de tout. Les fausses nouvelles sont des opinions aussi valables que les vérités avérées. Aux États-Unis, depuis les années 1970, la Cour suprême défend une conception très large de la liberté d’expression. C’est aujourd’hui une jurisprudence qui permet aux réseaux sociaux d’Elon Musk ou de Mark Zuckerberg de diffuser massivement des informations non vérifiées, voire délibérément fausses.
Pour s’autoriser de telles entorses, les partisans du mensonge organisé disent se rattacher aux « Pères fondateurs » des USA et aux valeurs fondamentales qui ont fait « l’Amérique ». La Constitution américaine, toujours en vigueur aujourd’hui, a été adoptée le 17 septembre 1787 et est entrée en vigueur le 4 mars 1789. Elle a été amendée à plusieurs reprises, notamment par le Premier Amendement adopté le 15 décembre 1791. Quelques lignes du premier amendement de la Constitution des États-Unis disposent que « le Congrès n’adoptera aucune loi (…) pour limiter la liberté d’expression ». Depuis 1791, ces lignes garantissent cette liberté fondamentale, avec la liberté de religion, la liberté de la presse, la liberté de réunion et le droit d’adresser des pétitions au gouvernement. Aux temps des absolutismes politiques et religieux, ces garanties faisaient de cette jeune République l’une des plus libres au monde (on sait que c’est le Deuxième Amendement, adopté le 15 décembre 1791, qui édicte : « le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé »).
Cette liberté d’expression, constitutive de l’identité américaine, est devenue un enjeu important où se mêlent idéologie, intérêts économiques, manipulations, remise en cause de médias traditionnels et forte poussée de la désinformation. C’est en s’appuyant sur leur interprétation de cet amendement qu’Elon Musk pour X (anciennement Twitter) et Mark Zuckerberg pour Meta (Facebook et Instagram), et aussi le Parti Républicain, se posent en défenseurs intraitables de la liberté d’expression et en pourfendeurs des « censures ». Dès 2022, en s’emparant de Twitter, Elon Musk se présentait comme un « absolutiste de la liberté d’expression ». C’est le « free speech ». « Normalement », l’incitation à la violence, l’incitation à commettre des actes illégaux, l’obscénité, etc., ne sont pas protégées par la Constitution, la liberté d’expression devrait donc, au moins, connaître ces limites. Nous voyons que, pour le moment, il n’y a pas de limites. Pendant des semaines et des mois, Trump a multiplié les mensonges, les fausses nouvelles (en français, les Fake News) en manipulant ouvertement les électeurs, les électrices et les opinions publiques.
C’est avec ce regard que ces personnes mettent aujourd’hui en cause les démocraties en Europe et ailleurs du fait des limites que ces pays veulent imposer aux réseaux sociaux et aux plateformes. Il faudrait approfondir la réflexion car il est possible que la réalité soit plus prosaïque : les propriétaires de X, de Facebook, d’Instagram, etc. et de toutes les plateformes numériques savent qu’ils ont entre leurs mains, pas seulement des outils de communication, mais des technologies qui remodèlent activement la façon dont nous percevons et interprétons la réalité. En étant à la tête d’instruments utilisés du pôle Nord au pôle Sud, sur les cinq continents et sur tous les océans, ils ont un pouvoir énorme sur ce qui entre dans l’esprit de milliards de personnes. Ils veulent disposer de ce pouvoir sans limites. Les possibilités d’un quelconque contrôle étatique sont donc à proscrire, tout comme la moindre volonté de régulation. Et, pour ce faire, l’amendement américain sur la liberté d’expression est bien utile. Et nous verrons plus loin que ce désir affiché d’une totale liberté d’expression n’empêche pas les mêmes d’interdire certains mots comme « femmes », « climat », etc. Par ailleurs, les mêmes ne semblent pas trop se soucier de liberté d’expression dès lors qu’il s’agit de réprimer des syndicalistes, des féministes, des écologistes, des minorités, … Derrière les mots, il y a toujours la lutte des classes !
Nous voyons que, pour vivre ensemble, il faut essayer de maintenir un « équilibre » entre différentes valeurs. C’est normalement le cadre que s’est donné la France avec sa triade Liberté Egalité Fraternité. Pour que « ça marche », il faut parvenir à un « équilibre » entre les trois, sans donner la suprématie à l’une seule des valeurs. C’est ensuite, toujours « normalement », au débat démocratique de trouver le point de convergence à un moment donné.
VI – Des « libertariens » au pouvoir.
La primauté absolue donnée à la liberté d’expression, liberté contre laquelle ne peut être mise en place aucune restriction, est un principe qui se retrouve dans la philosophie politique dite du libertarisme, un monde contre lequel nous allons probablement devoirnous confronter et combattre et qui n’a absolument rien à voir avec le monde libertaire. Il nous faut bien comprendre que les mots utilisés le seront pour faire le contraire de ce qu’ils veulent dire (semblent vouloir dire ?). C’est toujours difficile à supporter, et pourtant, nous avons déjà été mis à l’épreuve. Nous savons donc que le sens des mots peut être dévoyé. Nous avons déjà vu que l’idée de « communisme » n’avait rien à voir avec le communisme « réellement existant » du temps de Staline. Nous avons vite constaté que le « socialisme » qui clamait vouloir
« changer la vie » en France, a rapidement « changé d’avis » et s’est plié, avec d’autres, aux injonctions du capitalisme « réellement existant ». En novembre 2016, quand Macron a publié son livre « Révolution, notre combat pour la France », nous savions, sans le lire, que nous n’allions pas, avec son panache blanc, vers une nouvelle prise de la Bastille. Et quand il a multiplié les « réformes », nous savions qu’il n’était pas un réformateur mais un réactionnaire.
Et il y a longtemps que nous subissions « le libéralisme » qui donne une image positive au capitalisme. C’est pareil avec les « libertariens », ça n’a rien à voir avec les libertés, c’est simplement la loi du plus fort, la loi du plus fort qui tue la liberté de tous les autres. Les libertariens sont des liberticidiens !
Historiquement, c’est un peu le prolongement du « libéralisme » classique de John Locke (1632-1704) projetant la logique du marché dans toutes les sphères de la vie sociale et faisant de la défense des libertés une lutte incessante contre l’État. Les « libertariens » prônent une idéologie du laissez-faire et s’opposent à l’impôt, à l’interventionnisme économique, aux services publics. La souveraineté individuelle devrait conduire à un État réduit à sa forme minimale, voire à un non-État. La Constitution américaine du 17 septembre 1781 reflète cet esprit en limitant le rôle de l’État à certaines fonctions : légiférer, interpréter les lois et défendre la nation. On notera qu’en réalité l’État ne disparait pas du tout : il concentre ce qui peut imposer « la bonne marche » de la société : lois, police, armée … ce que nous avons connu et connaissons dans les dictatures. Le « libertarisme » américain trouve ses bases dans les années 1770-1840, avec notamment un Parti républicain anti-fédéraliste, anti-étatiste, isolationniste et ardent défenseur des libertés individuelles, qu’il faut comprendre comme la liberté des plus forts de dominer les plus faibles. Plus récemment, Friedrich Hayek (1889- 1992), de l’école d’économie autrichienne, a relancé cette idéologie en affirmant que la figure de l’entrepreneur constitue la véritable force motrice de l’économie, c’est-à-dire la seule vérité utile. Ces concepts se retrouvent maintenant dans les principes qui animent la Silicon Valley, où l’on glorifie les dirigeants-créateurs et la liberté d’entreprendre. La romancière Ayn Rand (1905-1982) a écrit deux best-sellers, presqu’aussi lus que la bible aux USA, livres où elle prône un « égoïsme rationnel » rejetant toute forme de coercition. Alan Greespan, ancien président de la Réserve fédérale des États-Unis, était un adepte des théories d’Ayn Rand. Pendant un temps, les partisans du Tea Party ont redonné de la visibilité aux thèses dites libertariennes. Murray Rothbard (1926-1995) est encore plus radical : pour lui, l’État doit être totalement aboli et ses fonctions confiées au marché puisque la propriété est le fondement de tous les droits. Il est certain qu’avec une telle vision du monde, les règles démocratiques (un homme, une femme, une voix) sont mises au placard : la règle, c’est une action une voix, et le pouvoir est à celles et ceux qui sont les plus gros actionnaires, les plus riches, qui dominent les marchés. Toute intervention publique est condamnée, et les « parasites », c’est-à-dire les élus et les fonctionnaires, qui vivent aux dépens de la société sans produire ni échanger, doivent être supprimés. Toute obligation de protection collective doit être rejetée afin de préserver et responsabiliser l’individu. Ce sont là des discours que nous avons déjà entendus, et pas qu’aux États-Unis.
Aujourd’hui, ce courant politique est influent. Il se manifeste par des publications, des revues, des think tanks influents. Plusieurs milliardaires de la Silicon Valley adhèrent à ce courant idéologique alliant libertarisme et conservatisme américain. On y trouve le vice- président actuel JD Vance, 50e vice-président des États-Unis depuis le 20 janvier 2025. Il s’est fait élire une première fois sénateur républicain de l’Ohio en 2022. Durant son mandat, il s’est affiché néoréactionnaire, conservateur nationaliste radicalisé et d’extrême droite. Il a promu des politiques très conservatrices, notamment sur la famille. Il s’est opposé fortement à l’aide militaire américaine à l’Ukraine. Elon Musk relève aussi de ce courant de pensée. Il a été nommé à la tête d’un nouveau département de « l’efficacité gouvernementale » dès le 12 novembre 2024 dans le but de conseiller le gouvernement pour couper et « optimiser » les dépenses fédérales. Il a la charge de démanteler la bureaucratie gouvernementale et de réduire les réglementations « excessives » pour pallier « un gaspillage massif ». Le « Département de l’Efficacité Gouvernementale » (DOGE) dispose donc d’un pouvoir énorme de « conseil », sans faire partie du gouvernement fédéral, mais en travaillant avec la Maison Blanche et le Bureau de la gestion et du budget (c’est là que sont signés les décrets pris à la suite des conseils du DOGE). Sous couvert de « démanteler l’État inutile », il s’agit d’un outil bureaucratique mis en place … par l’État ! Sur ses conseils, des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses du secteur public ont déjà été viré⸳e.s et des institutions collectives ont été démantelées au profit d’une privatisation généralisée. Des luttes syndicales sont menées pour s’opposer et c’est de notre responsabilité de les soutenir, ce qui commence par les faire connaître, par exemple en relayant les informations du Réseau syndical international de solidarité et de luttes. Musk, selon ses biographes, s’est radicalisé progressivement jusqu’à devenir d’extrême droite, notamment par son complotisme, son virilisme, son racisme et son soutien à plusieurs partis d’extrême droite européens et ses liens avec des suprémacistes blancs. Il s’est engagé aux côtés de Donald Trump tant pour sa détestation du progressisme et des valeurs transmises par le « virus woke » que pour son opposition aux volontés régulatrices des progressistes quant aux nouvelles technologies. Peter Thiel, un autre milliardaire (avec Paypal et Linkedin, etc.) également « libertarien », a aussi une influence importante, étant un proche conseiller de Trump depuis 2016. Pour illustrer le personnage, on peut reprendre ce qu’il écrivait déjà dans un article publié en 2009 « L’Éducation d’un libertarien » où il expose ses idées politiques : « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles … la liberté humaine authentique est une condition sine qua non du bien absolu. De même, le capitalisme et la démocratie sont devenus incompatibles depuis que les femmes ont obtenu le droit de vote ». La liste des milliardaires « libertariens » influents et par ailleurs très importants donateurs lors de la campagne pour Donald Trump est conséquente. Tous ces fonds, toutes ces puissances financières, tous ces centres économiques et financiers pèsent aujourd’hui et contribuent à faire de ce genre de pensée une nouvelle norme. C’est la « droite tech » qui représente désormais un nouveau pouvoir politique particulièrement efficace. En septembre 2024, Peter Thiel déclarait : « Nous voyons décroître la capacité des États à réaliser de grandes choses. Mais nous ne parvenons pas à imaginer ce qui pourrait les remplacer. C’est ce qui m’intéresse dans le libertarisme : cette idée qu’on peut échapper à la politique ». Quand nous voyons de très riches particuliers avoir plus de moyens financiers que nombre d’États membres de l’ONU, quand nous constatons que les dirigeants politiques « des grands pays » courtisent les propriétaires de ces fortunes et ouvrent leurs pays à leurs richesses et à leurs désirs, nous pouvons nous dire que nous avançons tout doucement vers ce nouveau monde. Et tout s’éclaire : la liberté de circulation des capitaux et l’existence de territoires off-shore permettent aux plus riches d’échapper aux impôts et aux réglementations, et donc de devenir toujours de plus en plus riches, pendant que les États ne cessent de baisser les taxations de ces plus riches pour « attirer les investissements, etc. » et ne cessent donc de réduire leurs moyens d’agir. Ensuite, ces plus riches disposent de plus de moyens financiers que des États, lesquels se révèlent de plus en plus incapables de régler effectivement les problèmes qui se posent à leurs populations. Les « libertariens » interviennent alors pour asséner le coup de grâce. Toutes les réglementations, toutes les régulations sont des paperasseries, des bureaucraties qui entravent l’initiative créatrice des créateurs. Les Droits de l’Homme, les droits sociaux, tout ceci est à bannir comme autant de blocages imposés aux sociétés et qui viennent limiter la liberté individuelle. Déjà Hayek écrivait en 1960 : « Je préfèrerais sacrifier temporairement, provisoirement la démocratie plutôt que de me passer de la liberté ». Pour ces idéologues, la liberté, c’est uniquement la leur, celle des riches, des puissants, celle du renard libre dans le poulailler libre et celle du loup libre dans la bergerie libre.
L’historien canadien Quinn Slobodian sonne l’alerte dans son récent livre « Le Capitalisme de l’apocalypse ». L’ennemi, pour les très riches, c’est l’État-nation, créateur d’impôts et distributeur de subventions pour le peuple (les assistés). La solution, pour ces mêmes riches, c’est de faire sécession dans des résidences fermées, ou, mieux, des îles artificielles, ou des plateformes flottantes arrimées en haute-mer. Nous allons voir fleurir des villes privées régies par les entreprises de ces milliardaires, des zones économiques spéciales, des ports francs, des parcs d’affaires, des « Gaza-city » un peu partout, comme des Hongkong, des Singapour, des Dubaï où l’entre riches se cultive. Et si ça ne suffit pas, il est aussi prévu de faire pareil sur Mars, voire au-delà.
VII– La convergence des intérêts de la pétrochimie et des nouvelles technologies.
Nous savons qu’il y a des liens entre les évolutions technologiques, les principales découvertes, et l’évolution des rapports sociaux, l’évolution des sociétés humaines, l’évolution des rapports entre les groupes sociaux, les peuples, les nations, les États. Nous savons que l’époque des moulins à vent et des moulins à eau devait générer une société féodale. Et nous savons que le capitalisme de l’ère industrielle a connu plusieurs phases, avec la machine à vapeur, avec l’électricité, avec le fordisme, etc. Il est probable qu’avec l’arrivée de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler l’Intelligence Artificielle (IA), nous sommes entrés dans une nouvelle phase du développement capitaliste. L’IA, pour fonctionner, a certes besoin de matière grise immatérielle, ce qui conduit déjà à une concurrence accrue entre les principales universités au niveau mondial, et à des tensions entre groupes pour s’approprier des cerveaux convoités par les investisseurs qui spéculent sur des rendements financiers exponentiels.
Mais l’IA, pour tourner, a aussi besoin de beaucoup d’énergie, de beaucoup d’électricité pour alimenter des infrastructures énormes. Les secteurs de l’énergie s’enthousiasment de ce nouvel Eldorado. C’est ce qui explique le discours de Trump (« Forez, bébé, forez ») qui annonce une phase de relance de l’exploitation des gaz de schistes et des réserves pétrolières qui demeurent encore sur le vaste territoire des USA. Les entreprises de ces secteurs et leurs actionnaires sont eux aussi aux anges. Et pour que toutes ces entreprises tournent à plein régime, il ne faut pas être contraints et limités par des « normes » environnementales et des règlementations de tous ordres qui sont présentées comme autant de bureaucratie néfaste, de paperasserie inutile qui freinent l’innovation, le développement et la croissance, et l’explosion du bonheur qu’est toujours plus de consommation. C’est ainsi que nous sont présentées les orientations idéologiques de ces nouveaux maîtres à penser. En France, c’est connu « on n’a pas de pétrole, mais on a des idées » comme l’avait déclaré en 1976 Valéry Giscard d’Estaing, Président de la République, pour répondre au choc pétrolier de 1974, ce qu’il fit … avec la mise en place du changement d’heure à la fin du mois de mars pour limiter la consommation d’énergie. Macron fait aussi des avances aux « investisseurs », c’est-à-dire, se met aussi au service des maîtres du monde économico-financier. Le 10 février 2025, lors du Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle de Paris, Emmanuel Macron a mis en avant la robustesse énergétique de la France grâce à une énergie « sobre en carbone », l’énergie nucléaire. La France peut donc localiser beaucoup d’énormes data centers. En réponse à Trump, il lance « Branchez, bébé, branchez », branchez-vous sur le réseau électrique nucléaire français et achetez des centrales nucléaires, celles dont la France est la spécialiste.
L’IA a également besoin de beaucoup de métaux rares pour ses semi-conducteurs. Il y a quelques siècles, les investisseurs traversaient les mers à la recherche des épices, à la quête, toujours, de l’or, et c’est ainsi que des navigateurs ont traversé les océans, que des « compagnies » ont mis le pied sur de nouveaux territoires, que des peuples ont été décimés pour pouvoir accaparer au moindre coût leurs richesses. Aujourd’hui, pour alimenter l’espérance en des « rendements sur investissements » fabuleux, c’est avec l’IA qu’il faut compter. Les vastes espaces du Canada, du Groenland, de l’Ukraine, et d’autres territoires demain, peuvent donc être offerts aux investisseurs qui investissent « pour notre avenir ». Car, en même temps, l’IA est présentée à toutes les opinions publiques comme la réponse à tout, la réponse à toutes les difficultés actuelles du monde.
L’IA a aussi besoin de beaucoup d’eau, d’énormément d’eau pour réfrigérer les datas centers. Ça va être une autre dimension que les besoins en eau des piscines de luxe, des terrains de golf, des méga-bassines pour l’agro-industrie et pour la neige artificielle dans les stations de sports d’hiver atteintes par le réchauffement climatique. Ça va concurrencer, dans les « priorités nationales », les besoins en eau des centrales nucléaires qu’il faut aussi refroidir. Pendant la prochaine décennie, les capitaux à la recherche de rendements élevés vont donc se tourner vers tous ces secteurs qui vont connaître un développement important. Et toutes les politiques publiques vont être affectées à ces nouveaux objectifs. Il nous est déjà dit que « pour rester dans la course », pour « continuer d’exister dans le monde », il faut, sans tarder, investir dans cette direction et se mettre « en ordre de bataille ». Le capitalisme dominant de demain, c’est là qu’il se trouve.
Aux USA, le rapprochement entre Trump et Musk illustre bien cette convergence des intérêts de la pétrochimie (Trump) et des nouvelles technologies (Musk). Et c’est l’espoir dans de nouveaux profits qui a fait basculer assez rapidement la plupart des dirigeants de la Silicon Valley (Californie) qui nous étaient présentés comme des partisans des Démocrates en ardents soutiens des Républicains, versus Trump. Cette alliance Trump Musk est ainsi le reflet des mutations industrielles des États-Unis. Les entreprises des nouvelles technologies sont de plus en plus puissantes et exercent leurs activités dans des secteurs de plus en plus diversifiés. Les systèmes d’information sont devenus un levier de modernisation stratégique dans de nombreux secteurs, l’industrie automobile, les loisirs, la santé, le satellitaire, les transports, etc. Cette puissance industrielle est en mesure de se donner une finalité politique, celle de continuer de réduire la sphère publique pour lui substituer totalement l’entreprise privée. Les entreprises de la tech développent des solutions et estiment que l’administration constitue une entrave à l’exercice de leur activité et qu’elles sont capables de faire mieux que cette administration. Avec Twitter-X, pas besoin de journalistes, avec PayPal et les cryptos, pas besoin de banques, avec Uber, pas besoin de transports en commun, etc. Et ceci peut concerner tous les secteurs ou presque, y compris les secteurs régaliens comme l’armée, la justice, la police, l’enseignement. Cette puissance industrielle, incarnée par Elon Musk, s’associe normalement avec les politiques qui prônent la suprématie sans limites de la liberté d’entreprendre. Et l’alliance entre Trump et Musk représente une force de frappe qui doit déjà probablement pétrifier pas mal de résistances potentielles nationales aux USA et au niveau international : pour espérer des marchés publics, pour espérer des commandes, pour éviter des mesures de rétorsion, pour garder son emploi, son poste, son job, son statut social, sa commande publique, mieux vaut se montrer conciliant avec le pouvoir. C’était souvent vrai hier ; ça va le rester demain. La collaboration a de beaux jours devant elle.
Pour bien marquer cette alliance, dès le 21 janvier 2025 Trump a dévoilé le projet Stargate, un projet destiné à bâtir des centres de données géants de la future génération d’Intelligence Artificielle et les systèmes énergétiques qui les alimenteront (100 milliards de dollars investis tout de suite et 400 milliards supplémentaires d’ici à 2029). Les dirigeants des sociétés qui sont retenues pour ces projets étaient tous invités lors de l’investiture de Trump.
VIII – Un gouvernement contre les sciences.
En quelques mois d’exercice du Président Trump et de son administration, nous voyons déjà combien cette élection d’une convergence d’extrêmes-droites au pouvoir porte de contre- révolution dans de nombreux domaines, y compris dans les domaines scientifiques et culturels. Déjà l’usage de certains mots est interdit, des livres sont mis au rebut. Ce sont des pratiques répressives et portant atteinte aux libertés fondamentales qui ont été mises en place par les fascistes en Italie, par les nazis en Allemagne, par les staliniens en URSS, et dans d’autres dictatures totalitaires moins tristement célèbres.
Les scientifiques étatsuniens doivent désormais bannir tout un lexique environnemental et social de leurs travaux, sous peine de risquer la perte de financement. À ce jour, ce sont environ 120 mots-clés qui ne peuvent plus figurer dans les rapports ou les études délivrés par les centres de recherche notamment. Ordre a été donné aux agences fédérales d’identifier et d’éliminer tous les programmes politiques, activités, règles et ordres qui comporteraient ces mots interdits. Les ministères vont utiliser l’intelligence artificielle pour détecter les mots et les contenus interdits dans tous les projets financés par le gouvernement fédéral. Les recherches américaines qui contiennent certains mots-clés ne vont plus être financées par la NSF (National Science Foundation, la principale agence de financement de la science US dotée d’un budget de 9 milliards de dollars).
Il va devenir impossible de concevoir une étude sur les humains sans utiliser au moins un des termes figurant sur la liste des interdictions (sont interdits les mots « femme », « préjugé »), de même que toute étude sur les climats (interdiction des mots « climat », « changement climatique », « émissions de gaz à effet de serre », « justice environnementale », etc.). Les demandes de subventions n’entrant pas en conformité avec ces décrets feront l’objet de « mesures supplémentaires » et pourraient être soumises à des modifications ou à des résiliations partielles, voire totales. Les mots-clés conduisant à l’exclusion des projets de recherche sont nombreux : antiracisme, handicap, diversité, égalité, genre, femme, discours de haine, historiquement, inclusion, inégalités, minorité, ségrégation, victimes, etc.
Il s’agit d’une nouvelle chasse aux sorcières comme en ont déjà connu les Etats-Unis, ceux de Joseph McCarthy, au début des années 1960, qui pourchassa tout ce qui pouvait ressembler, de près ou de loin, à des sympathisant⸳es communistes … dans une définition extrêmement large des « communistes » !
Cette chasse aux sorcières va frapper les chercheurs et chercheuses au portefeuille. Elle va aussi se traduire par une mise en conformité des sites internet fédéraux qui, eux non plus, ne comporteront plus ces mots. Ceci va conduire à la suppression d’une masse importante d’informations pour tous les publics. Ainsi, les balises sur les océans pour connaître le climat et ses évolutions sont à 55% gérées par les Etats-Unis. Leur suppression va rendre ces études beaucoup plus difficiles. C’est un peu le comportement du malade qui, pour ne pas savoir qu’il a la fièvre, casse le thermomètre.
Les idéologues trumpistes veulent chasser les penseurs « d’extrême gauche », accusés de faire la « promotion de la diversité » ou de la « propagande néomarxiste ». Ceci ne concerne pas que les sciences humaines, mais aussi la physique ou la biologie.
Cette baisse drastique des financements publics basée sur ces critères a déjà engendré des protestations et des manifestations, notamment le 7 mars aux États-Unis. Dans nombre d’autres pays, la « communauté scientifique » est également effarée de telles décisions. En France, le Président de l’Institut Curie estime que « c’est une attaque à la démocratie parce que la science est un pilier fondamental de toute société ». Ceci va affecter les États-Unis et les autres pays du monde, car il n’y a aucune frontière, la recherche se fait en partenariat dans le cadre de grands programmes collaboratifs. Le retrait des États-Unis va peser sur la recherche mondiale.
Des chercheurs états-uniens déclarent que « les mesures brutales de la nouvelle administration Trump s’apparentent à une attaque généralisée contre la science et la place de l’expertise dans la société ». Des historiens rappellent que, dans les années 1960, la science mondiale est avant tout états-unienne, ce qui va permettre à l’impérialisme US de dominer le monde et, notamment, de relever les défis géopolitiques à caractère technique, comme la course à la Lune avec l’URSS. Le dynamisme de la recherche scientifique a été un pilier de la domination économique, militaire, idéologique et géopolitique des USA. Elle lui a donné un pouvoir d’attraction sur les cerveaux du monde entier, ce qui a privé d’autres pays de ces cerveaux.
Trump, qui déclarait que « le réchauffement climatique a été inventé par les Chinois pour nuire à l’industrie américaine », pousse désormais son idéologie réactionnaire, proche du délire, jusqu’à la négation des faits et de la méthode scientifiques, pourtant à la base de la puissance industrielle des États-Unis. La composition de son Cabinet montre l’ampleur du désastre : une personne ouvertement antivaccins à la Santé (Robert F. Kennedy), un conspirationniste à la tête du soi-disant « État profond » (Deep State) (Kash Patel au FBI), une directrice du renseignement national qui a souvent répété des affirmations russes maintes fois démenties (Tulsi Gabbard), un suprémaciste blanc au Conseil National de Sécurité (National Security Council et Steve Bannon) et des dizaines de milliardaires nommés du seul fait qu’ils sont milliardaires, donc compétents pour amasser des milliards. En étudiant les politiques menées par d’autres pays au cours de l’histoire, des scientifiques en concluent que l’isolationnisme de Trump ne peut que conduire à un rabougrissement de la science des États- Unis. Déjà, d’autres universités de par le monde se déclarent prêtes à accueillir des « réfugiés scientifiques américains ». En France pourtant, il est peu probable que cet « accueil » puisse se faire compte-tenu de la réalité de la politique du gouvernement concernant précisément la recherche scientifique…
Avec le rejet de tout terme parlant de « diversité », ce sont plein de projets qui, justement, visaient à prendre mieux en compte la diversité de la société, qui sont repoussés. Ceci va conduire à rendre plus difficile l’accès des minorités à certains postes et emplois. Ce n’est pas encore l’étoile jaune sur une partie de la population, mais on en approche.
C’est aussi la marque que, dans ce nouveau monde, la recherche de la vérité n’est plus une recherche scientifique. Des mots vont devenir interdits dans certains domaines. Peut-être que cette interdiction ira s’élargissant. Demain peut-être, des mots devront être mis en avant pour pouvoir espérer un marché public, une promotion, un emploi. Un monde nouveau est peut- être en cours de création, fictif et imaginaire, loin du monde réel. La propagande va circuler
« librement » par les plateformes et leurs propriétaires installés dans la Silicon Valley et les manipulations psychologiques vont être faciles et envahissantes, chaque individu étant branché avec son diffuseur de pensée. Nous sommes dans le roman « 1984 » de Georges Orwell. Il y a un ministère de la Vérité qui pratique le négationnisme historique et où le vrai devient faux et le faux devient vrai : deux et deux font cinq si Trump le décide ! Tout ceci va à l’encontre de la démocratie, laquelle repose notamment sur le réel et la vérité. Si ce régime ultra-réactionnaire dure encore longtemps, si les résistances sont insuffisantes et selon l’évolution des rapports de force entre les courants rassemblés en novembre 2024 autour de Donald Trump, il est possible que les prochaines étapes soient les autodafés de livres et la mise à l’écart des arts dégénérés comme chez les nazis avec la promotion d’un art nouveau décidé par les oligarques qui disent ce qui est beau et ce qui est vrai.
Il faut aussi noter que, parfois, les coupes claires dans les agences frappent aussi des agences liées à la recherche pour l’IA, laquelle est, par ailleurs, une priorité retenue par Trump. Ainsi, 170 employés de la National Science Foundation (NSF), une agence clé pour la recherche en IA, ont été licenciés. L’avenir nous éclairera peut-être en montrant que, désormais, dans ces secteurs, la recherche sera essentiellement mise en œuvre par les entreprises elles-mêmes.
IX– La loi du plus riche et du plus fort contre la démocratie et les démocraties.
- – La prééminence du droit de propriété sur tous les autres droits dans les régimes capitalistes aboutit logiquement à la domination, in fine, des plus riches. Cette situation se constate dans la plupart des pays : il y a toujours beaucoup de proximité entre les pouvoirs économique et financier et le pouvoir politique ; elle est inhérente à cette prééminence du droit de propriété, et donc à cette domination constante du capitalisme. La pression des possédants sur les décideurs politiques peut être franche, par leurs choix, par exemple, d’investir ou de ne pas investir. Elle peut se faire plus discrètement, par corruption, conflits d’intérêts, , tous moyens qui vont conduire à des législations répondant à la demande des financeurs. Et pourtant, à chaque fois, il peut y avoir, au préalable, des élections et puis, malgré ces élections, c’est toujours, en gros, la même politique en faveur de la minorité privilégiée qui est retenue. C’est pareil aux États-Unis. On se dit, Trump, il a été élu. Et on voit tout de suite qu’une élection, ça ne peut pas suffire pour définir un système politique démocratique (voir aussi la note n°1). Et on constate que Musk, un des hommes ayant le plus de pouvoir au monde aujourd’hui, lui, n’a même pas été élu. Il n’a pas non plus été confirmé par le Sénat (comme les secrétaires d’État doivent l’être). Cet « employé spécial du gouvernement » est pourtant au centre de la politique états-unienne depuis le 20 janvier 2025, depuis qu’il a été nommé à la tête du Doge, le département de l’efficacité gouvernementale, organisme créé sur mesure par Trump pour Musk. Le journal The Guardian note, dans un article du 4 février : « Désormais aussi important que le président lui-même, Musk a commencé à faire usage de ce pouvoir en prenant des décisions qui pourraient affecter la santé de millions de personnes en accédant à des données personnelles très sensibles et en attaquant tous ceux qui s’opposent à lui ». L’une des premières victimes a été US Aid, l’Agence américaine pour le développement international : son siège à Washington a vu déferler des membres de l’équipe de Musk avec pour objectif de s’emparer du système informatique de l’agence. Il a été fait de même avec les informations de MedicAid, le programme d’assurance maladie pour les plus démunis. Avec Musk, qui semble avoir, de fait, un grand pouvoir dans le domaine de la politique intérieure des USA, mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade.
Nous savions déjà que les gouvernants au service du système capitaliste étaient très généralement faibles contre les riches, voire serviles, et forts et inflexibles à l’égard des pauvres. Nous pouvions constater que, partout ou presque, le pouvoir politique était en très grande partie au service des intérêts des détenteurs du capital, ou, pour le moins, qu’il y avait une forte connivence entre les deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir économique.
Avec Trump, Musk et les autres milliardaires qui sont engagés dans l’opération, nous franchissons une nouvelle étape.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Encart En France, depuis 2017 et l’arrivée d’Emmanuel Macron, nous avions une version un peu plus brutale et cynique que celle de ses prédécesseurs : nous avions les lois et le mépris affiché sans complexes. Avec Trump et Musk, c’est très brutal, violent, rapide et dévastateur. Avec le néolibéralisme, l’État était devenu prestataire de services pour les marchés financiers et les multinationales, garantissant toujours et partout la primauté du droit de propriété, notamment par un cadre favorable à la « concurrence libre et non faussée ». Mais l’État conservait encore une relative autonomie formelle, jouant encore parfois un rôle d’arbitre, arbitre qui favorisait toujours les mêmes en sacrifiant les protections sociales et les services publics sur l’autel de la compétitivité. Le projet dit libertarien va beaucoup plus loin, il ne s’agit plus seulement de mettre l’État au service du marché, mais de fusionner totalement le pouvoir économique et le pouvoir politique : c’est celui qui possède qui gouverne. L’État n’est plus soumis aux marchés mais absorbé par les intérêts privés. Le politique est annexé par le capital. Le capital devient l’État, une autorité souveraine qui ne répond plus qu’à elle-même. Nous sommes désormais bien au-delà d’une simple privatisation de secteurs publics pour en tirer un maximum de profits privés. Musk n’est pas face à des institutions publiques, mais face à ses followers, ses abonnés. L’opinion des masses connectées remplace les mécanismes de contrôle démocratique. Ce que nous voyons se dessiner, c’est peut-être le « fascisme2 » à venir : une fusion de l’État et du capital, un pouvoir concentré entre les mains d’une oligarchie sans contre-pouvoir. Une société où les citoyens sont surveillés en permanence par des algorithmes et ne sont plus que des figurants dans un espace privatisé où la démocratie est devenue un spectacle. Les seigneurs de la Silicon Valley n’ont plus besoin de l’État tel qu’il existait hier. Ils sont en train de le remplacer.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- – Quand le plus riche devient le plus fort. Dans un pays où la réussite est corrélée au niveau de concentration des richesses, les hommes d’affaires ont souvent exercé une influence majeure sur la sphère politique, notamment par le lobbying et le financement des campagnes électorales. L’arrivée d’Elon Musk marque un tournant et illustre le rapprochement du politique avec l’économie. Elon Musk mobilise sa fortune, estimée à environ 430 milliards de dollars en décembre 2024, au service d’une vision économique et d’un projet politique pour mettre en œuvre son projet « totalisant ». Ses nombreuses entreprises apparaissent comme un véritable écosystème allant du microscopique (avec Neuralink) au macroscopique (via Starlink ou SpaceX), le tout au service d’un projet quasi civilisationnel : il s’agit de dépasser les limites biologiques et terrestres ! Partout, son entrepreneuriat technologique devient un levier d’influence géopolitique, dans la guerre en Ukraine particulièrement. Déjà, Musk peut dialoguer d’égal à égal avec des États. C’est dire que la démocratie, là encore, est fortement mise à mal.
3- Le pouvoir personnel met aussi en cause les systèmes démocratiques. Il y a un autre aspect de l’évolution du fonctionnement des sociétés qui vient affaiblir le fonctionnement démocratique des États, c’est la concentration des pouvoirs dans les mains d’une seule personne et, en conséquence, la personnalisation du pouvoir et l’affaiblissement des débats. Cette situation est connue en France depuis 1958 avec le texte de la Constitution de 1958, aggravé avec l’élection du président de la République au suffrage universel et accentué par la pratique des présidents élus. Aux États-Unis, la pratique retenue par Trump dès le début de son deuxième mandat, dès lors qu’il dispose, avec les Républicains, du contrôle des deux Chambres et qu’il est entouré de fervents partisans, accentue cette omnipotence d’un seul. Les décisions dépendent d’une seule personne, et elles vont pouvoir fluctuer selon son caractère, son humeur du jour, en fonction aussi des propos et des attitudes de son entourage et des courtisans. Les analystes politiques, les politologues, ceux qui tentent de nous dire ce qui va arriver demain doivent se livrer à des analyses psychologiques. Le sort de millions de personnes peut ainsi dépendre de l’état de santé mentale d’une seule personne : c’est la continuité de Caligula qui régnait sur Rome et sur l’Empire dans la première moitié du 1er siècle. Depuis l’arrivée effective de Donald Trump à la Maison Blanche, même les politologues les plus avertis ne savent que dire sur Trump dont il est impossible de prévoir le comportement. Le constat est qu’il est imprévisible et erratique et que le reste du monde doit, de façon cartésienne, prendre en compte cette donnée incertaine. Nous l’avons vu sembler s’intéresser à la situation en Ukraine, en multipliant les renversements d’alliances, puis alerter la planète entière avec l’application de droits de douane énormes pour tout le reste du monde ou presque, puis soudainement lever en partie le pied. Quand la concentration des pouvoirs dans les mains d’un seul se développe dans le pays le plus puissant de la planète, l’ensemble de la planète devient plus ou moins en partie dépendante de cette seule personne. C’est la verticalité à son maximum.
4 – La loi des plus forts contre les démocraties. Avec Trump, la loi du plus fort va aussi s’appliquer au plan des relations internationales. Nous avions déjà vu le couple Trump/Musk s’afficher en soutien aux partis d’extrême-droite dans plusieurs pays en Europe et s’immiscer sans vergogne même dans les campagnes électorales pour louer les mérites de partis ouvertement racistes et xénophobes. Depuis le 20 janvier 2025, tout ceci s’accélère. Désormais, le gouvernement des États-Unis met en place des liens privilégiés avec les pouvoirs forts des pays militairement, financièrement et économiquement forts. Il autorise Benjamin Netanyahou à continuer de raser Gaza pour qu’ensuite les investisseurs immobiliers, états- uniens et autres, puissent disposer d’une terre rénovée apte à accueillir tout ce qui pourrait faire un nouveau paradis au soleil du littoral méditerranéen. Dans le conflit en Ukraine, c’est le pays agressé, l’Ukraine, qui est qualifié de pays à l’origine de la guerre. Les prochaines semaines nous diront, si rien ne survient pour arrêter ce processus, si nous assistons à la mise en place d’un nouveau partage du monde entre les principaux impérialismes. Ce n’est pas la première fois que nous assistons à un partage du monde entre impérialismes concurrents. Le 7 juin 1494, par le Traité de Tordesillas signé sous l’égide du pape Alexandre VI, le monde était divisé entre une zone réservée à l’Espagne et une zone réservée au Portugal. Très rapidement, la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas ne vont pas respecter ce partage. Au XIXe siècle, ce sont encore la Grande-Bretagne et la France qui se partagent plus ou moins le continent africain. En février 1945, avant la capitulation de l’Allemagne et du Japon, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’URSS se mettent d’accord pour fixer leurs zones d’influence respectives. Aujourd’hui, la Chine est particulièrement attentive au bénéfice qu’elle pourra tirer de cette situation où Trump laisse les mains libres à Poutine. À ce jour en effet, cet accord semble concerner principalement les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine. Le marchandage pourrait être que chacun autorise l’autre à s’assurer un glacis de sécurité, l’existence d’États tampons à ses frontières, États vassalisés ou carrément accaparés avec l’autorisation de l’autre : la Russie en récupérant ou en neutralisant plus ou moins une partie de l’Europe qui était sous la coupe de l’URSS (pas seulement l’Ukraine, mais probablement d’autres États, voire des États aujourd’hui membres de l’Union Européenne), les États-Unis en « protégeant » leur frontière au nord, avec une installation au Canada comme au Groenland et, au sud, avec un contrôle sur le Mexique et jusqu’en Amérique centrale3, l’ancien golfe du Mexique devenant une mare nostrum états-unienne. Et peut-être demain, le même arrangement se fera avec la Chine qui pourra disposer de Taïwan et d’archipels au large de ses côtes. Si c’est le business qui prime partout, les conséquences vont vite apparaître. Les régimes démocratiques, dont la démocratie est souvent loin d’être parfaite, vont être des cibles pour tous ces pouvoirs autoritaires.
X – Comment on en arrive là.
Il faut certainement essayer de prendre du recul pour comprendre comment 30% de la population des États-Unis a pu voter Trump et permettre l’accession au pouvoir d’un tel gouvernement, et comment, en amont, un tel gouvernement a pu se constituer à partir du Parti Républicain, l’un des deux « partis de gouvernement » depuis plus d’un siècle.
C’est probablement le résultat de plein de batailles culturelles et idéologiques perdues, perdues peut-être même car elles n’ont pas été menées. C’est la marque de reculs successifs des solidarités et des outils mis en place par les sociétés démocratiques pour essayer de « vivre ensemble », et, parallèlement, d’avancées progressives du capitalisme et des possédants voulant sans cesse accroître leurs pouvoirs et leur domination.
- – Là où on en arrive, c’est à la domination illimitée de la finance. Désormais, aux USA, la finance n’a plus besoin d’être un groupe de pression, d’être le groupe de pression déterminant et dominateur sur l’appareil d’État et sur l’ensemble de la société. La finance est en train d’absorber l’appareil d’État et c’est elle qui fait société. Mais peut-être y contribuons-nous nous-mêmes en parlant de « la finance » comme d’une abstraction, ce qui finit par être compris comme un genre de phénomène naturel. Sans doute, faut-il faire attention à mieux incarner cette « finance », à travers quelques noms (Musk, Arnaud, ) mais pas seulement : « les capitalistes nous coûtent cher », plus que jamais, il faut mettre en avant, pas seulement le slogan mais tout ce qui permet de le démontrer, tout ce que notre classe sociale sait et perçoit de par ce qu’elle vit mais que les capitalistes tentent de travestir pour nous amadouer. Cette domination a été possible, essentiellement, par la libération de la circulation des capitaux sur la planète entière, libération sans limites et sans contrôles, et avec l’existence de multiples abris, ports francs, havres de tranquillité pour les capitaux anonymisés et exonérés de taxes, de cotisations, de juges, de tribunaux, etc. disséminés tour autour du monde comme autant de paradis fiscaux, judicaires, bancaires, sociaux, environnementaux et réglementaires. Ceci a prospéré sous le label blanchissant « concurrence libre et non faussée » porté par les experts en communication auprès du grand public. Les économistes nous ont dit qu’il fallait « laisser faire les lois du marché ». Et la vie nous a montré que, tout simplement, nous allions voir les « gros qui bouffent les petits ». Il faut que rien ne vienne entraver la possibilité d’extraire plus, de produire plus, de vendre plus, de profiter plus. Il ne faut pas de fiscalité qui viendrait dissuader de gagner plus, de gagner plus qu’avant et de gagner plus que les autres. Il faut donc tendre vers aucune fiscalité sur les revenus ou, au pire, seulement une fiscalité faible et proportionnelle (en français, la flat tax de Macron, par exemple). Il faut abandonner toute réglementation environnementale qui viendrait porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Avec ce « cadre juridique », les affaires sont les affaires, le business domine le monde. Le monde devient un business. Nous avons vu, partout, dans tous les pays, dans tous les secteurs, les gros et les plus novateurs qui absorbent la concurrence, qui achètent, qui rachètent. Les plus gros et les plus novateurs, ce sont souvent les mêmes, car les plus gros ont souvent de très gros budgets « recherche et développement » et ont toujours les moyens de racheter les nouveaux brevets ou d’absorber les start-ups novatrices. Et les entreprises les plus importantes, celles qui dominent un marché, continuent de croître, car il n’y a aucune réglementation qui pourrait s’y opposer dès lors que tout a été fait pour permettre et faciliter cette croissance possiblement illimitée. Ces énormes multinationales deviennent un État dans l’État. Puis elles sont l’État. Et c’est normal que ce phénomène se passe aux États-Unis, qui sont là où est le moteur du capitalisme mondial depuis le début du XXe siècle avec l’arrivée des premiers trusts disposant de moyens financiers énormes (pétrole, sidérurgie, banques, chemins de fer, automobiles, etc.).
- – Le dépassement des lois antitrust. Les pouvoirs des trusts ont été un peu limités par les lois « antitrust » et diverses mesures prises par Roosevelt lors du New Deal. On se souvient que la crise mondiale de 1929 / 1930 a son origine dans le krach boursier du 24 octobre 1929 à Wall Street (le « jeudi noir »). C’est dire que, déjà, ce qui se passait aux Etats-Unis se répercutait sur toute la planète. Franklin Roosevelt se fait élire en 1932 alors que le pays était dirigé par le parti Républicain depuis Le président Républicain Hoover, de 1929 à 1933, s’est révélé incapable de sortir le pays de la crise. Dès les premiers jours de son arrivée en 1933, le démocrate Roosevelt a commencé à prendre des mesures annoncées dans son programme électoral, le New Deal (ou « Nouvel accord », « Nouvelle donne », « Nouveau contrat social » en français), notamment un contrôle des banques pour que les déposants aient de nouveau confiance dans le système bancaire. L’ensemble des mesures qui vont être prises vont sortir le pays de la Grande Dépression. Ceci va redynamiser le capitalisme américain qui va connaître une nouvelle croissance avec la Seconde guerre mondiale à l’issue de laquelle les États-Unis vont asseoir leur domination idéologique, culturelle, financière, économique, monétaire et militaire sur une grande partie de la planète. Progressivement, de nouveaux secteurs vont être dominés par des entreprises mondiales dont le cœur était aux États-Unis. En décembre 1972, Salvador Allende, à la tribune des Nations-Unies, montrait que des multinationales étaient devenues plus fortes que des États. Il pensait notamment à ITT (International Telephon and Telegraph) qui fut un moteur du coup d’État de Pinochet le 11 septembre 1973 au Chili. Avec la Guerre Froide, le monde se retrouve, pour l’essentiel, divisé en deux et les États-Unis vont devenir l’impérialisme dominant militairement, économiquement et politiquement. L’ensemble du continent américain se retrouve sous sa domination et il y contrôle pratiquement tous les gouvernements, souvent des régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Avec l’OTAN, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, traité signé en avril 1949 et complété fin 1950 par une organisation militaire intégrée et permanente, les États-Unis ont des bases militaires sur une grande partie de l’hémisphère nord de la planète. Ce sont eux qui décident de nombreux conflits et qui gèrent, directement ou en sous- main, de nombreux pays sur les cinq continents. L’URSS faisant de même dans son champ d’intervention. La vassalisation se fait par la domination du dollar, par l’image offerte des États- Unis, pays de tous les possibles, de tous les rêves, par la domination culturelle d’Hollywood, par le Coca-Cola dont on trouve les publicités dans les lodges des cols de l’Himalaya ou les buvettes des petits ports du Groenland, et aussi par l’imposition de régimes autoritaires ou de dictatures quand le soft power ne suffit pas. Les États-Unis qui représentent le « monde libre », voire le « monde qui libère », c’est peut-être une vision de l’Europe occidentale, mais ce n’est pas, par exemple, la vision des peuples d’Amérique du sud. L’impérialisme de l’État américain est un outil pour la domination des multinationales basées aux États-Unis. Les deux impérialismes, celui de l’État US et celui de la finance US, se nourrissent mutuellement.
- – La libéralisation de la finance avec Reagan. Une progression décisive va être réalisée pour les idées conservatrices et réactionnaires avec la présidence de Ronald Reagan, de 1981 à 1989. Il se met au service des idéologues de la Société du Mont Pèlerin (Hayek et Friedman notamment) qui voulaient « libérer les entreprises » et donner les pouvoirs aux chefs d’entreprises et aux détenteurs des capitaux. Pour eux, ceci impliquait la libération des capitaux. Tout ceci a été vendu aux opinions publiques comme une étape vers plus de liberté. Souvent, dans ses discours, Reagan répétait que « l’État n’est pas la solution, c’est le problème ». Bien sûr il parlait en tant que « chef de l’État » ! Il faut donc moins de bureaucratie, et ce sera la suppression d’emplois publics, la disparition de missions de services publics, éventuellement la reprise par le secteur privé des parties « rentables » de ces missions. Il faut moins de paperasserie, et ce sera la disparition progressive des régulations et des contrôles destinés à protéger la sécurité et la santé de la population, la régularité des activités économiques, financières, bancaires, En réalité, toutes les réglementations et les lois qui venaient contrecarrer la « liberté d’entreprendre » et réduire un peu les marges et les profits, tout ceci était banni. Ce fut une étape décisive dans la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Ces reculs des contrôles vont accroître l’importance des fraudes, des corruptions, des conflits d’intérêts. De temps en temps, des scandales vont pouvoir tout de même éclater au grand jour, avec les marchés publics truqués, les conflits d’intérêts et les « dégâts collatéraux » (services publics défectueux conduisant à des drames humains, à des catastrophes, etc.). Cette évolution ne se constatera pas seulement aux États-Unis mais, progressivement, dans la plupart des pays du monde.
De plus en plus souvent, les « gagnants » seront aussi les moins vertueux, et ceci conduira à un rapprochement entre les oligarchies au pouvoir, la finance, quelle que soit son origine, et les trafics et les mafias détentrices de masses financières (« argent sale ») énormes qui vont se mêler aux profits gigantesques gagnés « légalement » (du fait de législations nationales et d’accords internationaux sur mesure). Moins de pouvoir aux États et plus de pouvoir aux marchés, c’est aussi moins de démocratie, moins de prise en considération des votes des personnes (un homme, une femme, une voix) et la prééminence du droit de propriété et des « lois du marché » (une action, une voix). Nous avons vu cette prééminence s’installer partout avec l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et le sacre de la loi d’airain de « la concurrence libre et non faussée ». Le droit de propriété est le droit suprême dans la « hiérarchie des valeurs » de ce nouveau monde.
- – Les règles du financement des partis politiques. Aux États-Unis, la confusion entre le pouvoir économique et le pouvoir politique est consacrée par plusieurs dispositions et
pratiques qui installent le pouvoir financier au cœur du monde politique. Les règles du financement des partis politiques autorisent désormais les financeurs privés à verser des sommes énormes pour aider leurs favoris à parvenir aux rênes du pouvoir, bien entendu en sachant qu’il y aura un « retour sur investissement ». Les États-Unis ont pourtant été un des premiers pays à penser à mettre en place une législation en faveur du financement public des campagnes électorales. Une loi Tillman de 1907 stipule que les élections doivent faire l’objet d’un financement public. La loi interdit aux entreprises toute contribution directe aux élections. Et deux réglementations, en 1910 et en 1925, ont également fixé des montants maximaux de recettes et de dépenses par candidat. Malgré cette législation, de fait, les financeurs privés vont toujours avoir un poids important dans le financement des campagnes électorales. Le coût des campagnes électorales ne cesse d’augmenter (140 millions de dollars en 1952, 425 millions en 1972), du fait du coût des sondages, de rédacteurs de discours, de publicitaires, de temps d’antenne achetés aux radios et aux télévisions, etc. C’est ainsi qu’éclate, de 1972 à 1974, l’affaire du Watergate qui va notamment révéler l’existence de pratiques illégales quant au financement de la campagne électorale de Richard Nixon. Ont notamment contribué illégalement au Comité pour la réélection de Nixon plusieurs très grandes entreprises comme American Airline, Gulf Oil, Goodyear, etc. Il devient nécessaire, pour calmer l’opinion publique, de mettre fin à ces dérives par un renforcement des règles en matière de financement électoral. Des textes adoptés en 1971 sont complétés et améliorés en 1974, 1976 et 1979 : les contributions financières sont plafonnées, elles doivent être déclarées, le financement sur fonds publics est restauré et une commission de contrôle est mise en place. En 1974, la Federal Election Commission (FEC) est créée. Les candidats doivent désormais présenter le montant de leurs dépenses, maintenant plafonnées, ainsi que les différentes sources de revenus pour financer ces dépenses. L’idée d’un financement public semble admise, mais la question d’un plafond de dépenses fait débat. En 1976, un arrêt de la Cour suprême, au nom de la liberté d’expression, déclare anticonstitutionnel le plafond de dépenses imposé par la loi. Le débat se poursuit dans le pays et, finalement, la Cour suprême maintiendra les plafonds. Pendant quelques décennies, tous les candidats aux présidentielles ont accepté les fonds publics pour financer leur campagne et restaient donc soumis aux plafonds. Mais, en 2008, Barack Obama décide de financer sa campagne via des fonds privés ; il contourne ainsi le fardeau du plafond tout en mobilisant beaucoup plus de fonds privés. En 2010, un nouvel arrêt de la Cour suprême fait de nouveau entrer les entreprises dans la vie politique en les assimilant à des personnes morales. Ceci leur permettra de faire des dons aux candidats d’un montant illimité ! Ceci a forcément des conséquences sur le fonctionnement démocratique des États-Unis. C’est ce que nous montre Julia Cagé dans son ouvrage « Le prix de la démocratie » (Fayard, 2018). Elle constate que plus l’argent entre dans les élections, plus le résultat en est influencé, plus on finance un candidat, plus on a de chances de le voir élu. Le jeu démocratique est donc biaisé puisque les intérêts des gros financeurs de la campagne vont orienter les débats. Julia Cagé a pu observer que, depuis 2004, c’est le candidat qui a dépensé la plus grande part de ses dépenses électorales dans les réseaux sociaux qui a toujours gagné les élections. Aux États-Unis, pour la campagne de 2016, 0,01% des Américains ont financé à eux seuls 40% de la campagne dans son ensemble, ce sont les « méga-donateurs ». Ce mode de financement a largement été utilisé par Hillary Clinton cependant que Donald Trump pouvait financer personnellement sa campagne à hauteur de 20%. Dans ces conditions, se pose la question de savoir comment rendre possible une campagne présidentielle tournée vers l’intérêt public. Le ratio « un citoyen = une voix » n’est plus respecté et la démocratie s’éloigne au profit de la ploutocratie. Plus largement, les responsables politiques de tous bords vont avoir tendance à se focaliser sur les intérêts des plus favorisés pour attirer leurs « méga-dons ». Ils vont laisser tomber les préoccupations des plus pauvres. Ceci conduit, de fait, à une non- représentativité politique de la majorité des citoyens. Cette évolution est très nette aux États- Unis, mais elle est en cours dans d’autres pays. En France, même si le système de financement des partis politiques permet d’éviter jusqu’à présent de tels excès, le seul examen de la situation financière et patrimoniale des ministres de tous les gouvernements depuis 2017 et l’élection de Macron à la présidence de la République nous montre largement que ce n’est pas la classe ouvrière qui est au pouvoir !
Il y a ensuite des conséquences sur les choix politiques qui vont être retenus par les candidats ainsi élus : il existe un lien direct entre les dons de campagne et l’orientation de la dépense publique américaine. Certaines études montrent même que des mécanismes financiers peuvent permettre aux dirigeants politiques américains d’interférer dans la passation des marchés fédéraux en faveur des donateurs importants. Très clairement, une entreprise américaine augmente ses chances d’obtenir plus de contrats fédéraux en faisant un don important à un parti politique, et plus particulièrement à la majorité au pouvoir. Tout ceci peut se faire par différents moyens : candidature unique à l’appel d’offres, absence de publication officielle, type de procédure non concurrentielle, négociation directe avec un fournisseur, modification du contrat, fournisseur enregistré dans un paradis fiscal, etc. Les donations augmentent le risque de favoritisme, ce qui n’est pas une grande découverte, mais ce qui montre encore combien la démocratie recule face à l’argent et comment on passe progressivement à une ploutocratie.
Le système de financement de la politique américaine est donc devenu de plus en plus marchand. Cette course aux finances désormais illimitées se fait au détriment de la qualité du débat démocratique. Les règles du jeu sont limpides : le candidat qui mobilise le plus de fonds est celui qui sera le plus vu et qui aura le plus de chance d’être élu. Ensuite, par l’usage du favoritisme, il pourra rétribuer les dons de campagne. Cette confusion entre intérêts financiers et élections politiques porte directement atteinte à la démocratie, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif étant, de fait, achetés par les plus riches.
- – Les pouvoirs des fondations. Le « non-profit sector » est une caractéristique du système politique et économique des États-Unis. Ce « tiers secteur » a produit notamment les plus grands musées, les hôpitaux les plus performants, les universités les plus prestigieuses. Tout ceci est financé par la philanthropie et le mécénat. Les fondations couvrent tous les pans de la vie publique, de l’environnement à l’éducation, en passant par la santé, les arts et la culture, l’action humanitaire, l’aide sociale, etc. Plus d’un million d’organisations à vocation d’utilité publique opèrent, en 2025, aux États-Unis. Cette vocation « d’utilité publique » est sanctionnée par un statut d’exemption fiscale favorable, connu sous l’appellation de « 501 (c) (3) », par référence à l’article du Code des Impôts qui définit leurs droits.
Le statut d’exemption fiscale est très favorable. Non seulement les organisations qui en bénéficient échappent à l’impôt indirect pour leurs opérations, mais les dons et legs qui leur sont faits ouvrent droit à des avantages fiscaux fortement incitatifs. Ainsi, les particuliers peuvent déduire les dons monétaires aux « public charities » à hauteur de 50% de leur revenu imposable et les dons aux fondations privées à hauteur de 30% de leur revenu imposable. Les entreprises sont autorisées à déduire jusqu’à 10% de leur résultat avant impôt. Quant aux donations en nature (œuvres d’art notamment), elles sont admises en déduction du revenu, avec des plafonds plus réduits, mais à leur valeur de marché et en exonération de l’impôt sur les plus-values. Les legs échappent, quand ils bénéficient à une organisation charitable, à la lourde imposition sur les successions. Ces dispositions visent la fiscalité fédérale, mais la quasi- totalité des États fédérés a mis en place des régimes spécifiques qui tendent à s’aligner sur ces mêmes exemptions.
Tout ceci a conduit à une intégration du don dans la gestion des patrimoines. Les notaires, les avocats d’affaires, les gestionnaires de fortunes tiennent compte de cette législation pour conseiller leurs riches clients. Tout un arsenal d’instruments financiers a été mis au point pour « optimiser » ces dispositions fiscales (polices d’assurance-vie bénéficiant à des « charities », donations différées d’actifs avec un élément de rente viagère, etc.).
C’est donc une culture différente de ce qui domine en France où, très majoritairement, la population estime qu’il appartient à la puissance publique d’assurer certaines missions d’intérêt général. Aux États-Unis, le système fiscal est allégé, particulièrement pour les très grandes entreprises. Il y a même un État fédéré, le Delaware, qui est un paradis fiscal au cœur des États-Unis. Environ 50% des entreprises états-uniennes cotées en bourse à New York ont leur siège au Delaware. Les banques du Delaware travaillent beaucoup avec les paradis fiscaux des Caraïbes (Bahamas, Îles Caïmans, Îles Vierges, Panama, etc.). Les philanthropes sont donc des personnes très riches, qui n’ont pas payé beaucoup de taxes, et qui, via leurs fondations, vont disposer de moyens d’actions importants sur l’environnement économique, social, sanitaire, culturel, éducatif, écologique, etc. De nombreuses missions qui sont d’intérêt général sont, de fait, gérées par des riches particuliers, selon leur bon vouloir. Tout ceci, bien entendu, échappe au débat démocratique. De fait, ce sont celles et ceux qui disposent d’énormes moyens financiers qui vont pouvoir être de riches philanthropes et qui vont pouvoir offrir ou pas des services et des prestations à l’autre partie de la population « car tel est leur bon plaisir ». C’est un des aspects de l’impact de la finance dans la société aux États-Unis.
- – L’extrême-droitisation progressive. C’est au cours du mandat de Reagan qu’est fondée en 1982 la Federalist Society for Law and Public Policy Studies qui se fixe pour objectif de réaliser une interprétation rigoriste et réactionnaire de la Constitution des États-Unis. En Mars 2025, sur les 9 membres de la Cour Suprême, 6 sont membres de cette organisation, par ailleurs financée par de riches C’est un travail de longue haleine qui permet en 2025 de réduire la démocratie en réduisant la séparation des pouvoirs.
Plus récemment, le parti Républicain a connu une phase d’extrême-droitisation sous l’impulsion de Newt Gingrich, un idéologue catholique intégriste qui a pesé dès les années 1990, et encore entre 2000 et 2010, en prônant la diminution des dépenses fédérales et des dépenses de recherche et de développement. Très climatosceptique, il a largement participé à la « révolution républicaine » que Trump a pu tout à la fois accompagner et piloter.
La bataille culturelle de cette droite extrême a aussi été gagnée grâce à l’apport de Fox News, chaîne de télévision cablée créée en 1996 par le magnat des médias Rupert Murdoch ciblant un public conservateur. Ce sera le début d’un fort développement de la manipulation des opinions publiques et d’un recours systématique aux propos mensongers et aux fausses informations.
Une autre impulsion extrême-droitière a été donnée par les membres du Tea Party (Taxed Enough Already – Déjà assez imposés), souvent libertariens, qui s’organisent au début de la présidence Obama, après la crise financière de 2008. Ils manifestent contre l’accroissement des dépenses gouvernementales liées au soutien donné par l’administration Obama au système financier responsable de la crise et aux dépenses résultant de la fondation d’une protection sociale au niveau fédéral. Le Tea Party, sous l’impulsion notamment de Sarah Palin (elle aussi membre du parti Républicain), soutient Donald Trump dès sa campagne électorale de 2016.
Cette extrême-droitisation a connu une accélération récente par l’intervention de plusieurs idéologues, souvent diplômés d’universités prestigieuses, qui entourent directement Trump ou sont très proches de son premier cercle. Les analystes du « cas Trump » citent notamment Curtis Yarvin. Ce philosophe blogueur se définit comme néo-réactionnaire et il prône une idéologie politique qu’il désigne « Les Lumières obscures ». Il estime que la démocratie américaine a fait son temps et montré ses impasses. Il faut la remplacer par un système autocratique, voire impérialiste, inspiré d’une start-up technologique de la Silicon Valley. Il a des liens avec des milliardaires libertariens et d’autres idéologues d’extrême-droite (Peter Thiel, J.D. Vance, etc.). Il a joué un rôle important dans le rapprochement entre les néo- réactionnaires et les nationaux populistes comme Trump et nombre de ses partisans.
Nous voyons que l’arrivée de Trump et des autres, ce n’est pas un tsunami qui n’aurait été précédé d’aucune alerte. Plein de reculs ont permis, facilité, accéléré, cette ascension fulgurante des extrêmes-droites. Et nous sommes face à un programme qui a été pensé par une armée d’idéologues, de chercheurs et de milliardaires.
- – En France aussi. Et nous constatons aussi que ces glissements progressifs se produisent sous nos yeux depuis pas mal d’années dans nombre de pays, dont en France. Milei en Argentine et Musk aux Etats-Unis y vont « à la tronçonneuse ». En France, Claude Allègre voulait « dégraisser le mammouth », Fillon annonçait des suppressions de centaines de milliers d’emplois dans la Fonction Publique, Valérie Pécresse voulait y aller « à la hache ». Et, en 2024/2025, les « décideurs » attaquent allègrement les agences sanitaires et environnementales comme l’Anses ou l’Office français de la biodiversité. Pour complaire aux productivistes, sous prétexte de statu quo en matière d’emplois et au niveau des productions, il faut alléger les bureaucraties et les paperasseries, c’est-à-dire, supprimer des emplois publics, supprimer les contrôles des entreprises en matière fiscale, sanitaire, sociale, environnementale, il faut leur faire confiance, et il faut supprimer les normes qui protègent la sécurité et la santé des En France aussi, les riches et les très riches ont la main sur les « partis de gouvernement » : si des partis veulent un jour gouverner, il vaut mieux être en bons termes avec les possédants. Il est bien passé le temps de De Gaulle, celui où « la politique de la France ne se fait pas à la corbeille », quand il voulait dénoncer l’influence, voire l’ingérence, du milieu financier dans la politique de l’État (toutefois, sans prendre de mesures pour la contrarier). Désormais, au maximum, il est dit, comme Hollande en 2012, « mon véritable adversaire, c’est le monde de la finance », mais ça ne reste que des mots : soit c’est un mensonge quand ils sont prononcés, soit la finance a le pouvoir de rappeler aux gouvernants par ses pressions multiples (notation par les agences de notation, fuite des capitaux et des « investisseurs », perturbations sur les marchés financiers, délocalisations, développement du chômage, etc.) qu’il faut compter avec elle. C’est ce qui s’est passé en 1982, quand le gouvernement PS/PC Mitterrand – Mauroy – Delors a reculé devant la finance représentée par la Deutsche Bundesbank et a opéré le « tournant de la rigueur », tournant dans lequel est toujours la France depuis plus de 40 ans. Aux États-Unis, une étape est franchie : les très riches n’ont plus besoin d’intermédiaires à leur service pour faire des lois qui perpétuent leurs avantages et privilèges, ils s’installent directement dans les lieux du pouvoir politique. En France, déjà, Bernard Arnault, le premier milliardaire « français », félicite Trump et déclare que tout ce qui se passe aux États-Unis est très intéressant en disant le 29 janvier 2025 : « il faudrait faire comme aux États-Unis ». « Nos » milliardaires sont partant pour la prochaine étape, celle qui s’ouvre aux Etats-Unis.
XI– L’incapacité des gauches à faire vivre une alternative politique.
- – Les gauches ont participé à « la libéralisation de la finance », donc à la nouvelle phase du capitalisme lui permettant de se renouveler Depuis très longtemps, nous savons qu’« ils » sont forts parce que « nous » sommes faibles. Au plan politique, « les gauches », que ce soit le « modèle communiste », la social-démocratie, voire l’écologie politique, se révèlent incapables de faire vivre une alternative politique au « libéralisme » économique et financier qui a été implanté sur l’ensemble de la planète. Cette implantation s’est faite avec la « libéralisation » progressive de la finance a qui a été attribuée une totale liberté de circulation sur l’ensemble de la planète. Avec un tel privilège, les détenteurs de capitaux ont un avantage énorme par rapport aux apporteurs de travail ; cela renforce l’inégalité du rapport capital/travail, capitalistes/travailleurs⸳es qui est la base même du capitalisme. Chaque travailleur, chaque travailleuse a sa langue, sa formation, sa qualification, sa profession, ses habitudes, sa famille, etc., plein d’éléments qui le rattachent à un endroit ou à quelques endroits de la planète. Mais quand la situation sociale amène à vouloir changer de pays (guerres, misère, oppressions, etc.), les États à l’origine de cette situation dans les pays qu’ils soumettent refusent que les populations migrent librement. Les capitaux peuvent, eux, circuler à travers la planète entière, désormais à la vitesse de la lumière ou presque, parfois sans laisser de traces par le recours à certains circuits financiers, aux comptes anonymes et aux territoires offshores. Les capitaux peuvent mettre les États en concurrence entre eux, choisir tel ou tel en fonction de sa législation. Et c’est ainsi que sont mises en concurrence les politiques fiscales, budgétaires, sanitaires, sociales, environnementales, etc., selon les seuls critères retenus par la finance et les financiers. C’est ainsi qu’ils règnent sur le monde.
C’est très net en France : depuis le « tournant de la rigueur » de juin/juillet 1982 qui a vu le gouvernement « socialo-communiste » se plier face aux injonctions de la Bundesbank d’Allemagne et de la finance déjà internationalisée et les directions syndicales suivre le plus souvent les glissements progressifs des reculs idéologiques, le « monde ouvrier » s’est progressivement retrouvé seul face à un environnement de plus en plus agressif. La libre circulation des capitaux a accentué l’avantage des détenteurs de capitaux sur les apporteurs de travail. Cette liberté accordée n’est pas tombée du ciel. Elle a été imaginée par les idéologues libéraux regroupés notamment autour de la Société du Mont Pèlerin (Friedrich Hayek, Milton Friedman), expérimentée au départ en Grande-Bretagne (Margaret Thatcher) et aux USA (Ronald Reagan), puis généralisée progressivement à toute la planète. Tous les partis politiques se sont soumis à cet avantage donné aux capitaux de pouvoir circuler librement sur l’ensemble de la planète. En France et au sein de l’Union européenne, c’est dans la fin des années 1980. C’est essentiellement au moment du gouvernement Mitterrand – Rocard – Bérégovoy que sont pris les choix politiques de s’inscrire dans un monde où la finance va dominer. C’est avec cette concurrence organisée entre les pays pour attirer les capitaux (qui vont permettre d’investir, de créer des emplois, etc.) que les attaques contre les salarié.es se développent dans tous les pays depuis quatre décennies. Certes, nous avons toujours en objectif possible le slogan qui, pour dater de 1848, n’en reste pas moins actuel : « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », mais dont nous en voyons au quotidien les difficultés pour lui donner vie.
Il apparait bien que, dans la plupart des pays, presque tous les partis politiques ont, plus ou moins, soit mis en place, soit accompagné cette domination progressive de la finance.
- – Les gauches n’ont ensuite plus de prises pour présenter et porter une politique alternative. La tempête étant désormais venue, ils sont fort dépourvus pour dire quelque chose. Aux États-Unis, depuis le 22 janvier 2025 et l’installation effective de Donald Trump à la Maison Blanche, il ne semble pas que les principaux leaders de ce qu’il reste du Parti Démocrate ne se soient exprimé, et ce malgré l’énormité des décisions prises par la nouvelle administration américaine. Effectivement, minoritaires dans les deux chambres, divisés et sonnés par leur défaite à la présidentielle, les démocrates peinent à trouver une voie pour contre-attaquer face à Donald Trump. Les propos cinglants du sénateur français Claude Malhuret contre l’administration Trump ont rendu encore plus criante la faiblesse des voix de l’opposition démocrate sur place. Au mieux, les démocrates utilisent les tribunaux pour contester les décrets de Trump. Certains démocrates prônent même une « retraite politique stratégique » et de « faire le mort » en attendant que le système Trump s’effondre de lui-même et que son impopularité le Depuis l’investiture de Trump, Bill Clinton, Barack Obama et Joe Biden, les trois derniers présidents démocrates toujours en vie, sont très silencieux et s’abstiennent de critiquer frontalement l’administration actuelle, alors qu’il y a cent raisons de critiquer les décisions prises par Trump quand on se dit progressiste. La candidate battue, Kamala Harris, est également d’une réserve extrême. Des sondages établissent que le parti démocrate est au plus bas depuis 35 ans, avec à peine 27% d’opinions favorables auprès de la population.
Cette situation ressemble un peu à l’absence de réflexion de la gauche en France pour essayer d’expliquer ses échecs, ce qui aurait dû conduire à une critique et à une mise en cause, pour commencer, des « années Mitterrand ». Les uns et les autres se sentent « mouillés » et ont des difficultés pour faire un retour sur eux-mêmes, pour voir là où ils ont dévié. Ce serait remettre en cause ce qu’ils ont fait. Et ce serait les obliger à faire autrement la prochaine fois. C’est peut-être ce qui explique leur silence. L’alignement au service de la finance, l’abandon, de fait, de la défense de la classe ouvrière, le repli sur d’autres combats, certes également très importants (inégalités, femmes, minorités, écologie et environnement, laïcité et religions, etc.), a conduit à négliger les luttes contre l’exploitation capitaliste, contre l’aliénation et pour l’émancipation. C’est probablement là qu’il faut chercher l’incapacité dans laquelle se trouve cette génération qui a participé à ces reculs idéologiques à refaire surface. C’est peut-être aussi ce qui explique que Bernie Sanders soit l’un des seuls à encore s’exprimer et à encore être audible, car il peut dénoncer la politique de Trump tout en continuant de dire ce qu’il disait il y a quelques années dans ses critiques du système économique et financier en voulant combattre l’oligarchie, sans pour autant remettre en cause ni le capitalisme ni l’impérialisme américain. Logiquement, le parti démocrate est appelé à connaître de fortes tensions internes entre celles et ceux qui refusent d’affronter Trump sur les questions de fond et baissent les bras et celles et ceux qui veulent mener une confrontation politique et idéologique. Mais il semble qu’aucun courant ne prendra le risque d’une scission, dans un pays dont la politique est dominée par deux mouvements puissants et compte tenu du mode de scrutin (uninominal majoritaire à un tour au Congrès). Les modérés pensent qu’il ne faut pas être dans l’opposition permanente, au risque de s’aliéner la part de l’opinion publique qui soutient Donald Trump. Les radicaux estiment qu’il n’est pas possible de rester passifs face au « coup d’État institutionnel » opéré par Trump et son équipe. Ce sont les militantes et les militants du parti qui trancheront et, à la fin, l’ensemble des électeurs et des électrices.
Plus largement, la nouvelle situation dans laquelle nous entrons va rendre les résistances encore plus difficiles. Progressivement, le pouvoir ne réside plus dans le contrôle des corps et des esprits, mais dans sa capacité à moduler les états de conscience de populations entières. Les plateformes numériques se révèlent être, non seulement des outils de communication, mais aussi des technologies hypnotiques qui modifient la façon dont nous percevons et interprétons la réalité. Les évolutions semblent aller maintenant au-delà des « fake news » et de la « post-vérité ». Le contrôle s’exerce aussi en multipliant les récits au point que tout point fixe devient impossible. Il est probable que le développement de l’Intelligence artificielle va accentuer l’accaparement des cerveaux et des intelligences par les propriétaires des plateformes. L’autoritarisme technologique oblige certainement à penser d’autres formes de résistance.
Dans une telle situation, les résistances sont totalement désemparées. À quoi bon continuer d’opposer des arguments rationnels, des données et un raisonnement logique, alors que l’adversaire agit sur les états de conscience et s’est mis en mesure de contrôler les imaginaires. La rationalité fondée sur la responsabilité est devenue un enfermement qui rend incapable de générer d’autres imaginaires collectifs capables de mobiliser désir, croyance, espoir et engagement.
XII – Quels après possibles ?
C’est peu de dire que, de voir un tel tableau, l’avenir est sombre, sombre et incertain. Nous ne savons combien de temps ce nouveau régime va tenir aux États-Unis ni ne pouvons mesurer quelle sera l’ampleur des dégâts collatéraux, pour la population des États-Unis et pour le reste de la population mondiale. Pour autant, nous savons que l’histoire n’est jamais terminée. Hitler pensait installer la suprématie de l’Allemagne nazie pour mille ans. Nous pouvions penser que la dictature des staliniens sur de nombreux peuples, dont le peuple russe, durerait encore des décennies, et pourtant, ce système oppressif et répressif a finalement implosé de l’intérieur. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, en 1992, le chercheur de Chicago Fukuyama a parlé de « fin de l’histoire », affirmant que la fin de la guerre froide marquait la victoire idéologique de la démocratie et du libéralisme sur les autres idéologies politiques. Manifestement, il prenait ses rêves pour la réalité car nous voyons bien que l’Histoire n’est jamais terminée. Ainsi, nous savons que le capitalisme n’a pas toujours existé et que, DONC, d’autres mondes sont possibles. C’est cette certitude qui reste le moteur pour continuer de réfléchir et pour encore agir ensemble.
- – Aux États-Unis, une résistance contre Trump anesthésiée. Au lendemain de la première investiture de Trump, en 2017, environ un demi-million de personnes avaient déferlé sur Washington, en signe de protestation, scandant « Voici à quoi ressemble la démocratie ! ». Huit ans plus tard, la riposte citoyenne est atone et l’opposition politique bien silencieuse face à l’échelle des bouleversements.
Les nombreux travailleurs fédéraux qui ont été licenciés essaient de s’organiser, espérant qu’une grande partie du sabotage auquel se livrent Trump et Musk devienne de plus en plus impopulaire. Mais demeurent le cliché du bureaucrate forcément paresseux et inefficace et l’idée qu’il faut faire le ménage dans la fonction publique. C’est un discours qui « marche » un peu partout. À l’apathie d’avant élection de novembre 2024 a succédé l’aquoibonisme : à quoi bon résister ? Trump fait ce qu’il avait annoncé et attendons que ses électeurs se lassent eux aussi.
Le Congrès ressemble, en ce début de nouveau règne de Trump, à une troupe de figurants dépassés par les évènements. Les démocrates pansent leurs plaies. L’absence de leaders démocrates est manifeste et laisse leurs électeurs dans un grand vide. Les républicains sont majoritairement inféodés à Donald Trump, quelques autres ne se risquent pas à s’opposer à celui qui dispose de toutes les manettes du pouvoir.
Le seul endroit où la résistance semble avoir un certain pouvoir, ce sont les tribunaux. Les très nombreux décrets du président se sont heurtés à des dizaines de poursuites judiciaires. Cette situation provoque des débats pour savoir si les États-Unis sont en train de perdre leur séparation des pouvoirs ou si, au contraire, les juges outrepassent leur autorité en ralentissant le programme de la Maison-Blanche en instaurant un « pouvoir des juges ». Il faudra des semaines et des mois pour que ces affaires aillent jusqu’à la Cour suprême qui est actuellement largement favorable à Trump. Tout ceci peut-être un peu inversé avec les élections de mi- mandat de 2026.
À côté de ces initiatives, se développent une forme de résistance et une désobéissance civile. Des dizaines de villes ont réaffirmé leur engagement à rester « sanctuaire » ; ce sont 300 villes et 4 États qui refusent de coopérer avec la police fédérale sur la question des sans- papiers. Les maires de San Francisco, Seattle, Boston et Washington refusent de participer aux éventuelles déportations de clandestin.e.s.
Des consommateurs, eux aussi, réagissent. C’est Elon Musk et ses voitures Tesla qui sont particulièrement visés, aux États-Unis et un peu partout dans le monde (baisse des ventes, manifestations devant les concessionnaires, actes de vandalisme sur les véhicules Tesla, etc.). Ceci commence à avoir des conséquences sur les marchés boursiers avec la chute des actions Tesla.
Le samedi 5 avril 2025 a peut-être marqué le réveil d’une partie de la population des États- Unis avec plus de 1 200 rassemblements et manifestations dans tout le pays et un cri de ralliement « hands off » (« bas les pattes »). Ceci s’est fait à l’appel de collectifs de défense des droits individuels, de syndicats, d’associations LGBT, d’organisations écologiques ou pour les droits humains, etc. Les manifestantes et les manifestants étaient là pour défendre la démocratie, l’environnement, les vétérans, les droits des minorités, les rangers dans les parcs nationaux, l’Ukraine, la Palestine, l’État de droit et les juges, l’assurance maladie, les immigrés arrêtés et expulsés, l’école publique, les bibliothèques et les musées, les crédits aux associations, etc. Aux États-Unis, il se dit : « Les capitalistes ont deux partis, les démocrates et les républicains. La classe ouvrière n’en a aucun ». C’est là-bas comme ici et ailleurs, la classe ouvrière ne peut compter que sur elle-même pour son émancipation. Au cours des dernières années il y a eu des grèves victorieuses sur les salaires dans plusieurs secteurs (Routiers, postiers, infirmières, universitaires, pilotes, etc.). Il reste des organisations syndicales capables de fédérer et de coordonner des luttes.
- – Des lendemains imprévisibles où tout est possible. Il est impossible de prévoir comment la situation va évoluer, mais nous sommes certains que, tant aux États-Unis que dans le reste du monde, les idées vont continuer de vivre, et des rapports de force vont continuer de peser sur le cours des choses.
Ce qui va se passer sur place, aux États-Unis, est primordial. C’est de là que ce nouveau gouvernement tire son pouvoir. Même si l’expression démocratique des oppositions y est plus difficile avec cette nouvelle administration, la situation dans les entreprises et dans la rue va peser sur les rapports de force. À la veille des élections de novembre 2024, des analystes disaient que le pays était fracturé, divisé en deux. Cette situation perdure probablement. Et les décisions effectivement prises par Trump doivent ravir certaines personnes et en désespérer d’autres. Le rapport de force, en avril 2025, parait toujours pencher du côté de Trump. Mais ceci peut basculer. Des mécontentements sont déjà là, bien entendu chez toutes les personnes qui ont perdu brusquement leur emploi suite aux suppressions de crédits et aux fermetures d’agences. La situation économique de la population est appelée à évoluer, notamment du fait de l’instauration de droits de douane à l’entrée des marchandises aux États- Unis et à la riposte des autres pays qui vont freiner les exportations de produits, de biens et de services provenant des États-Unis. Ceci va avoir des conséquences sur les prix, sur les commandes dans les entreprises, sur l’activité économique, sur l’emploi et sur le pouvoir d’achat. Il est possible que les mécontentements sociaux fassent bouger les lignes. Il est également possible que les évolutions du monde économique perturbent les marchés financiers et que les actions, non seulement de Tesla et de quelques entreprises de Trump ou de quelques autres, baissent, mais que les chutes soient importantes. La population américaine est « sensible » à l’évolution du cours des actions car le système des retraites repose en partie sur la valeur du cours de la Bourse. Et là, ça devient plus sérieux, et plus grave si des banques et quelques grandes multinationales changent leur regard sur les possibilités de nouveaux profits avec l’administration Trump. C’est un peu ce que nous avons constaté quand Trump, au débotté, a finalement (et provisoirement ?) décidé de ramener les droits de douane à 10% pour tout le monde, sauf pour la Chine, et sauf pour les iPhones, les smartphones et les ordinateurs, etc. Ce retournement confirme qu’aux USA comme ailleurs, c’est bien la finance qui gouverne : les menaces sur la valeur du dollar, les menaces sur la dette des États-Unis, les menaces sur la valorisation des actions des multinationales détenues par les milliardaires amis de Trump, les menaces sur le marché des obligations et des bons du trésor, tout ceci a servi de corde de rappel qui a conduit Trump à modifier ses propositions. Mais les intérêts de la finance ne sont pas ceux du monde ouvrier. Il faudra donc d’autres tensions pour obliger Trump ou d’autres à d’autres choix idéologiques et politiques. Tout est ouvert. Si des tensions économiques et sociales se développent dans un pays divisé, si le gouvernement Trump se crispe et réprime, la fracture dans le pays peut s’accentuer. Le système fédéral peut être mis en question, des États fédérés envisageant de mener plus ou moins une politique autonome par rapport à l’administration fédérale. Hier, des analystes nous parlaient d’une « guerre civile froide » aux États-Unis. Demain, nous pouvons avoir une implosion du système fédéral. Et tout deviendrait possible.
Les difficultés de l’administration Trump peuvent aussi venir de l’intérieur, à partir de tensions, voire de fractures entre ses différentes composantes. Les sujets de discordes sont variés. Par exemple en matière d’immigration : la tech souhaite l’immigration des « cerveaux » sur le sol américain pour maintenir la compétitivité du pays alors que l’un des principaux engagements de Trump a été de protéger les travailleurs américains contre les « submersions étrangères ».
Pendant le même temps, les décisions de l’administration Trump bougent les lignes dans le reste de la planète. En France, nous le voyons avec les décisions en cascade qui sont prises tant au niveau du pays que, plus largement, au plan de l’Union Européenne ou avec les autres pays, tant une partie de ceux de l’OTAN (Grande-Bretagne, Canada, etc.) que d’autres pays qui étaient également alliés avec les États-Unis (Australie, etc.). Ce qui semble rapprocher ces États, c’est, plus ou moins exprimé clairement, un refus des régimes autoritaires, oligarchiques et nationalistes. C’est ce qui fait le lien entre Trump, Poutine, et l’actuel gouvernement d’Israël, et d’autres, une alliance des extrêmes-droites qui enjambe les frontières et où l’extrême-droite française a désormais son carton d’invitation. Leurs points communs, notamment un rejet des systèmes démocratiques et se référant aux « droits humains », même quand ils les respectent très peu.
Des choix stratégiques nouveaux sont pris dans l’urgence et des décisions économiques, douanières, commerciales sont également prises. C’est le mot de « souveraineté » qui est retenu par les gouvernants de ces pays qui résistent, voire s’opposent à Trump allié de Poutine. À terme, ceci devrait conduire à une réduction du poids des États-Unis sur ces pays. Leur vassalisation plus ou moins affirmée peut basculer vers un peu plus d’autonomie dans plusieurs domaines. Il est même possible qu’à terme, la question de la prééminence du dollar soit posée. C’est dire qu’au lieu d’assister à un renouveau du dynamisme des USA, nous assisterions, de fait, au début de leur recul. Rien n’est sûr, mais l’histoire n’est pas écrite.
Nous pouvons aussi avoir une période assez longue pendant laquelle Trump, son administration et toutes celles et tous ceux qui l’entourent et le conseillent triomphent et confortent leur légitimité à la tête des États-Unis. Tout régime autoritaire conduit à des résistances, mais aussi à des peurs, à des replis sur soi, à des silences, à des nouveaux conformismes, pour garder son emploi, pour garder des contrats. Déjà une bonne partie de la Silicon Valley a basculé dans le camp Trump. Nombre d’entreprises et de multinationales de la tech financent Hollywood, ce qui veut dire qu’une partie du cinéma américain va suivre cette idéologie. Ceci annonce de nouvelles batailles culturelles au niveau planétaire.
Les dégâts seront importants, aux États-Unis et partout. Car partout l’élection de Trump a libéré les partis d’extrême-droite. Leurs idées gagnent en crédibilité aux yeux de plus de monde dès lors que la première puissance mondiale, désormais, les partage et les porte. Si le régime Trump dure plusieurs années, d’autres pays importants basculeront face cette nouvelle « internationale réactionnaire ».
XIII – Et nous là-dedans ?
- – La lutte de classe continue. Le reste du monde, nous le voyons, est concerné par ce qui vient de se passer avec l’arrivée de l’extrême-droite dans le pays le plus puissant de la planète. L’actualité à Gaza, en Cisjordanie et en Ukraine, notamment mais aussi par exemple au Soudan, nous le confirme : pendant la guerre, la lutte de classe continue. C’est ce que disent les camarades syndicalistes directement concerné⸳es par les guerres ici citées. Pendant la guerre économique, pendant le durcissement des relations diplomatiques et les renversements d’alliances, pendant les tensions géopolitiques, la lutte de classe va continuer. Les attaques contre les régimes sociaux et contre les services publics vont se poursuivre. Nous avons déjà des patrons et des « politiques » qui s’appuient sur la nouvelle situation internationale pour marquer dans les têtes qu’il faut que les salariés et salariées mettent en sourdine leurs égoïsmes. De plus en plus, les discours de certains vont se confondre avec la Tout ceci nécessitera encore plus que les organisations syndicales débattent ouvertement de cette situation.
Logiquement, notre organisation syndicale décidera qu’il nous faut continuer d’exprimer nos revendications, et continuer d’agir ensemble pour les faire aboutir : sur le partage des richesses produites, sur les salaires, les retraites et les minima sociaux, sur les conditions de travail et d’emploi, sur l’autonomie dans le travail, sur les services publics, sur la santé, sur les libertés démocratiques, sur la justice fiscale, la justice sociale et la justice environnementale, etc. Mais nous serons aussi amenés à discuter d’autres questions jamais abordées directement dans les organisations syndicales, celles liées à l’armement, à la production d’armes par les industries en France, aux contrôles des conditions de ces productions, au commerce des armes ainsi produites, à ce que nous voulons défendre, à ce que nous n’avons pas à défendre, etc.
Nous avons déjà pu constater que toutes les résistances, toutes les luttes qui ont pu être menées par le mouvement syndical en France depuis des années, même si elles n’ont pas été gagnantes, ont tout de même pu freiner les reculs et sauvegarder notamment une partie de « notre modèle social ». C’est peut-être un peu grâce à ces combats que les idées d’extrême- droite ont pu être limitées et ne pas encore être triomphantes en France comme elles le sont aujourd’hui aux États-Unis.
- – La Charte d’Amiens aussi. Pour mener ces débats, la Charte d’Amiens restera un fil à plomb, non comme texte sacré mais par ce qu’elle définit comme pratiques Le mouvement syndical, là comme ailleurs, doit s’efforcer de mener seul les débats qu’il estime utile de mener. Il nous faut éviter d’importer les querelles qui divisent « la gauche » sur ces sujets. Nous entendons celles et ceux qui, à gauche, disent qu’il faut faire confiance à la diplomatie, il faut éviter la guerre en repoussant les solutions militaires et en privilégiant les discussions. Nous en entendons d’autres qui continuent de « faire comme si » les États-Unis allaient toujours venir « nous défendre ». D’autres parlent d’acheter des armes, mais sans pour autant aller vers plus de souveraineté : il s’agirait d’acheter des armes pour des milliards de dollars aux États- Unis, ce qui renflouerait les caisses de Trump et nous laisserait en situation de dépendance à leur égard. Les questions sont complexes, elles interfèrent entre elles. Il nous faut oser essayer de nous les poser en allant jusqu’au bout de tout ce que ceci peut impliquer. Toujours à partir de notre position autonome de classe sociale, et en lien avec celles et ceux de notre classe sociale dans les autres pays.
Nous le voyons, le travail du mouvement syndical reste primordial. Il nous faut, tout à la fois, acquérir la souveraineté du peuple sur son destin, c’est-à-dire son indépendance et sa non-vassalisation par rapport à une autre puissance étatique, mais aussi par rapport aux détenteurs du capital. Il nous faut parvenir à obtenir la satisfaction des revendications et, en même temps, contribuer à bâtir un projet de société alternatif. Comme Guillaume Apollinaire l’écrivait, alors que la mitraille surplombait les tranchées de la Guerre de 1914-1918, « il est grand temps de rallumer les étoiles ».
Gérard Gourguechon, avec l’apport des échanges menés avec le Bureau National de Solidaires Finances Publiques et le Conseil d’Administration de l’UNIRS et les compléments apportés par des camarades du C.A. de l’UNIRS.
18 avril 2025.
NOTES
1 . Si, contrairement à 2016, cette fois Trump est élu en ayant plus de voix que son adversaire, il n’en reste pas moins que le résultat est aussi source de réflexion sur « notre démocratie », le système de la démocratie bourgeoise représentative : Trump impulse sa politique parce qu’il a obtenu 77 millions de voix alors que sa concurrente immédiate en a obtenu 75. Ses 77 302 580 voix représentent 49,80% des votant⸳es et … 31,45% des personnes inscrites, parmi lesquelles il n’y a pas la population immigrée vivant aux États-Unis. Cela nous concerne tous et toutes, puisque le même schéma s’applique, par exemple, aux élections présidentielles en France.
2. Les débats universitaires sur la notion, la définition du « fascisme » ne sont pas dénués d’intérêt, mais nous ne voulons pas ici entrer dans un mode de fonctionnement où il s’agit de fractionner les collectifs militants, au nom de la pureté du concept. Ceci est valable pour d’autres sujets. D’où l’utilisation des guillemets, en considérant que chacun et chacune voit de quoi nous voulons parler.
3. Si, à juste raison et sans qu’il s’agisse de similitude absolue, on rappelle « l’empire soviétique » à propos de la Russie, on ne peut s’empêcher de penser, pour ce qui concerne les États-Unis au rôle très direct que ce pays joua dans la mise en place et la défense de dictatures en Amérique du Sud et Amérique centrale.