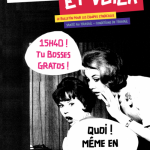Un rendez-vous à ne pas manquer, à l’initiative de la Fondation Copernic et de Politis : les 30 ans de novembre-décembre 1995.
Point Ephémère, Paris 10° à partir de 9h30 et toute la journée. Echanges – rencontres – tables rondes, exposition. Entrée libre.

30 ans du mouvement social de novembre-décembre 1995 une initiative de la Fondation Copernic et de Politis
La fondation Copernic et Politis proposent de fêter les 30 ans des grèves de novembre-décembre 1995 par une réflexion militante sur les enseignements de ce mouvement pour les luttes d’ aujourd’hui.
Nous voilà en effet 30 ans après ce surgissement qu’a été le mouvement social de novembre -décembre 1995. Cet anniversaire doit être l’occasion de réfléchir à ce qui s’est joué lors de cet événement, les conséquences qu’il a eues sur le mouvement syndical, associatif, intellectuel, politique et en particulier sur la gauche, la génération militante qu’il a d’une certaine manière façonnée, et surtout à ce qu’il nous dit et nous « enseigne » pour mener nos luttes aujourd’hui.
C’est le sens de l’initiative organisée le 8 novembre à Paris et qui veut revenir sur 1995 avec les actrices et acteurs du mouvement mais aussi avec les militant-es et responsables actuels, des chercheur-ses, et toutes et tous les citoyen-nes que ce sujet peut intéresser. Pas une commémoration à la manière d’une célébration des « riches heures » de la lutte, ni la volonté de trouver des « recettes » à reproduire, pas plus que la déploration sur les difficultés à traduire un certain nombre de potentialités que ce mouvement a ouvertes. L’enjeu est plutôt de faire un événement en prise avec l’actualité, permettant de contribuer à la mémoire militante qu’on sait si importante pour se projeter sur l’avenir.
1995 est un surgissement, une heureuse surprise puisqu’il permet – enfin- de sortir des longues années 1980 d’apparent triomphe du néo-libéralisme et de déception par rapport aux politiques menées par la gauche au pouvoir. Ce que nous devons à 1995 aujourd’hui encore, c’est cette force et cette détermination à contester la marche forcée à la libéralisation et à rechercher des alternatives de progrès social. La lueur qui s’allume alors est fragile bien sûr, car 1995 n’a mis qu’un coup d’arrêt très provisoire aux attaques contre les conquis sociaux, mais elle est précieuse car elle initie une manière de porter les combats sociaux au niveau de l’intérêt général et du projet de société.
1995, c’est une bataille gagnée avec le retrait du plan Juppé. Mais ce n’est qu’une victoire partielle, le processus d’étatisation de la sécurité sociale se met en place, le démantèlement des services publics (la sernam tout de suite après 1995) est lui aussi en cours. En tous cas, 1995 marque l’inauguration d’un cycle de mouvements sociaux sur les questions de protection sociale au sens large, incluant la question des retraites, et sur les services publics. Et sur ce sujet, 1995 est à la fois un mouvement victorieux (retrait du plan Juppé) et défait (processus d’étatisation de la sécurité sociale , etc).
1995 c’est la force du slogan « Tous ensemble », avec une dynamique militante associant des secteurs moteurs, on pense évidemment aux cheminot-es, mais aussi la jeunesse, l’ensemble du monde du travail, le mouvement des « sans » (sans papiers, mouvement des chômeurs, mouvement pour le droit au logement), le poids et le rôle nouveau des intellectuels, on pense évidemment à Bourdieu, le mouvement féministe. Syndicalement, c’est l’apparition de figures nouvelles, par exemple celle de Bernard Thibaut à la CGT, c’est l’émergence des SUD et de la FSU et tout ce que ces jeunes organisations charrient de promesses de renouvellement des pratiques militantes. Ce sont aussi des collectifs actifs, des AG massives, une « aile gauche » de la CFDT qui amplifie son inscription en rupture avec sa confédération. Il sera intéressant de s’interroger sur ce que cela a produit.
1995, c’est aussi le début de mouvements interprofessionnels marqués par une mobilisation plus forte dans le secteur public. C’est encore le début de mouvements dont la jauge de réussite repose beaucoup sur le nombre de manifestant-es plus que sur celui des grévistes, même si les deux sont évidemment liés et que les grèves dans les transports donnent quand même une allure de blocage du pays qui ne se reproduira plus de manière aussi prolongée et massive.
1995, ce sont aussi deux pétitions en compétition, celle de Bourdieu et celle de Touraine, traduction de deux stratégies, une gauche « radicale » et une autre « raisonnable ». Ces débats n’ont pas été refermés, loin de là ! Sans 1995, sans doute la constitution d’un front pour un « non de gauche » lors du référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005 n’aurait pas pris la même forme.
1995 est aussi le creuset de ce que sera ensuite l’altermondialisme.
1995, c’est encore probablement beaucoup d’autres choses que nous espérons mettre en relief à l’occasion de cet anniversaire.
Deux particularités sont frappantes quand on évoque la mémoire de 1995. En général, c’est une mémoire plutôt heureuse, une parenthèse enchantée au cœur d’un hiver froid, une certaine ambiance intellectuelle, des moments de fraternisation, des covoiturages improvisés en raison de la grève des transports. Mais la deuxième particularité est que la force du mouvement ne se traduit pas forcément par une mémoire particulièrement vivace. En 95, on comparait volontiers avec mai 68. En 2023 lors du mouvement contre la réforme des retraites, peu de comparaisons étaient faites avec 95. Comment expliquer ce paradoxe ?
Et si on redonnait une nouvelle jeunesse à 1995 ?
Et si novembre-décembre 1995 n’était finalement pas terminé et n’avait pas fini de nous donner à voir d’autres possibles ?