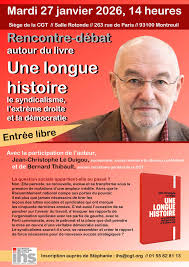Si l’affaiblissement du mouvement syndical est incontestable, il reste relatif. Il accompagne notamment le déclin brutal des secteurs industriels. Mais attention : face à la mise en cause actuelle de l’action syndicale et alors que des perspectives sombres se dressent dans notre société, la tentation de magnifier le passé est grande. Les conquêtes sociales ont toujours été arrachées de haute lutte par les organisations syndicales. Ambroise Croizat n’avait de cesse de le répéter : les avancées sociales ne sont pas des acquis, mais des conquis.
La crise du syndicalisme est-elle inéluctable ?
Non. Dans le passé, le syndicalisme s’est déjà heurté à de grandes difficultés. À la fin du XIXe siècle, le syndicalisme affaibli s’est transformé. D’une structuration autour de métiers en péril, il s’est mué en un syndicalisme d’industrie, prenant en compte la révolution industrielle et ses conséquences sociales pour déboucher sur les grandes garanties collectives aujourd’hui remises en question par les libéraux. Il s’agit désormais d’envisager le syndicalisme du XXIe siècle, qui affronte la révolution numérique, la financiarisation et la mondialisation. Ce n’est pas un simple ajustement que nous avons à opérer, mais bien une transformation.
Vous commencez l’ouvrage en tirant un constat cruel : la France est composée de « plusieurs peuples qui semblent habiter la même nation mais ne se parlent plus ». Comment le syndicalisme peut-il espérer unir la classe des travailleurs, si tant est qu’elle existe encore ?
Le monde du travail est clivé. Il est divisé en trois continents. Un tiers des salariés peut relever de ce que le conseiller social de Bill Clinton, Robert Reich, appelait les « manipulateurs de symboles », c’est-à-dire une minorité de travailleurs liés aux transformations technologiques et informationnelles. Un autre tiers est composé d’exclus de toute possibilité d’intégration dans le travail, qui alimentent la pauvreté. Enfin, un troisième tiers de travailleurs précarisés, qui ne peuvent viser qu’une intégration fragile dans le processus productif. Ces trois blocs n’ont plus la même appréhension du réel.
Or l’éparpillement des chaînes de valeurs et des formes de salariat est un obstacle à la convergence. Obstacle cependant surmontable, si on analyse bien ce qu’ont de commun ces trois ensembles, à savoir le rapport au travail. Le syndicalisme doit faire prendre conscience de cette communauté d’intérêts… Il ne s’agit pas de rechercher un substitut à une classe ouvrière qui fédérait les revendications des autres catégories du salariat. L’aspiration des populations à participer au destin commun et à la définition de leur avenir est une opportunité pour bâtir une conscience de classe commune.
La mise au second plan de la question du travail par rapport aux question sociétales et environnementales peut-elle expliquer le succès de l’extrême droite dans le salariat ?
Incontestablement. L’émergence électorale avec prétention majoritaire de l’extrême droite coïncide avec son pseudo-tournant social. Marine Le Pen brise le plafond de verre auquel se heurtait son parti quand elle prend la tête du Front national tout en écartant la vieille garde frontiste. En prétendant répondre à une fracture sociale, elle réussit à élargir son audience électorale. La gauche, encore marquée par le débat sur la fin du travail, n’a pas vu venir le danger.
Vous dites que cette notion de fin du travail est dangereuse. Et vous vous opposez à une allocation universelle ou revenu de base, dont vous dénoncez l’orientation libérale. Pourquoi ?
Cette notion a contribué à faire intérioriser aux travailleurs l’idée qu’ils n’existaient plus en tant que tels, au sein de la société. Comme s’ils étaient devenus inutiles, comme s’ils s’étaient transformés en non-citoyens n’ayant plus rien à faire valoir, même leur dignité. Le revenu universel est un parti pris de scission dans le monde du travail entre ceux qui peuvent prétendre à un emploi et ceux qui sont condamnés à vivre de la redistribution. Par ailleurs, soulignons que l’allocation universelle serait un nouveau cadeau aux entreprises, les incitant à tirer les salaires vers le bas.
Pour quelles conséquences ?
La gauche a abandonné la question du travail à la droite et à l’extrême droite au nom de la priorité à l’emploi. À l’instar des experts du think tank Terra Nova, il faudrait se féliciter de l’avènement de la société postindustrielle. À leurs yeux la contradiction centrale n’est plus économique. L’émancipation de la masse des travailleurs est mise au second plan, en faveur d’une approche élitiste de la société, qui a profité à l’extrême droite, affaiblissant les luttes syndicales.
Ce livre expose votre parcours de syndicaliste. Vos luttes sont inhérentes aux grandes mutations menant à la mondialisation. Avec le recul, la construction d’un capitalisme financiarisé était- elle inévitable ?
D’autres choix sont possibles, à condition de mettre en avant un contre-modèle de mondialisation fondé sur la coopération et non sur la concurrence. Sous François Mitterrand, la conversion au libéralisme a été longtemps occultée. La période 1981-1984 est apparue a posteriori comme une parenthèse, une simple pause dans l’avènement inéluctable du néolibéralisme. Tout s’est concrétisé dans les choix de Lionel Jospin lors de son passage à Matignon. On se souvient de sa théorie : « Oui à l’économie de marché. Non à la société de marché », comme s’il était possible de dissocier les deux sous-ensembles. Cela justifiait des abandons face à l’emprise des marchés. Avec à la clef 30 milliards d’euros de privatisations dont des secteurs stratégiques de l’économie, trois fois plus que sous Jacques Chirac en 1986-1988. La gauche a ainsi cédé à la pression financière internationale. Au début des années 1990, je me souviens du vif débat avec Pierre Bérégovoy sur l’internationalisation de la dette publique française qu’il venait d’accepter. C’était un « Munich de la finance française », avais-je déclaré à « l’Humanité ». Nous nous sommes mis la tête dans le nœud coulant de la dette.
Vous rapportez une sortie de Lionel Jospin, en 2002, qui s’opposait à l’extension des pouvoirs des salariés dans l’entreprise, assurant qu’il n’y avait pas « lieu de réclamer des droits supplémentaires » et qu’il fallait « veiller seulement à utiliser ceux qui existent ». Que traduit cette posture ?
Ce renoncement était une garantie apportée aux capitalistes. Auparavant, en 1999, face aux 7 500 licenciements chez Michelin, Lionel Jospin avait affirmé que l’État ne pouvait pas tout. Cet aveu de faiblesse a profondément marqué les salariés les plus conscients sur l’orientation de la gauche. Le Parti communiste français (PCF) participait au gouvernement de la gauche plurielle. Sans céder à cette idéologie du renoncement, il a de fait couvert ces reculs. C’était aussi le moment où le PCF faisait le choix de ne plus faire de l’entreprise un lieu de bataille prioritaire, avec l’abandon de cellules dédiées.
Vous démontrez comment en vingt ans l’économie mixte a été mise à terre. Est-il possible de retrouver une place pour la puissance publique industrielle ?
C’est une nécessité. La puissance publique industrielle est un contre-modèle à apporter face aux grands trusts américains de l’industrie, de l’électronique et des services. La concentration des firmes ne peut être dictée par les intérêts du privé. Avec les conséquences sociales qui en découlent : la captation des richesses par une minorité et à l’opposé l’exclusion sociale d’une partie des travailleurs. Nous devons retrouver des filières productives cohérentes, capables d’absorber la mutation industrielle en cours, sans provoquer une déstabilisation du salariat et une baisse générale du niveau de vie.
La sécurité sociale professionnelle, portée par la CGT, est-elle une réponse à la nécessaire reprise en main du thème du travail par la gauche ?
Il demeure une grande exigence de sécurité, sans réponse, en cette fin 2025. Cela se traduit aussi bien dans le mouvement agricole que dans la lutte des salariés de la sidérurgie. L’intérêt de la sécurité sociale professionnelle est d’envisager des évolutions du système productif sans passer par le chômage. Son financement ne pose pas de problème fondamental. Elle ne peut être perçue comme un mécanisme central, mais comme un processus construit à partir de nouveaux droits dans la diversité du salariat. D’ailleurs 190 milliards d’euros sont dépensés par an dans des politiques de l’emploi notoirement inefficaces. Redirigeons-les pour sécuriser le salarié face aux évolutions technologiques.
Comment se pose aujourd’hui la nécessaire complémentarité entre syndicats et partis de gauche ?
Ces rapports sont à reconstruire. D’abord, il faut reconnaître l’autonomie du mouvement syndical. Ce processus est largement engagé, d’où la référence affirmée et parallèle de la CGT et de la CFDT à la charte d’Amiens. Le refus de la mainmise du politique sur le syndicalisme est similaire à celui qui fut posé en 1906. Cette autonomie ne veut pas dire dépolitisation. Mais le syndicalisme se différencie du politique : il n’a pas vocation à occuper le pouvoir. Pour cela, les politiques doivent mieux intégrer la complexité du mouvement social et accepter que le syndicalisme ait étendu son champ d’intervention aux enjeux de société, d’écologie, de féminisme.
par Naïm Sakhi