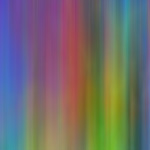Après la phase de révélations, dont une certaine presse s’est régalée, sur les privilèges inattendus de certains responsables CGT, considérés en interne comme « contraires aux valeurs » du syndicat, voici le temps de la prospective et des débats de fond. Nous reproduisons ci-dessous des articles publiés dans Regards et sur le site d’Ensemble (Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire), à propos de l’avenir de la CGT: un article de Roger Martelli, deux d’Alice Dubost et un de Vincent Gachet.
Liens : www.regards.fr, onglet « société »
et : www.ensemble-fdg.org, onglet « luttes sociales »
La CGT joue son devenir… et pas seulement le sien
Secouée par la contestation de son secrétaire général, la CGT connaît une crise qui dépasse cette affaire. Roger Martelli analyse ses enjeux, à la lumière de l’histoire de la centrale et du syndicalisme… et de leur avenir.
Tout le monde sait que la CGT est dans la tourmente. Les dépenses de son secrétaire général ont déclenché la crise (lire « À quoi rêve Thierry Lepaon ? »). Elles n’en sont pas la cause. Que deux des prédécesseurs de Thierry Lepaon (Georges Séguy et Louis Viannet) aient rompu le traditionnel devoir de réserve des anciens pour demander le départ de l’actuel secrétaire de la CGT en dit long sur la gravité de l’enjeu. En fait, ce n’est rien moins que l’avenir d’une CGT déjà affaiblie qui se trouve en question.
La galaxie s’est défaite
Le syndicalisme français présente une double originalité dans le paysage syndical européen [1]. D’une part, il est dominé depuis le début du XXe siècle par la volonté d’une indépendance affirmé du syndicat par rapport au parti politique. La France n’a connu ni le modèle travailliste anglais (subordination du parti au syndicat) ni le modèle social-démocrate allemand (subordination du syndicat au parti). À la limite, le seul moment où s’est opérée une symbiose du syndicalisme et du politique s’est vu à l’époque où la CGT a été englobée de fait – mais non de droit – dans la galaxie communiste, de la Libération aux années 1990. La seconde originalité tient à ce que le courant réformiste de type nord-européen est resté longtemps minoritaire dans le syndicalisme français.
Pendant quelques décennies, la CGT a ainsi incarné un syndicalisme marqué par une triple caractéristique : majoritaire dans le monde du travail (ce qu’attestent les élections professionnelles de l’après-guerre) ; marqué très à gauche par le poids d’un communisme politique lui-même oscillant entre 20 et 25 % des suffrages jusqu’aux années 1970 ; exprimant la synthèse originale d’un syndicalisme à la fois « de classe et de masse », pour reprendre la terminologie officielle longtemps employée.
Or cet équilibre est définitivement rompu, sur fond de désagrégation générale des structures du « mouvement ouvrier ». Les vingt dernières années sont marquées par un quadruple phénomène : l’évolution des formes de la conflictualité, concomitante des transformations du travail et de celles du salariat ; l’affaiblissement structurel général du syndicalisme (phénomène largement européen) ; le recul de la CGT (en adhérents et en voix) et le rééquilibrage du mouvement syndical ; la désagrégation des liens entre la CGT et le PCF, lui-même en déclin continu. La force du communisme français tenait à ce que le parti était au cœur d’une galaxie incluant le syndicalisme, des associations actives et un réseau municipal élargi. La « galaxie » s’est défaite. Le syndicalisme incarné par la CGT en est à la fois plus libre… et plus solitaire. La CGT résiste mieux que le PCF ; elle n’en est pas moins affectée par la rétraction. Sa place sociale est réelle ; elle est toutefois en jeu.
Le syndicalisme français confédéral est plus diversifié que jamais. Le dilemme du premier des syndicats français est de ce fait difficile. Il a pu être en partie occulté, entre 2007 et 2012, au temps du libéralisme sécuritaire et arrogant de Nicolas Sarkozy. Il revient en force quand la gauche, même droitisée, accède aux responsabilités (lire l’interview de Sophie Béroud). Où en est-on aujourd’hui ? Force ouvrière incarne une voie particulière, combinant le pragmatisme d’une organisation qui a fait longtemps de la négociation sa marque de fabrique et la radicalité quasi corporative d’un discours centré sur la défense intransigeante des statuts anciens. Depuis son « recentrage » amorcé à la fin des années 1970, la CFDT a pris la place, naguère occupée par FO, d’un syndicat de compromis, à la recherche de consensus entre patronat et monde du travail, soucieux de « modernisation » et de « fluidité », tout autant que de protection du salariat. Quant à la radicalité historique du monde syndical, elle est reprise – outre l’existence du syndicalisme anarchiste de la CNT – par la mouvance originale de Sud-Solidaires, ouvertement inspirée de la pente syndicaliste révolutionnaire de la Charte d’Amiens.
La combativité et l’utilité
Et la CGT ? Elle incarne de façon forte la combativité et souvent la colère. Pas une manifestation revendicative, pas une action d’entreprise sans l’omniprésence du sigle CGT. Mais la combativité, même sur le plan syndical ne suffit pas à définir l’utilité, qui se situe toujours du côté de la capacité concrète à améliorer les choses. Quand la tendance historique était à l’homogénéisation de la classe et à la concertation salariale, quand elle était à l’expansion du « mouvement ouvrier », cette capacité était relativement facile à délimiter. Elle l’est beaucoup moins quand le temps est à la désindustrialisation, à l’éclatement des statuts et à la dispersion géographique.
La CGT sait, par tradition, que le dynamisme syndical tient à la largeur du spectre que l’on peut mobiliser. Elle sait donc qu’une faiblesse du mouvement syndical français tient à son éparpillement. Elle énonce à partir de là l’exigence de ce qu’elle appelle un « syndicalisme rassemblé ». En cela, elle ne rompt pas avec la tradition ancienne d’une CGT à la fois très identifiée par ses référents « de classe » et capable de rassembler le monde du travail très au-delà de ses frontières mentales et doctrinales. Mais cette CGT agissait dans un environnement où la culture d’une certaine « radicalité » et en tout cas l’univers mental de la « transformation sociale » étaient largement majoritaires à gauche et dans l’espace salarial, ancien et nouveau.
Par ailleurs, la CGT a expérimenté les limites d’un syndicalisme plus prompt à dire « non » qu’à énoncer des propositions. La propension contestataire suffisait peut-être à définir une identité positive dans une phase de croissance économique et d’État-providence : l’affirmation pure d’un rapport des forces permettait en effet des transferts significatifs de richesse, de la production et des services vers le monde du salariat. Le bras de fer devient moins efficace dans un système de matrice avant tout financière, où la redistribution générale se tarit en même temps que la sphère publique se rétrécit. Alors le problème politique de la régulation globale et du « système » prend une place de plus en plus déterminante.
La CGT, elle, incarne de façon forte la combativité et souvent la colère. Pas une manifestation revendicative, pas une action d’entreprise sans l’omniprésence du sigle CGT. Mais, même sur le plan syndical, la combativité ne suffit pas à définir l’utilité, qui se situe toujours du côté de la capacité concrète à améliorer les choses. Quand la tendance historique était à l’homogénéisation de la classe et à la concertation salariale, quand elle était à l’expansion du « mouvement ouvrier », cette capacité était relativement facile à délimiter. Elle l’est beaucoup moins quand le temps est à la désindustrialisation, à l’éclatement des statuts et à la dispersion géographique.
Trois séries de problèmes et de défis
Réunis à nouveau ce mardi 6 janvier, les 56 membres de la Commission exécutive nationale de la CGT feront un pas de plus dans la résolution de la crise, avant une nouvelle réunion du « Parlement » de la confédération, le Comité confédéral national, une semaine plus tard. Le sort du secrétaire général ne devrait donc pas être leur seul sujet d’inquiétude. En fait, ils sont confrontés à un entrelacement de problèmes et de défis, qui portent sur la structure même du syndicalisme et sur sa position dans l’espace sociopolitique français et européen.
1. Militants et responsables se sont convaincus depuis une bonne décennie que la vieille structure duale de la CGT (la verticalité des fédérations de métier et l’horizontalité territoriale de l’interprofessionnel) ne correspondait plus à l’organisation contemporaine du travail (à la fois « mondialisé » et parcellisé), aux formes décentralisées de confrontation-négociation et aux modes plus généraux de la sociabilité populaire. Au bout du compte, la CGT a cessé de représenter la totalité du monde du travail, et notamment les travailleurs précaires, les PME, les entreprises de sous-traitance et même le secteur privé en général. Mais si le constat est à peu près bien établi et partagé dans l’organisation, les conséquences pratiques ont du mal à être mises en place et évaluées en retour. Cette situation crée une difficulté de lisibilité pour la confédération tout entière et elle accroît le risque de tensions entre corporations ou même de conflits de personnes, au détriment de la dynamique d’ensemble du syndicat.
2. Le rapport global à la société est l’autre champ qui reste à éclaircir. La CGT, on l’a vu, s’est historiquement inscrite dans une logique originale de « radicalité » par rapport au système global. Cette radicalité n’a certes jamais existé sans l’équilibre d’un solide « sens du réel », n’ignorant jamais l’exigence d’efficacité et donc la nécessité d’avancées partielles, tant au plan de l’entreprise qu’à celui de l’État. Mais cet équilibre était d’autant plus concevable et reproductible que les mécanismes de « l’État-providence » autorisaient des plages de redistribution.
Or l’évolution du capitalisme depuis plus de trois décennies et, plus encore, l’existence d’une crise systémique redéfinissent la donne en profondeur. Il devient plus que jamais nécessaire, sauf à accepter la logique du capital financier mondialisé, d’articuler chaque lutte concrète, défensive ou offensive, à une action concertée sur le « système » lui-même, à des échelles de territoire de plus en plus interpénétrées (du local de l’entreprise jusqu’au niveau continental voire planétaire).
Mais dès lors le syndicalisme se trouve placé devant une contradiction incontournable. D’un côté il ne peut parvenir à des résultats, partiels ou globaux, que sur la base d’une logique de rassemblement ; il doit donc vouloir être un « syndicalisme rassemblé ». D’un autre côté, il est travaillé lui aussi par la polarité entre une culture revendicative plutôt portée vers l’intégration dans le système (sur le modèle nord-européen) et une autre culture qui, sans négliger les compromis immédiats, est plus attentive à la nécessité de réformes structurelles capables d’installer durablement une autre figure du travail, de sa dignité et de sa reconnaissance. D’une façon ou d’une autre, aujourd’hui comme hier, dans l’espace des relations de travail comme dans celui de l’action politique, le poids respectif des deux « cultures » pèse sur l’évolution générale. Que la tradition critique, tant syndicale que politique ou associative l’emporte sur une logique d’accommodement ne peut être sans importance notable pour une tradition syndicale comme celle de la CGT.
3. Reste alors à avancer sur un troisième grand chantier, qui est celui du rapport entre syndicalisme et vie politique. En fait, il s’agit plus largement de l’enjeu démocratique. Qu’il le veuille ou non, le syndicat pâtit aujourd’hui d’une crise générale de toute institution. Toutes les sociétés dites « modernes » (les sociétés « bourgeoises-capitalistes ») se sont construites sur la séparation du « social » et du « politique ». Au début du XXe siècle, il en est résulté un partage des tâches : les syndicats et les associations se sont vu attribuer la gestion du « social », tandis que les partis disposaient du monopole de gestion du politique.
Quel projet de société partagé ?
Or le développement contemporain voit les frontières se faire plus floues, entre public et privé, entre économique, social, politique, culturel et même éthique. Si la spécificité de chaque type d’organisation ne disparaît pas (le syndicat n’est ni le parti ni l’association), le monopole de leur fonction perd de son caractère absolu. Les vieilles formules (le syndicat énonce les demandes ; l’État et les partis la traitent dans l’espace public) ne suffisent plus aujourd’hui. Face à la loi de la marchandise, la finalité du développement sobre des capacités humaines doit se redéfinir et s’imposer.
Or il n’existe à ce jour que trois modèles d’articulation du social et du politique, le modèle travailliste et le modèle social-démocrate évoqué plus haut, et celui du « syndicalisme révolutionnaire », pour lequel le syndicat incarne l’ensemble des fonctions nécessaires à la promotion du monde du travail. Il se trouve que ces trois modèles sont entrés en obsolescence, plus ou moins forte, plus ou moins rapide.
Il n’y a donc pas d’alternative sérieuse à l’expérimentation de nouvelles formes d’articulation entre le social et le politique avec une double contrainte : respecter la spécificité des pratiques et des sensibilités et créer les conditions d’émergence d’un projet de société partagé, capable d’unifier les fragments dispersés du « peuple » et de refonder la dignité du monde du travail. Incontestablement, la redéfinition d’un tel projet ne relève pas de la seule responsabilité syndicale. Mais peut-elle se passer de la contribution volontaire d’un syndicalisme puissant, indépendant, mais associé au grand œuvre à part entière ? Le syndicat peut-il se contenter de déléguer à d’autres la mise en forme, la traduction et la mise en œuvre d’un projet de cette envergure ?
S’il se laissait aller à entériner la coupure du social et du politique, fût-ce au nom d’un passé de subordination (pour la CGT), l’indépendance du syndicalisme resterait illusoire, dans un monde où les maîtres mots restent ceux de la concurrence et de la gouvernance. Le contraire de la subordination ne peut être la séparation… Pour l’instant, le troisième terme n’est pas parvenu à prendre forme.
Notes
[1] Ce texte reprend, de façon raccourcie et mise à jour, une analyse déjà publiée en mars 2014.
* Alice Dubost- CGT : crise de direction… ou crise stratégique ?

On pourrait rapprocher la crise de la CGT de celle qui frappe toutes les organisations politiques ou ouvrières devant une crise économique qui perdure et la crise stratégique qui se pose. La particularité est cependant que les syndicats ont pendant longtemps été les organisations auxquelles les salariés et la population faisaient le plus confiance pour les défendre. L’échec de la grève de 2010 contre l’allongement de la durée de cotisation pour la retraite a marqué durablement le mouvement ouvrier. Maintenant, c’est sur la direction des syndicats, et singulièrement le premier d’entre eux, que beaucoup s’interrogent.
Les révélations successives sur le coût d’aménagement du logement ou des bureaux de Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT depuis mars 2013, puis sur l’indemnité « de promotion » de 31000 euros (somme reconnue par le principal intéressé), enfin sur les manœuvres mises en œuvre pour ne pas être forcé de démissionner, mettent au jour un mode de fonctionnement opaque, peu démocratique, d’une partie de la direction de la CGT coupée des réalités du monde du travail.
Mais la démission de Thierry Lepaon – ou sa révocation qui devrait être en débat lors du CCN du 13 janvier s’il n’a pas démissionné d’ici là – ne suffira pas à faire taire la critique. Car de plus en plus de voix, de la base au sommet de la CGT, s’élèvent pour relier cette crise de direction à l’échec, voire à l’absence de politique face à l’offensive libérale. Les positions défendues au fil des négociations heurtent plus d’un militant, telle la remise en cause des seuils sociaux (la délégation de la CGT a proposé que dans les entreprises de moins de 50 salariés, les élections se fassent « à la demande de deux salariés », ce qui restreindrait les droits actuels).
L’amertume est d’autant plus grande que l’attente envers la CGT reste forte. Sur de nombreux sujets, les salariés se mobilisent, et ils sollicitent le soutien de la confédération : depuis les luttes des chômeurs (manifestation du 6 décembre) jusqu’au travail du dimanche, la confédération n’est pas assez à la hauteur des grands enjeux actuels. Ainsi, la fédération certaines structures soulignent que la réforme territoriale et le développement du syndicalisme des privés d’emploi et des précaires sont des sujets à traiter en urgence.
Trois dimensions se dégagent pour permettre le débat.
La transparence d’abord sur le fonctionnement de la direction d’un syndicat est une exigence portée par la totalité des syndicats s’exprimant. Mais la moralisation de la vie publique, si elle répond à un besoin largement exprimé (ne serait-ce que pour contrer le « Tous pourris » si répandu), ne saurait suffire.
Les interventions des instances réclament donc de plus en plus un autre fonctionnement démocratique de la confédération : comment a été débattue la proposition de refondation de la représentativité syndicale (avec l’émiettement syndical qu’elle a produit et la fragilisation d’équipes syndicales, y compris CGT) ? Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’instances réunies pour soutenir les piquets de grève devant les raffineries en 2010, dont la dynamique permettait une poursuite au conflit sur les retraites ? Certaines prises de position collectives de structures CGT ouvrent à une telle discussion, comme par exemple celle qui explique : « La direction confédérale de notre CGT est aussi confrontée à une crise de ses modalités collectives de fonctionnement et de son efficacité. Refusant et rejetant toute polémique stérile sur les personnes, [le bureau] propose que ce Comité Confédéral National examine les conditions de la mise en œuvre d’une direction collégiale de la CGT. »
Enfin, la discussion stratégique doit être menée largement. Nous ne pouvons ignorer les difficultés aujourd’hui à répondre à la crise économique et à l’offensive libérale. Mais raison de plus pour engager un grand débat sur la riposte à mener. Les mouvements menés par un seul syndicat, et sans coordination, ne peuvent répondre. Il faut donc rassembler, fédérer, combattre. Comme le propose une autre fédération, il faut reconsidérer la « stratégie revendicative confédérée face à un délitement des actions interprofessionnelles dans un contexte où nos militantes et nos militants doutent de la capacité de la CGT à rendre victorieuses nos luttes sociales. » De même, d’autres encore, metent en avant l’exigence d’« Analyser nos capacités de mobilisation, l’impulsion confédérale et débattre de la stratégie CGT ».
La question de la stratégie unitaire est très fortement posée au sujet des trois journées interprofessionnelles de la CGT en 2014 : aucune n’a fait l’objet de propositions réellement unitaires et toutes ont été marquées par des échecs. La dernière, le 16 octobre, portait sur un thème qui aurait pu être rassembleur (le budget de la Sécurité sociale).
Revient aussi la question d’un vrai projet syndical à même de répondre à l’éclatement du salariat entre entreprises donneuses d’ordre et sous-traitantes, entre grandes et petites entreprises, entre salariés précaires et stables, y compris dans la fonction publique.
Signalons quelques expériences unitaires qui, au-delà de l’engagement quotidien des militants sur le terrain, montrent que le syndicalisme porte sans cesse du renouveau.
- A Paris, un comité de liaison Interprofessionnel du commerce (CLIP) rassemble les syndicats parisiens du commerce depuis 2010. La manifestation contre le travail du dimanche du 14 novembre (plus de 2000 manifestants) a été la plus grosse manifestation de salariés du commerce à Paris depuis longtemps. Une assemblée populaire unitaire, rassemblant partis politiques, syndicats, contre le travail du dimanche a eu lieu le 4 décembre 2014. Même une partie du PS commence à s’interroger sur cette remise en cause du dimanche chômé.
- Contre l’extrême droite, une action unitaire rassemble CGT, Solidaires, FSU, UNEF et associations. Ceux-ci continuent à élaborer des analyses et à maintenir le cap de la dénonciation des prétentions sociales du FN dans les entreprises et la société.
- La Fondation Copernic a été à l’origine d’un Observatoire de la répression et de la discrimination syndicale, auquel participent CGT, CFTC, FO, FSU, Solidaires, SAF, SM et de nombreux chercheurs, et qui vient de publier son rapport annuel.
- Enfin, citons l’exemple des journées intersyndicales femmes, coorganisées par CGT, Solidaires et FSU qui chaque année rassemblent des centaines de participant-e-s.
C’est le décalage entre ce syndicalisme vivant, de terrain, unitaire, et une confédération sans capacité d’initiative efficace dans les mobilisations et face à l’ampleur de la crise sociale et politique, Une autre structure CGT « demande qu’on en revienne aux décisions du dernier congrès confédéral afin que soit mise en œuvre une ligne d’action syndicale claire et offensive face aux attaques permanentes du patronat et du gouvernement Valls contre les acquis sociaux, mais aussi contre les plans d’austérité prônés par l’Union européenne ».
L’engagement de la CGT pour défendre tous les acquis ouvriers est fondamental. Sa volonté se vérifiera à travers les mobilisations unitaires qu’elle saura bâtir. Sa capacité à s’ouvrir sur des mouvements sociaux est vitale.
-
Vincent Gachet- Crise à la CGT: la fin d’une époque

Au moment où face à la loi Macron et face au nième cahier revendicatif du Medef, il aurait fallu une CGT combattive et rassembleuse au-delà de ses rangs, l’affaire Lepaon accélère sa crise, brise sa capacité à agir et symbolise dans la caricature la fin de toute une époque.
L’article d’Alice Dubost mis en ligne récemment sur cette crise (« CGT : crise de direction… ou crise stratégique ? ») rassemble quelques points de diagnostic pertinents à commencer par l’absence d’orientation et par ce qu’elle appelle une « crise de stratégie ». Mais cela me semble un peu court pour saisir le point de non-retour que constitue la singulière simultanéité de faits aussi disparates que l’offensive réactionnaire du patronat, la crise sociale, le pourrissement de la direction confédérale, la loi Macron et bien d’autres encore. Il y des moments comme celui-ci où une crise de direction s’inscrit de manière « cohérente » dans le faisceau d’évènements plus amples. Bien plus qu’un symbole, le révélateur d’une histoire qui se referme peu à peu.
La prise de parole de militants CGT en direction de leurs camarades pour en quelque sorte relancer la machine et ne pas désespérer les rangs est centrale. Il faut aussi politiquement – à l’extérieur du syndicat – poser un pronostic pour définir une orientation, une tactique, des axes de travail. On ne peut se contenter en tant que courant politique, comme le fait Alice dont je comprends pourtant le propos et l’objectif, boucler le raisonnement sur une vaine espérance, sur la « volonté (de la CGT)… à travers les mobilisations unitaires qu’elle saura bâtir (et) Sa capacité à s’ouvrir sur des mouvements sociaux est vitale ». On aimerait bien mais hélas…
Trop de retard, trop d’échecs
Comme toutes les organisations du mouvement ouvrier, la CGT est dépourvue de réponses cohérentes, crédibles, mobilisatrices, contre un système économique profondément modifié depuis trente ans par la mondialisation financière. Sans doute en paye-t-elle plus le prix que d’autres en raison de son implantation sociale. Ce n’est pas seulement la détérioration des rapports de forces sociaux dès les années 70/80 qui a ouvert la porte aux politiques libérales. C’est pour beaucoup aussi la transformation progressive des mécanismes économiques, financiers et sociaux qui ont réduit la portée revendicative des organisations syndicales dans leur ensemble. La crise syndicale (qui n’est pas que française !) est une crise d’efficacité face à une évolution structurelle du capitalisme et à la montée de la précarité. De 1980 à 2012, le taux de syndicalisation est tombé de 18% à 8%. 16,7 % des fonctionnaires sont syndiqués, 6,5% des titulaires d’un CDI à temps complet, 5,8% des CDI à temps partiel, 3% des titulaires d’un CDD et… 0,9% des intérimaires.
Mais la CGT n’en finit plus de payer aussi les dégâts de son passé. Vingt-cinq ans après l’écroulement du stalinisme et prise de distance entre l’appareil de la centrale et celui du PCF, ce passé n’a pas disparu de la mémoire collective de beaucoup de salariés : une CGT se pensant comme seule véritable représentante de la classe ouvrière, sectaire et arrogante, exagérément ouvriériste, parfois nullement exemplaire dans la gestion des fonds gérés par les comités d’entreprise (sans être pourtant la seule à ce petit jeu). Encore aujourd’hui des secteurs de la CGT maintiennent cette triste tradition. L’anticommunisme primaire qui règne par ailleurs au sein du salariat fait le reste.
Pour ces raisons mais aussi à cause d’une vision sociale désuète, la CGT a été très peu efficace dans la syndicalisation des couches de plus en plus massives de techniciens et cadres d’exécution. Cette distanciation, commencée dès les années 70, s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui facilitant le renforcement de la CFDT. A moins de croire que dans leur majorité les syndiqués cfdtistes sont de fieffés petits bourgeois à la périphérie de la vraie classe ouvrière, cette situation est lourde de conséquences dans de nombreux secteurs où la division syndicale se lit comme une division sociologique ou catégorielle. D’autant plus que la désindustrialisation rogne la base cgtiste dans beaucoup de secteurs. C’est notamment le cas dans les grands groupes qui rationalisent leurs sites en France et réduisent ainsi la part des ouvriers dans leur effectif global.
Certaines élections professionnelles récentes montrent cette relation entre érosion du vote CGT et érosion du 1er collège (la même chose pouvant se produire pour Solidaires). Ici ou là, la CGT a perdu sa place de première organisation syndicale au risque d’être parfois marginalisée par le front uni des autres organisations, avec le goût amer d’une séparation catégorielle. Certes, la période n’est pas à la radicalisation de tous les secteurs du salariat, mais le problème n’est pas nouveau et remonte aux années 60 et 70 sur fond d’ouvriérisme et d’un discours « CGT = ouvriers = luttes de classe », qui fut souvent un vernis bureaucratique pour justifier un sectarisme et une incapacité à unifier le salariat. Dans la métallurgie les cadres et techniciens sont presque aussi nombreux que les ouvriers et les employés. Dans les Télécommunications ils représentent 72%, dans la Chimie 64% des effectifs, tout comme dans la Banque et les Assurances, dans les Sociétés d’études et de services 69%, dans le Sanitaire et Social 41%. Tous ces secteurs réunis représentent 37% des salariés du privé (année 2010), une paille ! Il ne s’agit pas de fétichiser ces chiffres et d’en rester là, bien sûr. On sait que la division sociologique du salariat est un problème profond. Mais tout de même… pourquoi la CGT n’a pas été capable de s’implanter un peu plus substantiellement dans ces couches massifiées au cours des 40 dernières années ? Et quelles conséquences sur l’état de la confédération aujourd’hui ? La crise vient donc bien de loin !
Or, le problème est que pour les militants de la CGT les plus critiques, ainsi que pour de nombreux militants politiques de gauche, la CGT c’est la classe ouvrière ! Son cœur, son centre, sa frange la plus consciente… peu importe les nuances. Comme si la disparition de toute opposition dans la CFDT ou les limites de Solidaires, pour ne prendre que ces deux cas, réglaient définitivement la question du « sujet syndical ». Il n’en est rien.
Fractionnement de l’appareil
Bien sûr, la CGT n’échappe pas à la crise globale du mouvement ouvrier et au lent déclin des structures de représentation aussi bien syndicales que politiques qui ont été celles du XXème siècle. Mais sa crise est spécifique. Alors que l’appareil CFDT a accentué sa centralisation autoritaire, s’est fabriqué un déguisement de « syndicalisme de proposition » et se vend au patronat, la CGT s’est fragmentée autour notamment d’intérêts fédéraux. L’inadéquation du périmètre de certaines fédérations avec l’évolution objective de certains métiers et branches est l’expression du conservatisme et des résistances des appareils intermédiaires. L’affaiblissement global de la CGT et de ses ressources a exacerbé les réflexes de défense des petits appareils fédéraux et départementaux (UD). Mais sauvegarder ses moyens militants et administratifs peut mener à d’étranges compromissions.
Les « à côtés » de la nomination de Thierry Lepaon, pour peu qu’ils relèvent effectivement d’une position de pouvoir, ne peuvent exister au sein d’un appareil bureaucratique sans retour d’ascenseur. La réciprocité hiérarchique est pour ainsi dire une loi pour toutes les formes de bureaucratie. La promiscuité y étant généralement trop grande pour que ce que l’un obtient dans sa fonction ne soit pas (en partie) accordé aux ayants-droit les plus proches.
Mais si « le poisson pourrit par la tête » comme dit le proverbe chinois, qu’en est-il du « corps » ? Dans un passé lointain la bureaucratie CGT tenait par ses liens rigoureux avec l’appareil du PCF. En 1977, la centrale annonce 2,3 millions d’adhérents, le plus haut niveau depuis les années 50. A partir de là, l’érosion commence sur fond d’échec du « Programme commun », de dénonciation de Solidarnosc en Pologne et du passage du PCF au gouvernement Mauroy. Le bâtiment de Montreuil inauguré en 1982 coûte fort cher. Il renvoie à l’optimisme du moment et aux « Chateaux en Espagne » auxquels pouvait rêver la bureaucratie. Aujourd’hui, la péréquation de ces coûts au niveau des fédérations qui occupent une partie du bâtiment est douloureuse. La baisse des cotisations, combinée aux frais de structures, réduit les moyens affectés aux petits appareils fédéraux. Les ressources manquent pour faire son boulot mais les solutions pour s’en sortir ne sont pas toujours d’une grande exemplarité. Dans certaines branches, où dominent de très grands groupes à la politique sociale parfois paternaliste, il n’est pas impossible de négocier quelques gestes altruistes tant au niveau fédéral qu’au niveau de l’entreprise. Bien sûr toutes les autres organisations syndicales font de même aujourd’hui et sans doute en pire (à qui allaient les fonds de l’UIMM ?). Mais venant de structures CGTistes le malaise est d’autant plus grand, ce qui « limite » par ailleurs la parole de certaines fédérations contre Thierry Lapaon. Ici ou là, à des niveaux fédéraux ou au cœur de grandes firmes, sous des formes diverses, beaucoup les strates de l’appareil finalement se « débrouillent ».
Et puis il y a les divisions au sein même des fédérations sur des questions pas forcément très politiques mais qui usent profondément la capacité de réflexion collective et d’intervention, surtout quand la direction confédérale s’en mêle. La CGT n’a pas non plus montré une fantastique capacité à intégrer des forces organisées venant de la CFDT et quelques tensions internes sont encore interprétées sous l’angle de la « pièce rapportée ».
Une force de résistance affaiblie et divisée
Certains articles de presse ont été jusqu’à parler d’ambiance de scission. C’est ne pas bien comprendre les mécanismes bureaucratiques. L’appareil innerve la structure de haut en bas et ne se réduit pas aux étages supérieurs. Pour en arriver à une scission, il faudrait que s’opposent clairement et longuement des projets antagoniques et clairement exprimées. Or, à quelques exceptions près, il n’est pas possible d’identifier des desseins clairs émanant de fédérations importantes. Alice a raison d’insister sur ce point et d’écrire « Revient aussi la question d’un vrai projet syndical à même de répondre à l’éclatement du salariat entre entreprises donneuses d’ordre et sous-traitantes, entre grandes et petites entreprises, entre salariés précaires et stables, y compris dans la fonction publique ». Une scission ne serait possible que si une grande fédération historique prenait la tête d’un contreprojet et qu’elle n’ait d’autres moyens que de cliver la confédération sur ses propositions. On en est très loin. Et nous savons par ailleurs qu’une scission dans un contexte de recul général des luttes a peu de chance de marquer le point de départ d’une plus vaste recomposition.
Le déficit programmatique et revendicatif se nourrit comme toujours de la faiblesse des expériences de terrain, du maigre rajeunissement des cadres et de l’absence d’un bilan sans entrave sur certaines luttes et formes de lutte. D’un côté l’absence de grandes luttes refondatrices, de l’autre un appareil qui limite d’autant plus le débat d’idées que lui-même en est en partie dépourvu. A cela s’ajoutent les pressions du gouvernement et du parti socialiste, la question du débouché électoral (mais lequel ? le Front de gauche ?) et une conception de l’unité syndicale polarisé par le poids de la CFDT dans les négociations sociales. La réflexion parcellaire de militants dispersés dans les fédérations et les Unions départementales ne permet pas de surmonter cette situation. D’autant que l’ouvrage est d’une complexité sans nom en l’absence d’une parole confédérale claire et intelligente.
Comment sortir de la pure propagande et des axes de campagnes « miracles » (la campagne sur le « coût du capital », celle sur la défense de l’industrie française…) et retrouver le sens d’une pratique revendicative dans les entreprise qui s’adresse à tous les salariés sans les cliver « catégoriellement » et qui soit crédible ? On sait que la syndicalisation dépend pour beaucoup de la démonstration par les succès remportés aussi petits soient-ils. Il ne faut donc pas s’étonner du nombre d’accords signés par la CGT dans les entreprises y compris dans la cadre de plans sociaux. Les équipes locales savent que « faire son boulot » passe aussi par accepter que le verre soit à moitié plein sur un accord d’intéressement, une revendication salariale ou un nombre d’emplois supprimés. Ne pas signer n’importe quoi mais tout de même gagner un peu. Si cela ne fait pas une stratégie (puisse-t-il y avoir une « stratégie » syndicale ?) cela ne nécessite pas non plus un savoir-faire syndical remarquable. A chaque lutte dans chacun des secteurs et des entreprises, en fonction d’un certain rapport de force et dans un contexte de dispersion syndicale spécifique il faut savoir œuvrer avec discernement et trouver les bonnes modalités tactiques. Pas facile quand les plus anciens prennent leur retraite et que les plus jeunes se font rares et apprennent encore.
Il faut aussi compter sur le désespoir de ceux et celles qui perçoivent la fin d’une époque au cœur de leurs métiers : délocalisations irréversibles, reclassements déqualifiants, fermetures d’entreprise et dépôts de bilan, chômage en vue. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant d’observer des comportements CGTistes très divers, parfois opportunistes ici ou ultra gauches ailleurs. Certaines fédérations connaissent ce genre de distensions internes. On le retrouve en partie dans les débats nationaux. Alors que Lepaon est souvent crédité d’une ligne trop conciliante, les tentations existent d’une réponse symétrique, solitaire et gesticulatoire menant aussi à de graves défaites. Entre les deux, rien n’est simple non plus entre différentes fédérations ou parties de fédérations.
Simple rénovation syndicale ou bouleversement ?
Le « redressement » de la CGT est-il encore possible ? Du moins le redressement tel que nous pouvons le rêver : revendicatif, unitaire, démocratique, débarrassé de sa bureaucratie et polarisant le salariat ? Pour cela il faudrait un événement politique d’une telle ampleur que toute la représentation sociale en serait de toute manière bouleversée. Hormis cette hypothèse, la CGT risque fort de continuer à se fragmenter.
Dans l’attente douloureuse de l’événement social majeur, il est très important qu’en interne les militants les plus clairvoyants fassent « comme si » le redressement était envisageable. D’autant que le patriotisme d’organisation y est très fort. Mais la réflexion politique ne peut s’arrêter là, parce qu’au bout du compte il ne s’agira jamais d’un redressement en soi de la seule CGT.
La crise n’est pas une simple crise d’orientation et encore moins une crise de direction faisant suite à la succession malheureuse de Bernard Thibault. Elle tient d’abord au décalage mortel entre la trop lente révision des analyses du passé (révision inégale au sein de la confédération) et la profondeur des transformations socio-économiques depuis trente ans. Toute la bonne volonté du monde ne permettra pas de remonter ce handicap au sein d’une organisation sclérosée et bureaucratisée. En tant que courant politique, en rester au seul niveau de la CGT c’est se contenter d’une ligne de défense perdue d’avance.
S’il ne faut pas s’aventurer à anticiper la forme d’une recomposition syndicale à dix ou quinze ans, il faut tout de même y penser en termes de processus. Aujourd’hui, rien ne justifie que le nombre de militants politiques de gauche syndiqués à la CFDT ou à FO soient aussi insignifiant. Bien sûr, les rangs de la CGT se positionnent majoritairement à gauche et partagent grosso modo les mêmes analyses que nous sur l’offensive patronale et la politique du gouvernement. Incontestablement cela constitue un point d’appui important. Mais, isolée du reste de la question syndicale, cette voie est hasardeuse. Nous condamnons les forfaitures de la direction de la CFDT mais nous ne nous adressons jamais à ses militants. A l’inverse, nous faisons parfois grand bruit sur certaines luttes sans dire un mot du comportement ultra sectaire de certaines franges de la CGT comme à Goodyear Nord (Amiens) et nous ne disons pas un mot sur le bilan de ces comportements. Or, pour peu que nous nous positionnions sans excès dans la perspective d’un big bang social (comme nous le faisons d’ores et déjà du côté de la représentation politique soit dit en passant !), alors le champ de notre intervention ne peut se réduire à ce que nous ressentons comme une « gauche syndicale ». Car, les organisations syndicales pas plus que les organisations politiques n’échapperont à ce big bang, toutes confondues le jour où cela s’engagera. Déjà aujourd’hui dans certaines entreprises ou certains secteurs la séparation entre une certaine CGT et Solidaires est incompréhensible aux yeux de salariés et mériterait bien plus que des tracs communs épisodiques.
Je ne crois ni au redressement vertueux de la CGT, ni au redressement d’une quelconque autre confédération. Il nous faut avoir un point de vue politique sur ces questions et non plus simplement endogène au syndicat. Je suis convaincu, comme tout le monde, que le travail de conviction, de résistance, de proposition doit se poursuivre au sein de la CGT de manière prioritaire. Grand bien nous ferait que demain, à partir d’une lutte ou d’un événement social, un courant naisse dans cette confédération pour porter un projet syndical rénové et unificateur. Mais ne nous replions pas sur ce seul champ d’espérance (serait-il élargi à la FSU et à Solidaires). Il faut pouvoir travailler sur plusieurs niveaux – hiérarchisés – et s’interroger sur notre le caractère par trop « borgne » de notre approche du syndicalisme depuis près de 20 ans bientôt.
Il faut commencer à expliquer que le syndicalisme de demain n’aura pas le visage d’aujourd’hui, que l’histoire va finir par submerger cet existant sclérosé pour donner naissance à de nouvelles formes de défense collective des salariés. L’expliquer, mais aussi commencer à agir pour cela. Et pour cela nous guérir au passage du mal d’amour ancien qui nous fait voir la CGT comme le « cœur de la classe ».
- Alice Dubost : CGT, l’hypothèse d’une refondation

Rien n’est résolu dans la CGT après la réunion du comité confédéral national (CCN) du 13 janvier, structure de direction qui rassemble les responsables des 33 fédérations professionnelles et des 96 unions départementales. Cela ne fait pas plaisir à dire ou à écrire, notamment quand on pense aux militantes et militants qui font la richesse de la CGT, mais il est peu probable que la solution soit trouvée rapidement. Le choc a touché la CGT à la tête, c’est-à-dire, pour la tradition CGT, à la clef de voûte. Mais c’est la charpente qui menace d’écroulement, alors que les pierres sont encore solides. C’est pourquoi pour certaines équipes syndicales, il est nécessaire d’envisager de rebâtir le bâtiment, mais autrement. Voilà le défi, il est énorme : une refondation démocratique et stratégique.
Le 13 janvier, rien n’a été résolu pour personne. Ni pour la « solution Lepaon sans Lepaon », c’est-à-dire Philippe Martinez, secrétaire général de la Fédération des métaux devenant secrétaire général de la CGT, qui avait envisagé, avant que le CCN ne le refuse, de s’entourer d’une équipe qui n’aurait fait qu’aggraver la crise. Ni une solution donnant à voir pour le salariat et pour les syndiqué-es une image d’ouverture courageuse, de vrai contre-choc démocratique. C’est pourtant ce que l’intervention de Louis Viannet (Le Monde, 6 janvier) avait soutenu avec une grande lucidité : « Il vaut mieux regarder la réalité en face, aussi dure soit-elle […]. Lors du départ de Bernard Thibault, Il est bien apparu des signes qu’un mal-être était déjà présent, dû sans doute au retard pris dans l’évolution de la CGT ». Et Louis Viannet de préconiser un « véritable aggiornamento de la CGT ». Mais si Thierry Lepaon a démissionné, c’est sa solution qu’il a cherché à réimposer, montrant que l’intervention des trois précédents secrétaires généraux (Séguy, Viannet, et Thibault, sur un mode plus discret) n’a pas suffi à régler les questions. Ce qui s’explique par un acharnement des forces de résistances d’un appareil recroquevillé (et difficile à cerner politiquement) qui se braque et menace la CGT tout entière. Cet appareil cherche à mener une guerre d’usure, qu’il n’est pas sûr de gagner sur le fond, mais qu’il peut gagner par lassitude.
En effet, même si dans sa conférence de presse, Philippe Martinez annonce la mise en place autour de lui d’un nouveau groupe de travail voté à l’unanimité, la première solution « Martinez-Le Paon » n’a recueilli que 57% des voix (il en faut statutairement les deux tiers). Et même moins que cela, puisque la Fédération de la santé, contrairement à son mandat très clair, n’a pas hésité à mettre ses 36 voix dans le projet « Martinez-Le Paon », ce qui est qualifié de « méthode mafieuse » par certains (Le Monde, 15 janvier). Sans ce coup tordu, on frise les 50/50 dans le CCN, et non 57%.
Tout est donc renvoyé au prochain CCN les 3 et 4 février. Mais entre-temps, la commission exécutive confédérale (CEC), la structure de direction élue par le 50e congrès de 2013, se sera réunie à plusieurs reprises, et le rapport des forces n’y est pas le même. Le CCN relèvera-t-il le défi politique en prenant des mesures audacieuses dont il a le pouvoir ? Ce serait le moment. Mais encore faut-il bien cerner ce dont la crise actuelle est le nom.
La CGT orpheline d’un projet syndical
Successivement, les mandats de Louis Viannet et de Bernard Thibault ont entrepris de nettoyer le vieux logiciel d’une confédération ayant l’habitude de se vivre comme la « première » de toutes et éternelle, parce que la plus en phase avec « la classe ouvrière ». Viannet a géré le choc de l’écroulement du mur de Berlin, de l’offensive du néo-libéralisme mondialisé qui a rencontré des résistances dont le vaste mouvement de décembre 95 a été le point de départ durable. Il a bâti la stratégie du « syndicalisme rassemblé » sur ce mouvement ascendant, dont Bernard Thibault fut le symbole rajeuni, à commencer par son propre secteur professionnel, les cheminots, dont le prestige a duré longtemps, et persiste encore. La CGT a largué les amarres avec la Fédération syndicale mondiale (FSM) en 1995, et adhéré à la Confédération européenne des syndicats (CES) en 1999. Elle a fait des efforts pour recentrer son implantation dans le secteur privé, et notamment dans le nouveau salariat du commerce et des services, dans les PME, chez les cadres, dans des bassins d’emplois qui étaient des déserts syndicaux aux lisières des agglomérations (syndicats de site, unions interprofessionnelles de type nouveau, de bassins d’emploi, etc.). Des résultats ont été obtenus, même s’ils sont modestes, avec un filet de recrutement qui semble cependant se tarir depuis un an ou deux.
Elle a surtout tenté de résoudre un tabou : vivre sans le PCF, qui était de fait le réseau non statutaire faisant fonction de ciment humain, culturel et directionnel (et parfois matériel, et même financier, comme le montre le livre « Les vingt ans qui ont changé la CGT » (Leïla de Comarmond, Denoël, 2013). S’affranchissant du PCF comme « correspondant » politique de la CGT, comme cela a été le cas durant des dizaines d’années, le navire CGT a heureusement sauvé sa route dans les années 1990 et 2000. On a même pu dire que la « courroie de transmission » a fonctionné un moment à l’envers. Mais il restait quand même un habitus, une culture, des mœurs (« en être » ou pas). Et dans les moments où il faut choisir des personnes, résoudre des questions douloureuses sur le plan matériel et organisationnel (cotisations, structures), l’absence d’une forte légitimité implicite est devenue un handicap majeur. Or le PCF n’était plus du tout une « solution ». Il a lui-même connu bien des débats houleux (le « huisme » comme tentative de rénovation non stalinienne n’a pas laissé des traces impérissables en son sein), qui se sont parfois réfractés dans la CGT (avec des « modernistes » et des « enclumes » dans les deux endroits), mais souvent aussi sur d’autres lignes de différenciation que la reproduction mécanique des courants du PCF, même si des allégeances persistent sous une forme déformée, parfois surprenante, mystérieuse (les « huistes » de l’énergie ou d’autres) ou caricaturale.
La solution provisoire a été, sous Thibault, une sorte de refus obsessionnel du « politique », histoire de couper les ponts, qui a débouché, notamment en 2005, sur une crise à propos de l’appel au vote concernant le Traité constitutionnel européen. Beaucoup d’équipes ont heureusement refusé de confondre arrêt de la courroie de transmission à l’ancienne, et dérive vers une sorte de « neutralité » de fait. La clef d’explication de cet épisode est sans doute le refus d’assumer une lecture politique (au bons sens du terme et traduite en langage syndical) de la critique du libéralisme européen. Moins que jamais aujourd’hui, le PCF et ses courants internes, ni aucune autre force politique (Front de gauche y compris), ne peuvent être des référents utiles pour cimenter une orientation cohérente et résoudre des problèmes d’appareil. Par contre, la dépolitisation aboutirait à dévaler très vite une pente d’adaptation aux sirènes libérales, et pas du tout à « resyndicaliser » la CGT, comme Thibault l’a parfois défendu (et c’est une vraie nécessité).
La France est un pays politisé. Il faut donc trouver une « solution CGT » ou syndicale à ce qui s’appelle « l’alternative politique », et cette solution ne peut être qu’un projet syndical pluraliste de résistance au libéralisme, mais interpellant fermement toute la gauche sur des alternatives concrètes, sans être à la remorque de personne. Cela suppose aussi de construire des mobilisations unitaires pour combattre les politiques d’austérité de l’actuel gouvernement et les provocations du Medef. Cela peut passer aussi par des actions communes bien ciblées avec les forces de gauche (manifestation du 12 avril 2014 contre l’austérité, du 15 novembre sur le budget), car l’heure est grave dans le pays (comme elle l’était avant le Front populaire de 1936, même si la période est très différente), et plus encore après les assassinats dont Charlie Hebdo et des citoyens juifs ont été l’objet et après la formidable mobilisation populaire du 11 janvier.
Reformuler les perspectives stratégiques
Les attentes du salariat à l’égard du syndicalisme d’aujourd’hui ne sont pas celles des années 1950, ni des années 1970. Beaucoup de travaux l’ont montré, et récemment ceux de Jean-Marie Pernot (« De quoi la désyndicalisation est-elle le nom », in Histoire des mouvements sociaux en France, 1814 à nos jours, dir. Michel Pigenet, Danièle Tartakowski, La Découverte, 2013), ou ceux de chercheurs en sciences sociales. Il y a bien sûr les changements de structure de l’économie et du salariat : sous-traitance, PME adossées aux multinationales apatrides, éclatement des statuts, externalisation, féminisation, sans-papiers, contrats courts en tout genre, surexploitation, insécurité partout… Ce qui fait « classe commune » est plus que jamais à construire dans l’auto-organisation syndicale et de lutte, pas à pas. Pour cela, une inventivité démocratique et sans formalisme est absolument indispensable : pas de corset bureaucratique, place à l’initiative, à l’intelligence collective, au pragmatisme avec les jeunes surtout. En un mot, construire les structures adaptées aux hétérogénéités de la vie professionnelle.
Mais justement, parlant de « profession », il faut parler du « travail » vécu, soumis aux injonctions déshumanisantes du management néo-libéral, empêchant le travail bien fait et refusant la reconnaissance des inventions collectives et personnelles des salarié-es. Or, c’est ce déni qui détruit la santé au travail (psychologique autant que physique), et étouffe dans l’œuf l’autonomie des collectifs. Il convient donc de reprendre les choses à la racine, et que le syndicalisme se ressource dans la compréhension de « ce qui se passe » au travail, et pas seulement dans l’emploi. L’élaboration des revendications nécessite aujourd’hui de passer « par la porte du travail », c’est-à-dire par la délibération de ce qui s’y vit collectivement et individuellement. Et d’où peut émerger une nouvelle formulation des besoins.
Les revendications ont également besoin de tendre vers une nouvelle perspective émancipatrice, qui n’est pas moins nécessaire au XXIe siècle, 120 ans après la naissance de la CGT, qu’en 1906 (congrès d’Amiens). L’« émancipation intégrale » par la « double besogne, quotidienne et d’avenir », est le vrai fond dynamique de la Charte d’Amiens, et pas le refus étroit de toute action avec le « politique ». La « socialisation des moyens de production », introduite plus tardivement, fut rayée des statuts au congrès de 1995, parce qu’elle était comprise comme étatisation bureaucratique (et justement on voulait à l’époque rompre avec cela). Soit. Mais ce qui se développe dans les SCOP ou dans les projets alternatifs et autres « solutions industrielles » (SANOFI, etc.), c’est l’expérimentation d’une autre forme d’appropriation collective passant par la gestion concrète sans patron, certes menacée par l’environnement capitaliste, mais qui peut aussi ouvrir la voie à une économie solidaire respectueuse de l’environnement, et même à des reconversions industrielles complètes basées sur d’autres technologies.
Mais la reconversion nécessite la sécurité du salaire ! Et justement la sécurité sociale et son outil, la socialisation du salaire, reste à généraliser par le statut du salariat et la sécurité sociale professionnelle, entendue comme une alternative au marché du travail capitaliste, à la subordination et aux licenciements.
Tout cela peut déboucher sur l’audace d’un rapport décomplexé avec les « politiques » à gauche, déjà évoqué plus haut. Quand on sait où on va, on n’a rien à craindre de la confrontation, ni même à l’action sur des objectifs partagés et vérifiés soigneusement, tout en respectant les responsabilités propres des uns et des autres.
Il y a enfin la nécessité du rassemblement syndical, mais un rassemblement démocratique. Il ne s’agit donc pas d’un accord des seuls appareils nationaux, ni à l’inverse d’une simple manœuvre par le bas, tout aussi inefficace. Les salarié-es ont besoin de vérifier les propositions et stratégies des uns et des autres. Cela nécessite un débat public. D’où la proposition (voire Syndicats : Les cinq défis à construire, unissons-nous, éditions Syllepse, 2014) d’un Comité national intersyndical de dialogue, et d’action chaque fois que possible, ouvert sans limitation à priori. Certes les stratégies nationales sont contradictoires de bien des points de vue. Mais cette contradiction a besoin de démonstration publique, et elle n’est pas du tout vue de la même façon sur le terrain, dans les entreprises (où bien des équipes CFDT restent de vrais syndicats et non des « médiateurs sociaux »), que sur le plan des stratégies nationales. Simultanément, la nécessité existe de rassembler sans attendre celles et ceux qui partagent les mêmes approches revendicatives et d’action. La très grande crainte CGT d’admettre une vraie démarche publique de rapprochement rapide avec la FSU, et Solidaires, relève du même réflexe auto-protecteur qui mine son appareil national. Les salarié-es attendent de l’audace, de l’invention et non un repli sur les certitudes. Ouvrir les fenêtres : c’est souvent ce que font (sans le théoriser) les nouvelles équipes qui se construisent, et se heurtent parfois, incrédules, à des formalismes incompréhensibles dans leur organisation.
D’où l’espoir entendu souvent ces jours derniers : la CGT vivra si elle sait prendre des initiatives refondatrices audacieuses. Les mêmes audaces qui ont permis il y a 120 ans la confédéralisation des fédérations et des bourses du travail, pour faire face aux exigences d’une époque de fermentation sociale, parfois dans un joyeux désordre, mais en prise sur la vie.