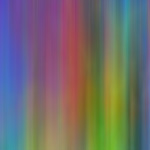Alors que de tous côtés, et de mille façons (certaines passionnantes), sont évoqués l’histoire et le contexte de la guerre mondiale 1914-1918, cette lettre du responsable syndical Pierre Monatte (1881-1960) à la direction de la CGT montre à quel point l’entrée en guerre en août 1914 a très vite balayé les engagements antérieurs pour la paix, qui étaient pourtant ceux de tout le mouvement ouvrier, syndical et politique. Ecrivant à son syndicat, Pierre Monatte n’hésite pas d’ailleurs à rappeler les résolutions du mouvement socialiste international, malgré la Charte d’Amiens stipulant que le « politique » doit rester « au dehors » du syndicalisme. Mais la politique, celle de l’Etat ! était en train d’entrer dans le syndicalisme et d’en changer le contenu. Cette protestation de Pierre Monatte contre l’adaptation au nationalisme guerrier, contre lequel se positionnaient toutes les résolutions internationales des partis socialistes et du syndicalisme, singulièrement en France avec une CGT syndicaliste révolutionnaire (dont Monatte, fondateur de La Vie ouvrière, était une figure), qui avait mené campagne contre l’ennemi intérieur, sonne aussi étrangement par son actualité, lorsque des propagandes gouvernementales et des médias soufflent la bonne pensée, et que certains sommets syndicaux s’alignent.
Jean Jaurès a été assassiné quelques mois auparavant : il fallait sans doute cette mort physique pour que la mort symbolique de la conscience internationaliste ouvre la voie à la régression des consciences, à « l’union sacrée« , c’est-à-dire à la naissance des pactes nationaux par lesquels le syndicalisme entre à ce moment dans une nouvelle phase : les débuts de son incrustation institutionnelle dans l’Etat.
Pierre Monatte
Lettre de démission au Comité Confédéral de la C.G.T.
Décembre 1914
Camarades,
Après le vote émis dans sa séance du 6 décembre par le Comité Confédéral, je considère comme un devoir de renoncer au mandat que vous m’aviez confié.
Voici les raisons qui ont dicté ma détermination : au cours de ces cinq derniers mois, c’est avec stupeur, avec douleur, que j’avais vu le Comité Confédéral enregistrer purement et simplement l’acceptation par son secrétaire général d’une mission officielle de commissaire de la nation.
Quelques semaines plus tard, la Commission Confédérale envoyée à Bordeaux consentir à faire une tournée de conférences pour le compte du gouvernement.
Des militants syndicalistes, des fonctionnaires d’organisations, tenir un langage digne de purs nationalistes. Aujourd’hui, le Comité Confédéral vient de refuser sa sympathie aux efforts tentés eu vue de la paix par les socialistes des pays neutres. Pour le Comité Confédéral, parler en ce moment de paix constituerait une faute, presque une trahison, une sorte de complicité dans une manœuvre allemande, tout comme pour Le Temps et pour le gouvernement.
Dans ces conditions, il m’est impossible de rester plus longtemps dans son sein, car je crois, au contraire, que parler de paix est le devoir qui incombe, en ces heures tragiques, aux organisations ouvrières conscientes de leur rôle.
Le 22 novembre, le secrétaire confédéral donnait connaissance au Comité d’une invitation à la Conférence des socialistes des pays neutres organisée à Copenhague, pour les 6 et 7 décembre par les partis socialistes scandinaves.
M’opposant au passage à l’ordre du jour, je faisais la proposition suivante : que la C.G.T. répondit en assurant les socialistes scandinaves que, s’il nous était impossible d’envoyer un délégué, nous suivrions cependant leur efforts en faveur de la paix avec la plus grande sympathie et que nous faisions des vœux pour le succès de Copenhague.
A la séance du 29 novembre, la fédération des Métaux déposait une résolution motivée, inspirée du même esprit, à laquelle je me ralliai avec empressement.
Comment et par qui elle fut combattue ? Par quels arguments ?
Il serait trop long de le dire ici ; mais les procès-verbaux du Comité Confédéral 22 novembre, 29 novembre et 6 décembre vous fixeront sans doute un jour prochain.
Le 6 décembre, le Comité Confédéral se trouvait devant trois propositions : une première, de la Fédération du Bâtiment, tendant à ne faire aucune réponse ; une seconde, de Luquet, comportant des restrictions importantes et l’accord de la C.G.T. et du Parti sur un texte commun de réponse ; enfin celle des Métaux. Le Comité se prononça d’abord sur la proposition à caractère préjudiciel du Bâtiment, l’adoptant par 22 voix contre 20 et 2 abstentions. Il est hors de doute que la proposition des Métaux aurait été écrasée, le 6 décembre, par une forte majorité.
Ainsi, une nouvelle fois, des appels socialistes en faveur de la paix n’auront trouvé aucun écho dans les organisations centrales françaises, ni dans la presse ouvrière de ce pays, celle-ci allant même jusqu’à refuser de les reproduire. Appels et initiatives conformes cependant à la résolution des congrès socialistes internationaux de Stuttgart, de Copenhague et de Bâle, qui déclare :
» Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, c’est le devoir (aux classes ouvrières) de s’entremettre pour faire cesser promptement et d’utiliser de toutes leurs forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les couches les plus profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste « .
Ce devoir, Keir Hardie et l’Indépendent Labour Party, en Angleterre, se sont efforcés, dès le premier jour, de le remplir ; ainsi que les deux partis socialistes russe ; de même que les socialistes italiens et suisses dans leur Conférence de Lugano et le parti socialiste américain par son initiative d’un Congrès socialiste international extraordinaire.
C’est le devoir que vient de remplir Karl Liebknecht et avec lui une minorité du parti socialiste allemand par sa protestation au Reichstag, le 2 décembre :
» Une paix rapide qui n’humilie personne, pour une paix sans conquêtes, voilà, déclare-t-il, ce qu’il faut exiger. Tous les efforts dirigés dans ce sens doivent être bien accueillis.
Seule, l’affirmation continue et simultanée de cette volonté, dans tous les pays belligérants, pourra arrêter le sanglant massacre avant l’épuisement complet de tous les peuples intéressés. » Seule, une paix basée sur la solidarité internationale de la classe ouvrière et sur la liberté de tous les peuples peut être une paix durable. C’est dans ce sens que les prolétariats de tous les pays doivent fournir, même au cours de cette guerre, un effort socialiste pour la paix « .
Il est incompréhensible, dans une certaine mesure, que les masses du peuple, trompées et excitées journellement par la presse, par toute la presse, aient accepté comme articles de foi toutes les déclarations gouvernementales.
Mais que les militants du syndicalisme n’aient pas montré plus de plus de clairvoyance, qu’ils n’aient pas apporté plus de sens critique à l’examen des allégations gouvernementales, qu’ils se soient laissé gagner par la fièvre de la vanité nationale, qu’ils aient perdu le souvenir des principes qui guidaient jusqu’à maintenant leur action, voilà le plus attristant spectacle.
Quand Poincaré, il y aura deux ans le mois prochain, monta à la présidence de la République, certains d’entre nous se dirent : » Nous aurons la guerre avant la fin de son septennat « .
Nous l’avons eue moins de deux ans après. Cette guerre prévue, redoutée par nous, cette guerre voulue, préparée par nos politiciens de l’esprit national, c’est elle que la majorité du Comité Confédéral envisage maintenant comme une guerre de libération pour l’Europe, comme une guerre capable de porter la liberté et la République à l’Allemagne et de ruiner le militarisme universel.
Quelle illusion !
Cette guerre, dont l’attentat de Sarajevo ne fut que le prétexte, a ses sources réelles dans le duel économique anglo-allemand et dans la rivalité germano-slave.
L’alliance russe, déjà la honte de la République française, a précipité notre pays dans le gouffre. L’alliance russe et les ambitions marocaines de nos coloniaux. Le Kaiser n’a fait qu’avancer l’heure de la conflagration européenne. Sa responsabilité en est plus lourde que celle d’aucun gouvernement ; mais celle des gouvernements français, russe et anglais n’est pas légère.
Encore n’est-il pas établi que le gouvernement français ait tout fait pour sauvegarder la paix dans la dernière semaine de juillet. Nul ne doute que la diplomatie secrète – aux méfaits tant de fois dénoncés – ait joué un rôle considérable dans la déclaration de la guerre.
Les travailleurs conscients des nations belligérantes ne peuvent accepter dans cette guerre la moindre responsabilité ; elle pèse, entière, sur les épaules des dirigeants de leurs pays. Et loin d’y découvrir des raisons de se rapprocher d’eux, ils ne peuvent qu’y retremper leur haine du capitalisme et des Etats. Il faut aujourd’hui, il faudrait plus que jamais conserver jalousement notre indépendance, tenir résolument aux conceptions qui sont nos nôtres, qui sont notre raison d’être.
Si on les croit fausses, qu’on le dise !
Alors seulement on aura le droit de faire du nationalisme sous toutes ses formes, nationalisme politique et nationalisme économique. Mais je crains fort que nos organisations centrales, en France comme en Allemagne, C.G.T. comme Parti socialiste, Union Syndicale internationale comme Internationale socialiste, n’aient signé leur faillite. Elles venaient de se révéler trop faibles pour empêcher la guerre, après tant d’années de propagande organisatrice. Mais on pouvait encore se dire que la faute en incombait peut-être aux masses restées à l’écart et qui n’avaient pas compris les devoirs de l’internationalisme.
Cette dernière lueur d’espoir vacille sous les paroles des militants d’un pays à l’autre. C’est au centre que le feu, c’est-à-dire la foi, a manqué.
Si l’humanité doit connaître un jour la paix et la liberté, au sein des Etats-Unis du monde, seul un socialisme plus réel et plus ardent, surgissant des désillusions présentes, trempé dans les fleuves de sang d’aujourd’hui, peut l’y mener.
Ce n’est pas, en tout cas, les armées des alliés, non plus que les vieilles organisations déshonorées qui le peuvent. C’est parce que je crois, chers camarades du Gard et du Rhône que la C.G.T. s’est déshonorée par son vote du 6 décembre, que je renonce, non sans tristesse, au mandat que vous m’aviez confié.